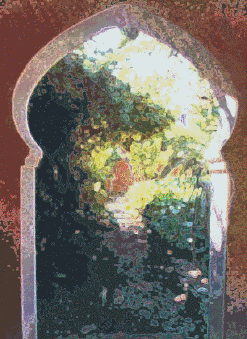|
Livre en ligne : La memoire vivante- Recits de l'age d'or sepharade
Envoyé par Dafouineuse
|
Livre en ligne : La memoire vivante- Recits de l'age d'or sepharade 03 août 2007, 06:15 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
LA MEMOIRE VIVANTE - RECITS DE L'AGE D'OR SEPHARADE
Deux annees de travail ont ete necessaires a l'elaboration de ce livre qui regroupe des souvenirs de personnes agees vivant actuellement a Montreal
A sa demande un chapitre sera propose tous les dix ou quinze jours.
Si vous voulez faire des commentaires cliquez ici [dafina.net]
Bonne lecture a tous

Modifié 6 fois. Dernière modification le 05/10/2018 10:52 par jero.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 03 août 2007, 06:18 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
"Souviens-toi des jours antiques, médite sur les annales de chaque siècle.
Interroge ton père il te l’apprendra, tes vieillards, ils te le conteront."
(Deutéronome 32-7)
De tout temps, le Bel Âge a su fasciner le monde des petits-enfants. Les grands-parents racontent mieux. Ils savent présenter leur expérience de la vie avec douceur et amour, telle une berceuse que l’on aime entendre encore et encore.
Les communautés sépharades qui ont connu le déracinement et l’immigration au cours des deux dernières générations, ont subi de nombreuses mutations linguistiques et culturelles. Les souvenirs de leur vécu s’adressent aussi bien aux grands qu’aux petits. Le cordon ombilical des attaches culturelles qui les relie au monde d’antan, met à jour un contexte dont on a souvent oublié les éléments constitutifs. Le lecteur est invité à extraire le nectar de la leçon de la vie dans ce bouquet de récits qui lui est offert. Il pourra apprécier l’expression d’amour et de dévouement qui se dégage des lignes de nos aînés.
Les membres du Bel Âge du Centre communautaire juif brossent avec sensibilité des tableaux de scènes pittoresques, propres à des époques et à des lieux appartenant désormais au passé. À travers leurs souvenirs d’enfance, par les portraits de personnages qu’ils ont connus jadis, ils décrivent les mœurs d’un monde quasiment inexistant dans le contexte actuel. Ils évoquent en même temps avec maestria leur adaptation à un climat et à des lieux radicalement différents de ceux de leur pays d’origine.
Qu’il me soit permis de rendre hommage aux écrivains du Bel Âge, tout particulièrement à Madame Sarah Arditti Ascher, qui a su compiler avec grand talent ce recueil de récits.
David Bensoussan

Modifié 2 fois. Dernière modification le 03/08/2007 06:47 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 03 août 2007, 06:20 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Partager un souvenir c’est livrer un peu de soi. Nous avons confié à ces pages des parcelles de notre vie, nous y avons ouvert les portes de notre mémoire, vivante parce que nous la portons en nous et qu’en la transmettant à travers la mémoire de nos enfants et de ceux qui nous écoutent et qui nous lisent, elle le demeure.
C’est avec un grand plaisir que j’ai entrepris ce recueil de témoignages vécus par les membres du Bel Âge. Il s’en dégage un respect inconditionnel envers nos aînés, envers la famille, le père, envers la mère pour son rôle irremplaçable au foyer et au sein de la société, ainsi que le respect des fondements de nos principes religieux.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont bien voulu partager avec vous, avec nous, avec nos enfants, des souvenirs chers. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont prêté leur précieux concours à ce projet, en particulier David Bensoussan pour sa confiance et son encouragement et Léon Benarrosch pour ses conseils et pour avoir bien voulu jeter un regard éclairé sur les textes. Je remercie spécialement mon époux, Élie Ascher, pour sa patience devant mes longues heures passées à la préparation de ce recueil.
La Rédactrice
Sarah Arditti Ascher

Modifié 2 fois. Dernière modification le 24/08/2007 06:34 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 03 août 2007, 06:30 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Nous habitions dans une petite ville tranquille du Maroc, près de la côte, dans un quartier où il y avait une grande mosquée et des écoles arabes. Notre maison était un rez-de-chaussée sans étage. Maman, restée veuve très jeune, y a élevé neuf filles. Tout y était d'une propreté méticuleuse. Nos portes étaient toujours grandes ouvertes, nous vivions sans aucune crainte. Tout le monde nous respectait. Maman recevait tous ceux qui venaient demander un verre de thé, un morceau de pain, Juifs ou Arabes. Nous n'étions pas riches mais elle partageait avec tous ceux qui avaient moins que nous.
" Madame Sara, peux-tu me donner à manger ? À boire ? " Elle les faisait entrer, les servait.
La maison était au coin d'une rue par laquelle on passait pour arriver au domaine d'un Caïd, on appelait ainsi les grands et puissants propriétaires arabes, au Maroc. Il avait deux femmes dont une métisse, et six enfants. Chaque femme avait sa maison avec ses dépendances, ses servantes, ses esclaves. Elles ne sortaient jamais. Elles pouvaient regarder les visiteuses arabes, jamais les étrangères ni les hommes, à travers les moucharabiehs.
Le Caïd, nous voyant si polies, si propres, en bon termes avec tous les Arabes du quartier, nous a permis d'entrer au palais, dans la maison des femmes. Nous nous sommes vite fait aimer non seulement des enfants mais aussi des servantes et des esclaves. Chaque enfant avait son esclave personnelle qui était à sa disposition, nuit et jour. Mes sœurs étaient mariées ou travaillaient. Une seule venait quelquefois avec moi. J'étais de l'âge des jeunes enfants et c'est surtout moi qui allais jouer avec eux.
Suivant la coutume orientale, les murs et les planchers étaient recouverts de riches tentures et de tapis. Il n'y avait pas de meubles, mais des guéridons bas, des tables basses rondes en superbe marqueterie ou en cuivre repoussé, des matelas et des coussins posés sur les tapis. Quand les serviteurs apportaient la nourriture, ils posaient les plateaux sur les tables basses. On s'asseyait tout autour sur les coussins, et on mangeait d'une main, sans couteau ni fourchette. Les esclaves apportaient ensuite des bols d'eau et des serviettes et on lavait la main avec laquelle on avait mangé.
Les esclaves étaient la propriété du maître, comme des objets. Il avait des esclaves blancs, hommes, femmes et enfants qu'on lui donnait en cadeau ou qu'il achetait, et il avait des esclaves noirs. Ceux-ci étaient tout au bas de l'échelle. Gare s'ils déplaisaient à leur maître ou à leur maîtresse ! Ils étaient cruellement punis, battus jusqu’au sang. Mon cœur saigne quand je pense à la manière dont ils étaient traités. Ils faisaient les plus gros travaux : le nettoyage de l’argenterie, des cuivres, le tissage de la laine, le gros ménage, la lessive, et en plus ils faisaient la cuisine pour tous. Une esclave avait la charge du thé, une autre, celle du café. Chacun ou chaque groupe avait sa tâche et sa place dans la maison et dans les cuisines, rôtir les viandes, préparer les légumes, faire les pâtisseries, qui l'occupait du matin jusqu'à la nuit. Il y avait tant de ménage à faire dans cet énorme domaine, tant de personnes à nourrir !
Les esclaves faisaient trois sortes de pain : du pain blanc pour le maître et ceux de son rang, pour sa femme et ses enfants blancs. Ils faisaient du pain brun pour la femme métisse et ses enfants, pour les serviteurs et les servantes, et du pain noir pour les esclaves, blancs et noirs. Ceux-ci cuisinaient une quantité incroyable de nourriture et l'apportaient sur d'énormes plateaux en cuivre ou en argent. Ils servaient les maîtres, les maîtresses et leurs enfants d'abord. Quand ceux-ci avaient fini, dans leurs appartements séparés, les plateaux passaient aux serviteurs. Les esclaves avaient droit aux derniers reliefs, c'est-à-dire aux sauces et aux os. S'il arrivait à l'une d'elles de déplaire à sa maîtresse ou à un des enfants, la chef des esclaves, une esclave elle-même, la battait sans pitié avec une lanière en cuir. Nous en éprouvions beaucoup de peine sans pouvoir rien dire et nous rentrions chez nous pour cacher nos larmes.
Nous étions enfants, mais nous n'avons jamais touché à leur nourriture, viandes ou légumes, à cause de la cacheroute. Ils nous aimaient tous pour ça parce qu'ils disaient que nous n'avions pas vendu notre religion. Nous mangions leur pain, nous savions qu'il n'avait pas de gras, leurs gâteaux, leurs crêpes et leurs moufletas, quand ils les servaient à l'heure du thé. Les esclaves aussi nous aimaient beaucoup. Elles voyaient notre peine quand on les punissait ; nous étions gentilles avec elles.
Quand les chameaux venaient, chargés de montagnes de produits de la ferme : lait et beurre, céréales, pommes de terre, fruits, toutes sortes de choses, les esclaves cachaient au passage sous les cages des escaliers des légumes, des fèves, des sacs de farine, du riz, du sucre, du thé, du miel, et tout ce qu'ils pouvaient détourner avant d'envoyer les marchandises à la cuisine. Il y en avait tellement que ça ne se voyait pas. Il fallait bien qu'ils mangent pour pouvoir travailler !
Ils savaient que ma mère partageait avec tous les pauvres du quartier. Ils lançaient de petits cailloux sur nos vitres, nous venions en cachette et ils nous donnaient de tout pour elle. Quand ils égorgeaient des agneaux pour leurs fêtes, ils nous donnaient des poules et des coqs vivants. Voilà votre part, nous disaient-ils. A cette époque, le sucre était introuvable, on manquait de tout. Mais grâce aux esclaves qui partageaient avec nous, nous ne manquions de rien. Ma mère nous envoyait chercher les pauvres l'un après l'autre et partageait aussi avec eux. Toutes les personnes du palais nous considéraient, mes sœurs et moi, comme faisant partie de leur famille. Je garde un merveilleux souvenir de cette époque.
Mon père est mort alors que j'étais toute petite. Quand je suis devenue adolescente - suivant la coutume de l'époque - mon oncle m'a cherché un mari. Il a invité chez lui un jeune homme de Casablanca. Celui-ci est venu quelques jours avant Pâque, pour me voir. Je lui ai plu. Il est retourné passer la fête chez lui, mais le soir de la Mimouna, il est venu demander ma main à mon oncle, puis il est reparti.
Nous nous sommes mariés quarante-cinq jours plus tard, après le 'Omer. En ce temps-là, les filles ne pouvaient qu'obéir et leur mariage était arrangé par leur parents. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. J'ai eu la chance d'être très heureuse avec lui et de l'aimer aussi. Il me disait : je vais t'apprendre à danser, je vais te faire voyager. Tu auras tout ce que tu désires. Il n'a jamais voulu que je travaille, m'a choyée jusqu'à son dernier jour. Je l'ai malheureusement perdu trop tôt.
Il voulait que nous nous installions chez lui après notre mariage, mais ma mère a demandé que nous restions quelques mois chez elle pour que j'apprenne à tenir un ménage. J'étais la plus jeune, je ne savais rien faire. Les femmes du Caïd m'ont fait de merveilleux cadeaux pour mon trousseau, des draps brodés, un tas de choses. Elles avaient fait tisser ma couverture de lit à la main, avec des pelotes de pure laine. Elles se préoccupaient de savoir si mon mari me rendait heureuse. Lui est devenu jaloux. Il ne voulait pas que j'aille dans la grande maison, car il ne pouvait pas y aller avec moi. Je montais sur notre terrasse pour qu'elles me voient - cachées derrière les rideaux - et se rassurent à mon sujet.
Nous sommes restés chez ma mère pendant trois ans, jusqu'à la naissance de mon fils aîné. Quand les femmes du Caïd ont su que j'allais partir à Casablanca, elles se sont mises à pleurer. Lui m'a appelée et m'a posé un tas de questions pour savoir si mon mari me traitait bien, s'il me rendait heureuse et si je voulais partir loin de ma famille et loin d'eux qui étaient aussi comme ma famille.
" Arrêtez de pleurer, elle est heureuse. Elle doit partir avec son mari, " leur a-t-il dit.
Ils n'ont jamais cessé de demander de mes nouvelles. Avec le temps, ils ont perdu tous leurs biens et sont tous morts l'un après l'autre. Seules deux filles vivent encore avec un petit-fils qui est un adulte, aujourd’hui. On va lui rendre visite quand on va en voyage au Maroc. Il nous dit que sa maison est la nôtre et que nous serons toujours les bienvenus.
Cela se passait dans les années quarante. Nous vivions en sécurité, entourés d'Arabes. Ils passaient devant notre maison pour aller à l'école ou à la mosquée. Notre porte était toujours ouverte. Nous avons toujours été très bien traités. Je garde un excellent souvenir de ces belles années au Maroc.

Modifié 1 fois. Dernière modification le 24/08/2007 05:13 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 10 août 2007, 02:55 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Je ne sais pas à quand remonte le Mellah de mon enfance, mais il avait grandi sans cesse au cours des ans et, au temps où j’y ai vécu, c’était devenu un état dans l’état. La religion, les superstitions et les innombrables interdits tissaient la toile de fond des actions de chacun. Les rabbins cumulaient les rôles d’enseignants, de juges, d’avocats, en plus de celui de chefs religieux.
Quand les Français sont arrivés, leurs écoles nous ont été ouvertes. Nos jeunes Juives et Juifs eurent alors accès à un nouveau courant de civilisation qui a influencé les traditions et habitudes de toute la communauté. Les parents, eux, ont vécu un changement qui a bouleversé leur vie, faite de dur labeur. Seul leur espoir dans la venue du Messie n’avait pas été ébranlé. Les naissances étaient nombreuses, les familles prolifiques, le Mellah semblant rétrécir au fur et à mesure que les naissances se multipliaient. Les enfants, dit-on, sont la richesse des Juifs, l’espoir de jours meilleurs. Malheureusement, la mort en fauchait son compte…
La porte principale du Mellah, cloutée de cuivre, était en ogive. Elle était surmontée d’une sorte de toit de roseaux avec des ouvertures en losange à travers lesquelles le soleil projetait sur le parterre grossièrement pavé, de curieux dessins abstraits. Plus tard, une toile imperméable grise allait remplacer ce joli toit. L’entrée était gardée par un mokhajni, qui, accroupi sur une peau de mouton dans son abri, sirotait sans arrêt un thé odorant. Des Juifs désœuvrés ne dédaignaient pas, à l’occasion, de jouer aux dames avec lui. Je me souviens de ce garde, Driss, et de son air terrifiant. C’était un géant au visage marqué par la petite vérole. On le disait juste et honnête et on avait recours à lui lors de disputes, de vols ou d’accidents. Il fermait cette porte à minuit, mais l’ouvrait pour les retardataires arrivant après cette heure, moyennant une pièce de monnaie. Ce contrôle semblait avoir pour but d’empêcher les Juifs de quitter leur quartier la nuit, et d’assurer par la même occasion leur sécurité. Mais comme la porte était dotée d’un garde, il était clair que nous n’avions pas à redouter l’entrée d’étrangers aux intentions malveillantes.
En passant sous l’ogive, on entrait dans la rue principale où, de part et d’autre, trônaient les changeurs de monnaies, d’or et d’argent. Il y avait un va-et-vient incessant. Des piétons, des bicyclettes, des charrettes chargées de marchandises, des mulets, des ânes, offraient un spectacle animé et pittoresque. Ceux qui portaient le costume indigène, les esquivaient de leur mieux, les pans de leurs djellabas relevés d’une main, le couvre-chef instable retenu de l’autre. La plupart des femmes portaient encore la coiffe et le costume traditionnels. Elles devaient être tout aussi alertes. Beaucoup d’autres avaient commencé à adopter les robes qui leur faisaient une silhouette informe, et portaient en guise de chapeau les cloches de feutre à la mode du jour. Les jeunes garçons, vêtus à l’européenne, portaient culottes courtes et bérets. Il y avait aussi des dandys en djellaba qui paradaient, pipe en argent aux lèvres, canne à la main et montre au gousset. Quant aux Arabes, ils portaient des vêtements clairs. Leur tête était recouverte d’un tarbouche rouge éclatant, d’un turban drapé avec art ou encore d’une calotte de fil crocheté.
En semaine, les Juifs ne se souciaient pas d’être particulièrement élégants. Par contre, le samedi et les jours de fête, les hommes sortaient des coffres chemise blanche, gilet orné de soutaches, et la djellaba de laine noire. Les femmes et les enfants portaient leurs habits de fête. Marrakech était comparée à une petite Jérusalem. Elle comptait beaucoup de rabbins éminents qui officiaient ou enseignaient dans les synagogues et les yeshivot (institutions d’études religieuses) qu’il y avait pratiquement dans chaque rue. Au début du service religieux et au moment où il se terminait, la foule des fidèles, composée d’un très grand nombre d’enfants, se déversait dans les rues. On ne peut pas imaginer le Mellah sans eux. Pas un magasin, pas une boutique n’ouvrait ses portes ces jours-là. Les Arabes qui partageaient notre vie, bonnes et domestiques qui vivaient chez nous, rentraient chez eux le samedi pour leur congé hebdomadaire.
Une autre période de grande animation était celle de la fin du Ramadan, alors que les Arabes venaient faire leurs emplettes au Mellah. Après les salamalecs d’usage, on discutait ferme les prix, devant une tasse de thé. Du reste, le marchandage est un art où le meilleur l’emporte, même si ce n’est que de quelques sous. Pour le vendeur et l’acheteur, l’honneur est sauf. Respect à ceux qui savent vendre et acheter ! Le porteur d’eau, coiffé d’un énorme chapeau de paille garni de pompons rouges et verts, passait. Il vendait son eau fraîche dans des timbales de cuivre étincelant.
Laborieuse, la population du Mellah comptait des commerçants, de nombreux artisans qui travaillaient chez eux ou qui avaient leur propre échoppe. Beaucoup sortaient du Mellah en journée, travaillant pour des maisons d’importation ou pour d’autres entreprises, et partageant même des commerces avec des Arabes.
C’est après la première longue rue commerciale que commençait réellement le Mellah. Une arcade ornée d’une mezouza à l’entrée de cette deuxième rue, luisait du contact de tant de mains pieuses. On disait que là-dessous, avait été enterré Rabbi Mordekhai Ben Attar (ou des objets lui ayant appartenu). On assurait que depuis, aucun ennemi n’avait pu franchir ce passage et nuire aux habitants. Dans cette rue, se traitaient les affaires de gros. D’immenses rez-de-chaussée servaient d’entrepôts, tandis que les premiers étages, spacieux et confortables, entourés de l’inévitable balustrade intérieure en bois ou en fer forgé, possédaient eau courante et électricité. Les terrasses sur les toits étaient les lieux de rencontre de prédilection et les familles et les amis s’y réunissaient les soirs d’été. À part celles des riches, les maisons étaient si délabrées qu’on ne pouvait croire qu’elles avaient jamais été nouvelles.
Dans l’immense quartier de la Kessaria, des dizaines de boutiques vendaient entre autres denrées, des épices, des fruits secs, des herbes et de la verroterie. Nous venions faire nos achats dans cette Kessaria qui, quelques années plus tard, allait faire l’objet d’un incendie qui dura une semaine. D’autres rues suivaient dans lesquelles des maisons alternaient avec des boutiques de fournitures scolaires, des ateliers de fileurs de soie haut perchés avec des magasins de chaussures, des boutiques d’articles en cuir avec celles de cristaux importés. On arrivait ensuite à une fontaine qui déversait son triple jet d’eau dans des bassins de pierre. L’eau de Marrakech provient des sources qui naissent dans les montagnes de l’Atlas. Elle est d’une pureté sans pareil.
En continuant, on débouchait sur le marché, où, dans l’air vibrant et surchauffé de l’été, légumes et fruits se couvraient d’une nuée d’abeilles ou de mouches que les marchands chassaient inlassablement à l’aide de larges éventails de paille tressée. Le marchand de zabane, sorte de sucre filé jaune, blanc ou rose, débitait sa marchandise en chantant. Le marchand de bric-à-brac vendait à la criée des meubles mutilés, des bibelots ébréchés, des couverts dépareillés, des vieux vêtements. Des courtiers brandissaient à bout de bras couvertures de laine ou tapis, neufs ou vieux.
Dans la rue des écoles appelée rue du Tajr Ichoua, les maisons étaient meublées avec luxe. Mais à l’entrée de la rue, dans sa boutique, le marchand de charbon montrait un visage triste, comme si tout le noir qui l’entourait avait déteint sur son âme. Une fois ses clients servis, il se replongeait dans les pages d’un livre maculé de suie. Ce travail misérable n’empêchait pas que cet homme fût juste et versé dans le Talmud. Dans les épiceries, les sacs de jute contenaient sucre, thé, céréales. Par ailleurs, il était également possible de se procurer du pétrole et du carbure. Beaucoup de maisons étaient éclairées aux bougies, au carbure ou aux lampes à pétrole.
La poussière des chaussées sommairement pavées desséchait la gorge en été alors que, dans certaines rues, la boue stagnait en permanence l’hiver. Le plus désagréable était le mauvais fonctionnement des égouts. Il fallait attendre l’été pour les réparer. On creusait alors les rues sur toute leur longueur. L’accès chez soi n’était possible qu’en passant sur des planches branlantes posées de part et d’autre du fossé. L’habitude de ce danger avait assoupli nos membres et entraîné notre équilibre. Grands et petits s’enhardissaient à traverser les rues en courant sur ces planches brinquebalantes.
Plus on pénétrait vers l’intérieur du Mellah, plus les odeurs étaient intenses. Des marchands de beignets étaient accroupis devant un foyer qu’un enfant alimentait en bois. La forte odeur de friture se mélangeait à celle qui annonçait les grillades de viandes et de foie. Celles de poissons, d’olives, de carottes, oignons et autres légumes marinés, de câpres en conserve, attiraient par la promesse d’un goût acide. Rue après rue, toutes sortes de boutiques offraient toutes sortes de marchandises. Le pittoresque de la vie si intense du Mellah préservait de l’ennui. Les rues adjacentes que l’on gravissait par de larges marches, étaient bordées d’échoppes de cordonniers, de mirandiers, de chaudronniers et même de raccommodeurs d’ustensiles en terre cuite. C’est dire que l’argent à cette époque était rare et la misère présente.
Ensuite, venait le cimetière, immense, austère. Des petites chambres étaient mises à la disposition de malades venus " faire la semaine ", c’est-à-dire y habiter sept jours et nuits, et prier avec une ferveur qui permettait d’espérer une guérison prochaine. Je soupçonnais ces retraites d’être une sorte de répit, surtout pour les mamans écrasées par leur charge. Elles confiaient leurs enfants à leur famille, et allaient reprendre des forces et s’armer de patience. Il y avait aussi, hélas, de grands malades. Je connaissais ces lieux pour y avoir passé quelques nuits avec une parente malade, de ces nuits noires où les chacals hurlaient au fond du cimetière et où je craignais de voir les morts ressusciter. Malgré ma peur, j’aimais ce noir troué de place en place de lueurs vertes, de lucioles que les Anciens prenaient pour des âmes. De l’autre côté du cimetière, à une courte distance, commençait le grand parc de l’Agdal. Là se trouvaient les écoles, une pour les filles et une pour les garçons.
Les Juifs ont depuis malheureusement quitté le Maroc par milliers. Le Mellah de Marrakech n’est plus aujourd’hui ce qu’il fut. Mais je n’ai qu’à remuer mes souvenirs pour retrouver la nostalgie de ce lieu privilégié de mon enfance.

Modifié 3 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:37 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 17 août 2007, 06:17 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
J'ai toujours été une bonne élève, mais j'ai eu le malheur d'avoir, en classe de seconde, une directrice méchante et vindicative. Comme les professeurs avaient le droit de corriger les enfants, et cela, non seulement au Maroc mais je crois partout ailleurs, celle-ci ne s'en privait pas.
Elle est venue un vendredi dans ma classe avec quantité de paquets de laine et d’aiguilles à tricoter. Elle a mis sur chaque pupitre des écheveaux et une paire d'aiguilles. Arrivée devant moi, il ne lui restait plus d'aiguilles. Je n'ai eu que de la laine.
Elle nous a dit : " Vous allez chacune tricoter un chandail pour les soldats. Je vous donne huit jours pour le terminer, vous l'apporterez vendredi prochain."
J'étais trop timide pour lui dire que mes parents ne pouvaient pas me donner de quoi acheter des aiguilles à tricoter. J'étais très malheureuse et ne savais que faire. En sortant de l'école, j'ai rencontré mon professeur de troisième qui m'aimait beaucoup. Elle était en congé de maternité et passait devant l'école. Je lui ai dit mon problème. Elle a sans doute pensé que c’était à la directrice de me procurer, comme aux autres, des aiguilles et m'a dit: " Tu rapporteras la laine sans la tricoter et tu lui diras que c'est parce qu'elle ne t'a pas donné d'aiguilles." J'étais sans malice et n'ai pas pensé que c'était un mauvais conseil.
La semaine suivante, chaque élève a mis un chandail sur son pupitre et moi j'ai mis la laine. Elle a ramassé les tricots, les a posés sur le bureau et m'a appelée.
" Pourquoi n'as-tu pas tricoté un chandail comme toutes les autres? "
" Madame, je n'avais pas d'argent pour acheter des aiguilles. "
Elle portait une bague avec une grosse turquoise. Elle a tourné la pierre vers la paume de sa main et m'a envoyé deux gifles qui m'ont fait tomber par terre. Ensuite, elle s'est mise à me donner des coups de pied. Tout endolorie, je me suis relevée, pleurant à grosses larmes, le visage enflé, les yeux rouges. Mes amies ont pris mon cartable et m'ont accompagnée chez moi. Quand Maman m'a vue, elle a été horrifiée. Elle m'a soignée, m'a donné un cachet et je me suis couchée. Elle m'a dit : "Tu n'iras pas à l'école, demain. "
Quand ma grande sœur est rentrée du travail, et qu'elle a appris ce qui m'était arrivé, elle a été révoltée. Elle a décidé d'aller dès le lendemain se plaindre au directeur.
Le lendemain, nous devions faire une composition. Très bonne élève, je n'ai pas voulu m'absenter. Je suis sortie de la maison sans que Maman me voie et je suis allée en classe, malgré mon visage enflé, égratigné et tout bleu. Ma sœur est arrivée à l'école, a fait comparaître la directrice devant le principal, et l'a menacée de l'accuser au ministère de l'éducation, à Rabat.
"Vous n'avez pas le droit, lui dit-elle, de lever la main sur une enfant pour quelque raison que ce soit. D'autant plus qu'en ce cas, elle n'a rien fait de mal. Vous ne lui avez pas donné d'aiguilles. Elle est malade, elle a de la fièvre, elle est alitée à cause de la manière dont vous l'avez battue. "
"Elle m'a défiée. Elle m'a manqué de respect. Elle aurait pu me demander des aiguilles. "
Moi, en toute innocence, j'avais suivi le conseil de mon professeur de l'année précédente. Si j’avais été à sa place, j’aurais donné quelques sous pour une paire d’aiguilles, j’aurais conseillé d’aller parler à la directrice. Elle la connaissait mieux que moi. De toute évidence, son conseil n’avait pas été le bon. La directrice a fini par présenter des excuses, mais m'a gardé une rancune qui m'a coûté cher.
Après le départ de ma sœur, la directrice est rentrée dans ma classe et a été surprise de me voir en train de faire la composition. Elle a dit : "Édéry, votre sœur m'a menti ! " avant de sortir, le visage blanc de colère. Qu'est-ce qui allait encore m'arriver !
Rien, du moins pas pour quelque temps. Mais elle ne m'avait pas oubliée. A la fin de l'année, la directrice est venue lire les noms des élèves qui passaient en première. J'étais parmi les trois meilleures élèves de la classe. Mais quand mon tour est arrivé, elle a sauté mon nom. Au grand étonnement de toute la classe et à mon grand désespoir, j'étais parmi celles qui allaient redoubler. Je me suis mise à pleurer à grosses larmes devant cet abus de pouvoir. Je suis allée chez le professeur qui m'avait donné un si mauvais conseil pour lui dire ce qui m'arrivait.
"Tu ne redoubleras pas, je te prendrai plutôt dans ma classe et tu feras le programme de la première sous ma direction. " Elle est allée ensuite parler au principal. Il a fait venir la directrice, ils ont discuté longuement tous les trois, et finalement, je suis passée en première.
À la fin de l'année, nous sommes allées chercher nos actes de naissance afin de nous inscrire pour les examens du certificat d'Études. Je l'ai fait, j'ai réussi aux examens. Je ne pensais plus à l’incident des aiguilles et j’étais présente le jour de la remise des certificats, heureuse et fière de l’avoir mérité. Quand mon tour est arrivé, je m’avançai pour le recevoir.
"Non, mademoiselle, me dit la directrice, un grand sourire aux lèvres, vous ne l'aurez pas, votre certificat. Vous êtes punie ! Vous allez redoubler. J'ai dit que vous alliez redoubler la deuxième, vous avez passé malgré moi, vous redoublerez la première. Vous n'aurez pas votre certificat cette année. "
Je vois encore dans ses yeux l’expression de satisfaction. Elle se vengeait enfin. Je n’oublierai jamais ce que j’ai éprouvé à ce moment. J’étais tellement saisie que je n’ai pas pu dire un mot.
Le jour de la distribution des prix j'ai eu le prix d'honneur, je l'avais mérité car j'étais une excellente élève. Mais je n'ai pas eu mon certificat. Il m'a été accordé, mais elle l'a retenu voulant m'obliger à doubler l'année.
Je sais que le Maroc n’était pas le seul pays où les professeurs pouvaient se permettre de battre les élèves. Heureusement que les enfants sont traités de nos jours comme des personnes ayant des droits. Je raconte cette injustice pour rappeler aux élèves d'aujourd'hui qui protestent contre des mesures de discipline, contre des règlements, combien nous étions dominés par les professeurs. Ils pouvaient impunément nous battre ou nous faire redoubler. Sous prétexte de corriger et de punir, certains abusaient de leur pouvoir. Ils nous laissaient dehors dans le froid pour peu que nous arrivions en retard, nous frappaient sur les doigts avec une règle en fer, nous battaient, nous humiliaient, nous mettaient des bonnets d'âne. Nos parents étaient souvent illettrés, les filles restaient à la maison à coudre et à broder. L'éducation n'était pas obligatoire, n'était pas jugée importante pour elles. On les mariait jeunes, souvent à peine sorties de l’enfance. Mes deux sœurs et moi, qui avions étudié jusqu'au certificat, l'avions fait parce que nous l'avions voulu. Nos six sœurs - nous étions neuf filles - sont restées à la maison.
Je n'ai jamais eu ce certificat car j'ai refusé de donner à la directrice la satisfaction de me faire perdre une année de ma vie. Mes parents auraient pu le réclamer au Ministère de l'Éducation, j’avais réussi aux examens, j’y avais droit. Elle l’avait sûrement reçu et gardé dans un tiroir. Mais ils ne parlaient pas français, ils luttaient pour faire vivre leurs enfants. L'autorité de l'école était indiscutable. Ils n'ont pas su quoi faire.
Au fond, le certificat, c'est juste une feuille de papier que je n'ai pas eue. Je sais que je l'ai mérité. Il est à moi.

Modifié 2 fois. Dernière modification le 24/08/2007 05:10 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 24 août 2007, 06:41 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Pourim est la fête la plus gaie et la plus fantaisiste des fêtes juives. Ce jour là les enfants sont libres de déambuler du matin au soir dans un Mellah plus effervescent que jamais avec les quelques sous de la krada reçue des parents, grands-parents, oncles et tantes. Ils se sentent riches et libres d’en disposer comme bon leur semble.
De bonne heure, on a rafraîchi à grande eau puisée à la triple fontaine de Derb el Souk, les rues balayées la veille. Des deux côtés de la rue et sur les étals, chaque marchand a garni sa table avec ses spécialités et au gré de sa fantaisie : rochers de nougat blanc parsemé de cacahuètes, rochers bruns de graines de sésame, d’amandes et de noix, de grands bouquets de sbakya, gâteau façonné comme une dentelle et passé au sirop de miel, makoud à base de semoule, de noix, de raisins secs, le tout parfumé au gingembre, gâteaux de coco rose et blanc, bref tout ce qui flatte l’œil et met l’eau à la bouche. Notre préférence va à David qui a enfilé sur de fines tiges, tel un bouquet de fleurs, ses oiseaux de sucre translucides, rouges verts et jaunes, et qui sifflent. Il crie et chante à tue-tête : " C’est moi qui les fais, c’est moi qui les vends et c’est ma femme qui encaisse l’argent ! "
Tout de blanc vêtu, Moussa, un géant noir qui fait partie du Mellah, brandit tel un drapeau, un gros roseau sur lequel est enroulé le zabane couleur de rêve, élastique et sucré, qui dure et dure sous nos jeunes dents. Puis vient le marché de fruits secs avec, étalés à même le parterre sur des nattes tressées, les dattes mielleuses d’Algérie, dattes vertes et dures de Bouscoura, dattes fripées et mûres soudées entre elles, les noix dans leur coque couleur bronze, les amandes dans leur robe verte, le fruit du palmier appelé Khbata, aux fines tiges brodées de grains blancs et croquants de sa racine appelée zmmar, des cacahuètes jumelles dans leur écales, des raisins secs qui vont du noir au brun en allant jusqu’au caramel. Suivent les fruits frais aux couleurs éclatantes : oranges, mandarines, petites pommes rouges et poires vertes, qui donnent aux trottoirs une allure de fête. Sur la Place des Poissonniers nettoyée et lavée a été dressée la tombola tenue par trois frères que l’on avait surnommés les frères poli rouge poli vert et poli jaune, en se référant à la couleur de leur polo.
Avec quelques centimes, nous avions droit, lors des jeux de hasard, à gagner une bagatelle sous forme de crécelle, d’un jouet en bois, d’une poupée de chiffons fort laide et que nous trouvions adorable, de verres, ou de vases. Dans la rue, le bruit est infernal. Quelques garçons déguisés en Mordekhaï ou en Assuérus et des fillettes en Esther font tourner des crécelles ajoutant à la cacophonie des crieurs. Repus de couleurs et de jeux, nous rentrons. Les mères qui ont jeûné la veille de Pourim, ont passé toute la journée à préparer des gâteaux aux noix, aux amandes et aux graines de sésame, des galettes sucrées, des cakes dont on a battu les œufs à l’aide d’un fouet ou même de deux fourchettes (le mixer n’existait pas alors) des fadouelos (pâte découpée en lanières que l’on roule savamment et que l’on fait frire dans un bain d’huile pour les enrober par la suite de sirop de sucre et les saupoudrer de cannelle).
La tradition veut que chaque maison, si pauvre soit-elle, envoie à la famille, aux voisins et parfois à des fiancés, un plateau de gâteaux décoré par des colifichets, des bijoux, des parfums, des dattes et des bonbons. Ce plateau leur sera retourné garni de gâteaux à peine différents et à base de mêmes ingrédients. L’enfant qui jeûne pour la première fois a droit à un verre de lait chaud dans lequel la mère a laissé tomber une bague en or. Quand viendra le temps de faire la lecture traditionnelle de la Meguila d’Esther, nous chahuterons en tapant avec des cuillères sur la table au seul nom de Haman !
Le Mellah est constamment en effervescence, les habitants sont vifs, bouillonnants d’énergie et parfois hâbleurs. Le théâtre se déroule du reste dans la rue. La journée de Pourim prend vite fin, bien que l’ennui, ce sournois qui démesure et éternise le temps, soit habituellement inconnu au Mellah.

Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:37 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 28 août 2007, 11:56 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Alors que nous étions adolescentes, c'est avec beaucoup de plaisir que mes deux sœurs et moi aidions maman à préparer la maison pour la fête. Un des premiers préparatifs, à l'approche de Pâque, était le cardage de nos matelas. Ma mère se faisait un devoir de les défaire, d'en laver la laine, de la mettre à sécher. Elle la faisait ensuite carder par une aide avant d’appeler le matelassier. Quand l'année était prospère, il venait les refaire avec un coutil neuf, à ramages bleus et blancs. Venait ensuite le travail de la cacheroute. La maison était nettoyée de fond en comble, chaque coin et recoin lavé et astiqué après que le peintre eût passé une couche de peinture sur les murs et parfois aussi sur les portes.
Ma sœur et moi montions ''cachériser'' le grenier où il n’y avait que des vieilles reliques, des ustensiles au rebut, des berceaux boiteux. Nous y trouvions des choses étonnantes, parmi lesquelles des dames-jeannes, ces bouteilles pansues à moitié recouvertes de paille tressée, et un tas d’objets dans un amoncellement digne d’une boutique de brocanteur. Parmi ces objets, il y avait des bottines en cuir aux petits boutons montant jusqu’aux genoux, et le petit crochet pour le boutonnage. Ma mère les avait délaissées un jour pour des souliers plats et même des babouches. Auparavant, les femmes portaient le foulard brodé et coloré, le haïk, ce somptueux châle espagnol en soie richement brodée ton sur ton, qui faisait de chacune d’elles une reine. Mais elles commençaient à se mettre à la mode européenne, dans ces robes informes garnies d’un col et de manchettes blancs. Elles couvraient leurs cheveux, pour sortir, de ces cloches de feutre qui ne les embellissaient pas.
Nous balayions le grenier et nous descendions nous laver pour nous débarrasser de la poussière. Mon père entre-temps avait apporté des oranges à la peau épaisse que ma mère s’activait à râper pour en faire de la confiture. Ah ! l’odeur suave qui se répandait dans toute la maison ! Il me suffit de l’évoquer pour la sentir aujourd'hui.
La vaisselle habituelle était lavée et gardée dans un placard spécial. Nous prenions nos repas dans une petite chambre et n’avions pas le droit de faire entrer le pain ailleurs dans la maison. Une année, le Séder était tombé un samedi soir et la veille, ma mère avait préparé une table basse sur une natte de paille. La douce flamme de la bougie du chabbat éclairait la petite pièce. Mon père, peu habitué à manger ainsi, fait un mouvement brusque et voilà la bougie qui tombe. La natte prend feu. Il me prie aussitôt de ramasser la bougie tandis que ma mère me crie de ne pas la toucher, car c’est chabbat. N’écoutant que ma logique enfantine, je ramasse la bougie et éteins le feu déjà prêt à dévorer la natte.
Ma mère avait congé le samedi, qu'elle consacrait à la synagogue. Nous étions alors chargées, ma sœur et moi, de sortir tout ce qu'elle gardait pour la fête : draps, - parfois elle en préparait de neufs - taies d’oreillers que nous avions brodées à la main, nappe blanche pour le Séder, couverts et vaisselle gardés chaque année pour Pâque.
Pour nous, c’est un plaisir que d’arranger la maison à notre goût afin que tout ait l’air neuf et harmonieux. Plus de pain. Nous mangeons le repas de midi du samedi, la dafina, où n'ont cuit que des pommes de terre, des œufs et un bout de viande. Enfin, c’est le Séder Tous les enfants sont habillés de neuf. Mon père a revêtu la zokha, un caftan russe de laine brune, sur ses vêtements. Quelle allure !… J’adorais mon père et ne pouvais le lui dire. La pudeur du geste et des mots était de rigueur dans les familles. Il me suffisait de sentir sa main sur ma tête quand il me bénissait, pour me sentir heureuse et en sécurité.
Nous mettons la table avec ses bougeoirs de cuivre étincelants, son couvert spécial de Pâque, le panier d’osier garni de petites roses odorantes pour le bibhilo. Enfin, après les souhaits de bonne fête, chacun prend sa place. Mon père, appuyé sur des coussins, comme c’est la coutume, entame, de sa belle voix grave, la Haggada qui relate l’exode de nos ancêtres du pays d’Égypte où ils étaient esclaves. Mon grand frère traduit le récit en français, l’hébreu des plus jeunes étant rudimentaire. On fait circuler le panier de roses au-dessus de nos têtes, pour le bibhilo chanté en araméen, et ma mère lance un timide youyou. Le plateau du Séder est découvert sur les denrées symboliques : un os d'agneau, un œuf bouilli que l’aîné devra manger le lendemain, des herbes amères sous forme de céleri et enfin, ce que nous les enfants, attendions, le harosset. Ma mère a préparé le mélange de figues et de dattes hachées, de noix, de raisins secs, le tout écrasé dans du vin doux. Il symbolise le mortier des briques fabriquées par nos ancêtres lors de leur esclavage en Égypte. Ma mère, comme toujours, marmonne entre ses lèvres des prières pour nous préserver du mauvais œil, ce sournois à qui nous reprochions toutes les avanies et les misères du monde.
Je souhaite que ce moment merveilleux dure et dure. Mais tout a une fin, même le Séder. Après le souper, repus et fatigués, nous sommes prêts à nous coucher. Nous savourons le fait que durant huit jours, la fête de Pâque nous donnera d’autres plaisirs, parmi lesquels celui d’étrenner de nouveaux vêtements et de nouveaux souliers.
Pâque, renaissance du printemps, Pâque qui rénove les cœurs, fête sublime que je retrouve chaque année avec joie.

Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:38 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 31 août 2007, 06:25 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Que de bons souvenirs je garde de cette fête et des préparatifs qui la précédaient, de la merveilleuse insouciance de notre jeunesse et de notre enfance !
À Fès, tout de suite après Pourim, on commençait déjà les préparatifs de Pessah. On nettoyait à fond un coin de la maison et on y mettait de grandes tables qu'on recouvrait de draps blancs. On versait dessus, pour le trier, le grain qui allait servir, une fois moulu, à préparer les galettes de Pessah. On les faisait chez nous.
Le service de la cacheroute ''cachérisait'' le four communautaire. On préparait sa matzah, pain azyme, chez soi. Chaque maison avait son jour pour la cuisson au four. Nous attendions notre tour, mes frères et moi, avec impatience. Nous adorions nous plonger dans cette atmosphère de préparatifs traditionnels qui faisaient du Mellah une ruche bourdonnante et active.
Nous aidions tous ma mère pour le grand nettoyage, faisant en dernier le badigeonnage du sol à la chaux. Une fois sec, le carrelage devenait d'une blancheur éclatante. Ensuite, c’était le tour des achats des fêtes. Je vois encore ces gros paniers qui revenaient du marché, débordant de beaux fruits aux couleurs éclatantes et de légumes tout frais. Je vois encore les grosses fèves, les beaux citrons mûris au soleil, grands comme des oranges, les quatre ou cinq sortes de menthe fraîches cueillies qui dégageaient leur arôme sublime. Il faut dire qu'en avril, c'était déjà le printemps à Fès. J'ai le souvenir de tous les parfums des fleurs qui embaumaient l'air et surtout de celui de la fleur d'oranger.
Ma mère commençait par confectionner le harosset. Ensuite, elle mettait à mijoter les bons plats traditionnels de la fête. Nous mangions des légumes et des fruits toute l'année, mais ces jours-là, ils avaient un goût particulier. Quelle bonne odeur que celle qui se dégageait des marmites spécialement réservées pour la soupe au kasbour, aux feuilles de coriandre fraîches ! Venait enfin le tour des préparatifs du Séder; nous lavions les belles salades romaines, le céleri, préparions tout ce qu'il fallait pour garnir le plateau.
Nous célébrions la fête, entourés de nos parents, de nos amis et de tous nos proches et formions ainsi une grande famille. Nous n'avions pas beaucoup de moyens, notre union était notre grande richesse. Nous étions heureux. La chaleur humaine et la sincérité qui nous entouraient nous réchauffaient le cœur.
Les jours passaient vite. Pour clore la semaine, on célébrait la Mimouna. Maman avait travaillé pendant des journées avec l'aide de ses grandes filles. Je la revois encore, assise par terre sur un petit matelas carré, la grosse terrine devant elle, préparant la moufleta, travaillant sans s'arrêter une seule minute. Elle avait tout caché avant la fête dans un endroit écarté de la maison, spécialement préparé pour recevoir les produits hametz (fermentés). Le soir de la Mimouna demandait de longs préparatifs. La table avait un aspect spécial, comme le voulait la " 'Ada ", la coutume. Il y avait le poisson cru traditionnel, le petit lait, le zabane, le délicieux fondant blanc comme neige. Il y avait des herbes, des confitures, toutes sortes de petits fours ainsi que des pâtisseries plus délicieuses les unes que les autres.
Les visiteurs commençaient à affluer criant "terbho!", que vous gagniez ! Les uns entraient, les autres sortaient, dans un va-et-vient incessant. Les enfants couraient partout. Les invités, c'était la famille, les voisins, les amis, même les gens de la rue. Il y avait une animation et une ambiance uniques.
C'est ainsi que j'ai vécu la Pâque de mon enfance. J'en garde un merveilleux souvenir.

|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 07 septembre 2007, 06:58 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
C’est la Mimouna, le soir qui marque la fin de la Pâque juive. Sur la place, devant la porte du nouveau Mellah de Marrakech, les Fatmas se sont installées. Elles ont mis sur des nattes de jonc tressé, des jattes d’eau fraîche où flottent des mottes de beurre, des pots de petit lait à côté de menthes variées, des alvéoles de miel, des fleurs et des boutons de fleurs d’oranger. Elles vendent aussi des fèves vertes car elles savent que nous les piquons dans des bols de farine avec des pièces de vieilles monnaies pour que l’année commence dans la douceur et l’abondance. Le va-et-vient est incessant. <br>
À l’intérieur du Mellah, femmes revêtues de caftans brodés de fils d’or et de soie, hommes coiffés du tarbouche rouge en forme de pot de fleurs renversé garni d’un gland de soie noire, animent joyeusement les rues. Ils vont de maison en maison souhaiter de retentissants Terbhou ou ts'dou, joie et prospérité et goûter la 'Ada traditionnelle, la moufleta, cette crêpe fine garnie de beurre et de miel et recevoir la bénédiction du maître de la maison.<br>
Chez mon amie, au milieu d’une grande table dressée, sa maman a mis un poisson frais sur un lit d’herbe. De riches commerçants arabes associés de son père viennent, accompagnés de domestiques qui portent des plateaux garnis d’offrandes : beurre, miel, lait, pain frais et de magnifiques fleurs. La table croule sous les friandises. Un violoniste et un joueur de 'ud, luth marocain descendant du luth arabe, rythment une musique classique andalouse qui donne à la soirée un air de fête. On se croirait presque à un mariage. Je retourne chez moi. Je vais dormir après la bénédiction de mon père car demain la journée sera longue.<br>
Tôt le matin, Maman nous réveille afin de l’aider à laver la maison et à ranger les ustensiles de Pâque. Après notre toilette, elle nous asperge les pieds d’eau fraîche, symbole de pureté. Riche de quelques piécettes, je me hâte d’aller rejoindre mon amie Esther. En route, un monsieur qui connaissait sûrement ma famille, on se connaissait tous au Mellah, me tend un bouquet de roses rouges, pose sa main sur ma tête et me bénit. Sur le moment, l’enfant n’a pas conscience de l’élégance gratuite de ce geste. Plus tard, en y repensant, je l’ai remercié avec ferveur.<br>
Quand j’arrive chez Esther, sa maman nous remet un panier garni de galettes, de noix, d’oranges et de biscuits. Aujourd’hui, nous irons en pique-nique à la Ménara, immense jardin qui fait partie du plus beau parc de Marrakech, l’Agdal. Son immense bassin me fascinait, me faisait penser à la mer. Je ne la connaissais pas encore, moi qui allais plus tard habiter Mogador. <br>
La matinée s’avance. Le soleil habille de lumière une Marrakech coiffée d’azur. Des familles envahissent les rues, traînant enfants, portant paniers et même tapis et coussins. Premier plaisir, nous payons de quelques piécettes notre place et montons en calèche en compagnie d’un couple et de leurs deux enfants. Les belles couleurs du printemps, le bruit des sabots sur la route, la mine épanouie de tous nous promettent une journée fabuleuse. Nous arrivons à l’Agdal. Sur la place stationnent calèches, autobus et même des automobiles. A l’entrée du parc, un garde coiffé d’un chiche, coiffe ronde en feutre rouge, et ceint d’un sabre, nous reçoit avec un large sourire de bienvenue. Nous nous engageons à pied dans les allées. De part et d’autre, des arbres centenaires font une voûte de verdure. Des orangers, des citronniers, des oliviers dégagent une odeur suave. Quelques familles ont déjà étalé tapis, matelas et coussins. Le père allume fourneau à charbon - pour griller la viande plus tard - et réchaud à pétrole pour l’eau du thé. La mère a préparé sur un plateau de cuivre étincelant les verres à thé, les menthes variées ainsi que les gâteaux secs. Ils invitent les passants à déguster un verre de thé et à faire la conversation. <br>
Enfermés dans ce vase clos qu’était le Mellah, les Juifs se défoulaient par le rire. L’humour judéo-marocain est malicieux. Il est pratiqué envers soi-même. Se moquer de soi a quelque chose de salutaire. Des injures bien senties, des quiproquos et des proverbes, font rire des générations de jeunes et de vieux. Des balançoires sont accrochées aux arbres et les enfants ravis se font pousser de plus en plus haut. Une bonne femme manchote qu’on appelait Mira Abou, accompagne comme d’habitude des enfants et chante d’une voix puissante des krobyas, ces airs typiques marocains, et de joyeuses ritournelles. <br>
La journée s’étire en divertissements. Un gramophone, tourne-disques à manivelle, débite d’une voix nasillarde des airs de Lucienne Boyer, Rina Ketti et surtout Tino Rossi, très en vogue à cette époque. Plus loin, un orchestre de musiciens juifs et arabes joue des ksidas, interminables mélopées accompagnées de chansons hilares où il est question de la femme grosse et de la femme maigre, de la femme blanche et de la femme noire. <br>
L’odeur des grillades attire grands et petits qui attaquent, l’appétit aiguisé par le grand air, le repas de midi. Il y a des cousins, des parents, des amis de nos familles. Nous sommes invitées à partager leur repas. Nous sommes timides mais nous savons qu’il serait malséant de refuser. On insiste pour nous garder mais nous avons des ailes aux pieds. Nous allons faire le tour du bassin. <br>
Vers quatre heures, le soleil s’éteint d’un coup, le ciel se couvre de nuages menaçants, le tonnerre remue ciel et terre, les éclairs zèbrent le ciel. On réunit rapidement les enfants, on ramasse ses affaires et on court se réfugier dans une grande maison en face du bassin que le gardien ouvre à notre intention. Les ordres ont dû venir de très haut pour que notre journée se passe sans ennui. La pluie se déverse soudain à pleins seaux, furieuse. Les enfants sont enchantés de cet intermède qui donne plus de piquant à cette journée. <br>
La pluie cesse au bout d’une heure et la nuit, qui tombe d’un coup en Afrique du Nord, nous oblige tous à rentrer. On se quitte en souhaitant comme tous les ans et à toutes les fêtes : l’an prochain à Jérusalem. <br>
Nous parcourons en calèche, mon amie et moi, le chemin du retour et rentrons chez nous. Pour moi, le souvenir de cette journée est resté marqué d’une pierre blanche parmi mes souvenirs d’enfance.

Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:39 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 16 septembre 2007, 12:50 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Les us et coutumes propres au mariage au Maroc et plus particulièrement à Fès, au début du siècle ont encore cours aujourd’hui dans certains milieux juifs traditionnels. Certaines familles perpétuent encore de nos jours, ses magnifiques traditions. <br>
Au premier jour de Chavou'ot, nous lisons la Kétouba, acte, contrat de mariage entre D et son peuple et c’est de là qu’a été instauré le contrat de mariage, lu à la synagogue pendant la bénédiction nuptiale. La plus grande mitsva de la vie est le mariage, c’est d’elle que vont découler toutes les autres mitzvot : Brith Mila et Bar Mitzva.<br>
Jusqu’à la fin du siècle dernier, les parents avaient hâte de marier leurs enfants très jeunes, les filles entre 10 et 12 ans et les garçons entre 14 et 16 ans. Ils pensaient ainsi éviter à leurs jeunes garçons la connaissance d’une autre femme que leur épouse légitime. Le mariage se décidait entre parents sans que les futurs conjoints aient été même consultés. Les alliances se bâtissaient sur des noms et non sur l’amour, considéré comme un détail très secondaire. Les petites mariées ne comprenaient rien aux cérémonies dont elles étaient l’objet. Elles s’en amusaient plutôt. Quant aux futurs époux, qui n’étaient dans la plupart des cas que des gamins, ils étaient loin d’entrevoir la responsabilité qu’on leur faisait prendre. L’amour venait ou ne venait pas et le divorce était fréquent. Cependant, les mœurs ont évolué et l’éducation a changé les idées des grands et des petits, dans ce domaine comme dans bien d’autres.<br>
Revenons aux cérémonies du mariage. Une fois les présentations et les formalités presque réglées, les festivités commençaient.<br>
Le samedi qui précédait la noce, " Sebt Ezzai ", samedi du conseil et des échanges de vue, réunissait chez la mariée les deux familles appelées à s’unir pour qu’elles fissent plus ample connaissance. Le trousseau de la future épouse était alors exposé. Fort coûteux autrefois, il comprenait obligatoirement, outre les effets d’habillement, la grande robe (Kessoua el kbira) toute chamarrée d’or, les bijoux, les tapis, matelas et couvertures, sans oublier le petit matelas, de rigueur dans tout trousseau, destiné pour les époques d’impureté, prescription religieuse à laquelle toutes les jeunes femmes devaient se soumettre.<br>
Le lundi, au cours d’un banquet offert par les parents de la mariée, le fiancé, amené en grande pompe, prenait place au milieu des rabbins et s’engageait devant eux à contracter mariage. C’était le jour du serment. Dans l’après-midi du même jour, une réception réservée aux femmes avait lieu chez le futur époux. Il était d’usage d’y amener une vache couverte de soieries, destinée à être abattue devant tout le monde dans le patio de la maison, au son des youyous sans fin. Il faut rappeler que les festivités se passaient dans le Mellah et toutes les femmes du quartier se faisaient un plaisir de venir aider aux préparatifs de la fête.<br>
Le mardi, se déroulait chez la future mariée la fameuse cérémonie du Henné, au cours de laquelle des femmes appliquaient cette mixture sur les pieds et les mains de la fiancée. Cette cérémonie, de beaucoup la plus courue de la noce, réunissait toutes les dames amies des futurs conjoints, et se poursuivait jusqu’à la tombée de la nuit, au milieu de grandes réjouissances.<br>
Le transport du trousseau chez le futur époux avait lieu dans la même nuit. Les jeunes amis du futur époux se chargeaient avec joie de cette mission, précédés de musiciens et de femmes qui lançaient des youyous frénétiques. Ils portaient eux-mêmes les paquets contenant les robes, châles, linge, coussins brodés, tandis que les objets lourds et volumineux étaient confiés à des porteurs professionnels. Tout ce monde arrivait dans l’allégresse chez le futur marié, réveillant sur son passage tous les habitants qui apparaissaient à leurs portes et fenêtres.<br>
Puis, discrètement, on préparait la mariée pour aller au Mikvé, bain rituel, accompagnée de parentes proches, uniquement des femmes, bien sûr. La tradition voulait qu’elles se lavent aussi et chacune d’elles devait laver la mariée. Des gâteaux et des friandises étaient servis ainsi que des boissons et l’on ramenait la mariée chez elle.<br>
Le lendemain, mercredi, était la journée de la cérémonie religieuse : celle de la bénédiction nuptiale. La mariée, parée de la grande robe de velours brodée d’or, prenait place sur un trône, Talamon, préparé à son intention. Sur sa tête, un foulard de soie aux longues franges retombant le long de ses joues était harmonieusement fixé aux cheveux par de nombreux bijoux. Sur son front, on posait un diadème, El Khmar, d’où partaient de fausses tresses émaillées de pierreries, fausses ou vraies. Lorsque la famille de la mariée ne possédait pas suffisamment de bijoux, il était coutume d’en emprunter chez les voisins, détail qui, en aucun cas, ne prêtait à la critique. La cérémonie religieuse terminée, la mariée était alors promenée dans la maison; chaque parente, amie ou voisine devait lui offrir une gorgée de lait, qu’elle buvait en croquant un peu de sucre. Le soir, c’était le grand dîner, le plus important de la noce, auquel étaient toujours conviés les rabbins et les principaux notables de la ville. Ce dîner se prolongeait fort tard dans la nuit, au son de la musique andalouse. Puis, les mariés se retiraient discrètement, gagnant la chambre qui leur était réservée.<br>
De bonne heure, le jeudi matin, la famille est à nouveau réunie et attend impatiemment le moment où la mère du marié pénètre dans la chambre nuptiale. Elle en sort, quelques instants après, tenant en main un fin linge blanc qui atteste que le mariage a été consommé. Ce linge est montré à toute la famille présente au milieu de youyous joyeux.<br>
La journée du jeudi est réservée aux réjouissances. Elle est surtout la journée des cadeaux. Tous ceux qui ont assisté aux différentes cérémonies de la fête se font un devoir d’en apporter aux nouveaux époux. On les expose sur une grande table et il est de bon ton pour chacun de s’en approcher et de les admirer. Dans le patio, pendant ce temps, les musiciens continuent à jouer et le parfum du bois de santal et celui de l’eau de fleur d’oranger emplissent la maison.<br>
Le samedi, la cérémonie religieuse à la synagogue termine la noce. C’est le " Sebt el Hbab ", le samedi des parents, ainsi appelé parce qu’il réunit uniquement les membres de la famille. Cette réunion plus intime a pour but de faire prendre à la mariée contact avec sa belle famille. Le déjeuner terminé, la jeune épouse doit offrir des gâteaux d’abord à ses beaux-parents en appelant son beau-père " Señor " et sa belle-mère " Señora ", titres qu’elle leur donnera désormais. C’est ensuite le tour des frères et sœurs aînés de son mari qui reçoivent respectivement les noms de " 'Azizi " (très cher) et " Lalla" (princesse). N’oublions pas de dire qu’un déjeuner commencé à midi se terminait à la tombée de la nuit et qu’un dîner se poursuivait jusqu’à l’aube. Pour distraire l’invité, on conviait des amis communs et les voisins les plus intimes. Entre les nombreux plats, on buvait longuement à la santé des assistants, mahia, alcool de figues ou de dattes. Boire son verre jusqu’à la dernière goutte étant une marque d’estime à l’égard de celui qu’on veut honorer, gare à celui qui ne vidait pas son verre. Le refus de boire, sans raison, se voyait puni par quelque sanction amusante, notamment par le jet du contenu sur la tête du récalcitrant. Tous ces détails n’offusquaient personne et ne faisaient qu’ajouter à la gaieté des convives.<br>
La vie dans les Mellahs, dans les périodes paisibles, était loin d’être désagréable. Les Juifs étaient relégués dans ces quartiers à cause du mépris qu’on leur portait et dans le but de les écarter des agglomérations arabes. Mais cela répondait à leur désir secret de vivre tranquillement dans un quartier qui fermait ses portes le soir, ce qui les préservait de tout contact fâcheux. Il peut sembler étrange, malgré les épidémies qui sévissaient fréquemment dans ces Mellahs, qu’une vie organisée ait pu y exister.<br>
Les Juifs sépharades aspiraient à la perfection individuelle, à la paix intérieure, au bonheur. Leur morale était pleine de prudence et de sagesse pratique. Ils ont conservé leurs coutumes et leur pensée propre, farouchement fidèles à leur héritage et fiers de leur glorieux passé. Ces us et coutumes du mariage dans la ville de Fès au début du XXe siècle faisaient partie intégrante de leur vie courante et reflétaient des rites anciens dont beaucoup étaient d’origine espagnole. Les Juifs marocains les pratiquent de manière presque instinctive, portant à certains une sorte de culte.<br>
Je termine par ces mots d’Abraham Heschel tirés de son livre ''Les bâtisseurs du temps'' : " Pour le juif pieux, la loi juive est une mélodie sacrée. Le divin chante dans les actes nobles ".

|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 24 septembre 2007, 13:05 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
C’est décidé, nous irons en pèlerinage sur la tombe de Rabbi Nessim Ben Nessim. Toute la semaine, les préparatifs sont allés bon train. On a empilé dans le camion literie et vaisselle. Nous allons durant huit jours prier sur la tombe du Saint, faire un long pique-nique et aussi provision d’air pur. La route à prendre n’est pas encore asphaltée et nous sommes secoués “d’importance”. Cela ne dérange personne, surtout les enfants qui débitent avec enthousiasme leur répertoire de chansons scoutes. Ces vacances débutent dans la joie.<br>
Nous arrivons enfin. Les chambres où nous allons loger ont le sol en terre battue. Nous le recouvrons de nattes et de vieux tapis et nous arrangeons des lits bas à la mode arabe. La chambre du Saint est déjà bondée. La fumée que dégage la flamme des cierges, les pleurs et les supplications des groupes éplorés créent une ambiance d’hystérie qui nous gagne malgré nous. La boîte aux lettres du Saint est ouverte et chacun y va de ses suppliques. La foi fait palpiter les cœurs et beaucoup sortiront de là calmes et sereins.<br>
Après les prières, nous dévalons la montagne pour aller au bord de l’oued passer la journée à l'ombre des arbres. Les Arabes ont reçu l’ordre de leur cheikh de respecter et d’aider les pèlerins durant leur séjour. Aussi sont-ils venus avec leurs ânes que nous avons chargés de literie et de victuailles. Les bêtes déboulent sans perdre leur équilibre, alors que nous avons du mal à retenir le nôtre pour les suivre. Arrivés au bord du lac, les enfants pataugent dans l’eau de l’arc-en-ciel. Les hommes activent les feux de charbon pour les grillades et les brochettes. En attendant, c’est l’inévitable pose du thé. On a apporté des menthes variées pour le parfumer et même des boutons de fleurs d’oranger. Certains des hommes sont déjà légèrement éméchés à force de petits verres de mahia. Le temps est au plus beau. Au loin, des jeunes escaladent le flanc de la montagne qui a l’air d’un mur immense et abrupt. D’autres, la mine épanouie prennent leur première leçon d’équitation à dos d’âne et refusent même de manger, se défoulant en poussant des cris de Sioux. Après le déjeuner, repus et gavés, c’est la sieste pour tous.<br>
Le grand air aidant, tout le monde se réveille frais et dispos. Les hommes se racontent des histoires hilarantes et chassent leurs soucis dans des éclats de rires bienfaisants. Les femmes font preuve de réserve. Tabous, éducation stricte, modestie, les empêchent de faire preuve de leur savoir ; elles se sont éloignées, installées sous les arbres et chantent des airs mélancoliques. La doyenne a retourné un plateau de cuivre et, du dos d'une cuiller, rythme un air andalou classique : lihabibi nrsan salem, à mon aimé, j'envoie un salut. Les voix s’élèvent pures et justes. Elles sont belles et modestes nos femmes, ainsi les aiment leurs maris. Mais le temps va vite et dans quelques années, elles vont s’émanciper, travailler et devenir de plus en plus indépendantes. Piyoutims et chants en vogue se succèdent, car dans presque toutes les familles il y a un paytan, un arrangeur de mots ou même un vrai poète, ainsi qu’en témoigne le livre de chiré yédidot.<br>
Le disque rouge du soleil décline et il faut remonter, grimper la côte abrupte. À la prière de minha, les hommes ont pris un air inspiré; les yeux au ciel, ils conversent avec D. C’est la foi parfaite, l’amour brûlant pour le Créateur. La nuit tombe et un ciel de velours clouté d’or nappe le monde d’une douce lumière dorée. On se couche tôt pour se réveiller au chant des coqs du village. La journée va ressembler à celle d’hier qui ressemblera à celle de demain. Je soupçonnais ces huit jours de prières et d'air pur organisées afin de faire sortir les Juifs des Mellahs et de les faire vivre quelques jours au grand air, car parents et grands-parents, pour la plupart artisans, exerçaient souvent leurs métiers chez eux.<br>
Le retour nous ramène au train-train quotidien coupé par les mariages, naissances, fêtes religieuses ainsi que par d’autres journées de plein air que nous passons entourés de nos enfants – notre seule richesse en ce monde où rien ne dure – et de nos amis. Je garde un beau souvenir de ces promenades en famille.


|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 30 septembre 2007, 07:31 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Ma belle-sœur fut toujours courageuse et travailleuse. Mariée et mère d’une nombreuse famille, elle avait créé une petite industrie : elle produisait de l’huile d’argan pour Pessah, dont aucune maison à Mogador, aussi modeste fut-elle, ne pouvait se passer. Une salade de poivrons grillés et coupés en lamelles, arrosée d’huile d’argan, de jus de citron, saupoudrée de sel et additionnée d’un éclat d’ail frais devenait un vrai régal. D’autres familles faisaient même leur cuisine de cette huile un peu lourde, mais si parfumée. Donc, après la fête de Pourim, ma belle-sœur, souple et agile, montait à la terrasse, une immense terrasse d’où l’on voyait à l’ouest l’océan que le soleil faisait miroiter de myriades d’étincelles. Elle choisissait un jour pendant lequel le vent, qui soufflait fort d’habitude – Mogador étant sur le chemin des alizés - avait pris congé. Bien que l’air calme et doux fut plus propice à la rêverie qu’au travail, elle se mettait à l’œuvre. Elle entreprenait avec détermination de vider et de nettoyer la chambre où elle lavait d’habitude le linge de la famille. Elle était tellement méticuleuse qu’elle n’en confiait la tâche à personne.<br>
Un ouvrier venait ensuite passer deux couches de chaux sur les murs, le plafond et le plancher. Du coup, cette chambre banale devenait un petit sanctuaire de lumière. Les jarres qui allaient servir à recueillir l’huile étaient lavées et on en chaulait l’extérieur. Pendant ce temps, son mari, diligent, achetait aux Arabes qui venaient du bled, des sacs de jute pleins de noix d’arganier et les entreposait dans un coin de la chambre, près des meules qui allaient servir à en écraser les amandes.<br>
Les fatmas au fil des ans, venaient réclamer comme une faveur de travailler pour la fabrication de l’huile d’argan. Elles se soumettaient aux exigences de la maîtresse des lieux, qui leur faisait longuement laver au savon les mains et les bras jusqu’aux coudes, puis leur distribuait des carrés de toile blanche pour qu’elles recouvrent leur chevelure. Le travail commençait. À l’aide de gros cailloux ou de pilons, elles cassaient les noix et en extrayaient les amandes qu’elles empilaient dans des couffins d’osier neufs. Il fallait deux jours aux six ouvrières pour venir à bout des sacs de noix. Ma belle-sœur leur distribuait des verres de thé parfumé à la menthe et les encourageait d’un sourire ou d’un mot gentil. Suivait ensuite le travail des meules que les fatmas tournaient pour écraser les amandes tout en accompagnant le chuintement des meules de chansons dans lesquelles les mêmes mots revenaient comme un refrain.<br>
La pâte huileuse recueillie, ma belle-sœur la mettait dans des linges d’étamine (hayati) qu’elle fixait autour de l’ouverture des jarres. Une huile pure de première pression qui parfumait toute la maison s’égouttait bientôt à l’intérieur. Son mari venait ensuite remplir des bouteilles dûment lavées avec un goupillon, et les fermait avec un bouchon de liège. Le travail n’était interrompu que par les repas que l’on descendait prendre à la cuisine.<br>
L’huile était distribuée à Mogador, et même jusqu’à Agadir. Dans la ville, d’autres familles fabriquaient, qui de la Matsa Chmoura, qui des gâteaux et même des saucisses cacher pour Pâque. Ces souvenirs me rappellent le plaisir avec lequel, quand nous étions enfants à Marrakech, nous nous rendions au four aider à la fabrication des galettes pour avoir droit à la fin du travail qui durait parfois jusqu’à minuit, à une gâterie. Avec le reste de la pâte, on faisait une sorte poche qui gonflait à la cuisson comme un ballon et qu’on appelait bonefakh. On la remplissait ensuite de bonbons.<br>
Que de souvenirs éveillent en moi l’époque de mon enfance dans Marrakech habillée de lumière et coiffée d’azur. Plus tard, à Mogador, mariée et mère de famille, j’appréciais, malgré l’alizé omniprésent, cette petite ville bleue et blanche où l’on avait l’impression de vivre au ralenti, et où l’on savourait chaque événement comme un cadeau du ciel.

Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:40 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 03 octobre 2007, 07:25 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
La journée a été accablante de chaleur mais vers le soir il se lève une petite brise légère. Quelqu'un à la maison dit : Béni soit le Nom, les portes du paradis se sont entrouvertes.<br>
Les femmes posent leur ouvrage pour laver le patio à grande eau que le parterre brûlant transforme en vapeur. On a placé sur des nattes des lits bas recouverts de draps blancs. On s'installe. C'est l'heure sacrée de la pause du thé qui réunit parents et voisins. Les hommes se sont rafraîchis et ont troqué leurs vêtements contre des faradjas, des tuniques blanches. Mon père, grand seigneur, s'active à la préparation du thé. Auparavant il débite en morceaux à l'aide d'un pilon, le cône de sucre et donne aux enfants la poudre qui s'est déposée autour. Ma mère apporte sur un plateau de cuivre étincelant, une coupe où des boutons de fleur d'oranger se mêlent à plusieurs sortes de menthes.<br>
Un oncle arrive que je trouve fascinant. Fin diseur, spirituel, d'une mémoire prodigieuse, il raconte anecdotes et histoires drôles. Il prend tour à tour l'attitude compassée, l'air coléreux, gai ou fantasque du personnage qu'il anime. Les mains volent et accompagnent les paroles qui se bousculent, convaincantes. Pendant que Père distribue les verres de thé odorant, mon oncle nous encourage à raconter des souvenirs, des faits récents ou même, comme lui, des anecdotes. Chacun y va de son récit dans une ambiance de détente et de délassement. J'ai six ans, l'esprit alerte, j'écoute et j'enregistre. <br>
Un visiteur inattendu arrive, tout le monde se lève en signe de respect. C'est mon autre oncle, Grand Rabbin, enseignant, avocat à ses heures, recherché pour prononcer des oraisons funèbres. Grands et petits, nous lui embrassons la main qu'il pose ensuite sur nos têtes pour nous bénir. Sa forte personnalité séduit tous ceux qui l'approchent. Imposant, bien que de taille moyenne, il émane de lui un charme rayonnant. Nous écoutons avec respect et attention ses paroles émaillées d'humour. Ses grands yeux semblent regarder au loin comme si son esprit est occupé ailleurs mais, ramenant son regard vers nous, il répond à nos questions avec justesse. Nous attendons. Son expérience est vaste. Empreints de sagesse, chacun de ses récits nous donne à réfléchir. Ce soir, il raconte. Un couple élégant, aisé, marié depuis dix ans, n'avait pas d'enfant. Chaque année, mari et femme venaient le voir, voulant divorcer. Chaque fois, il leur conseillait la patience, arrivait à les convaincre d'attendre. Un jour, la femme vient enfin lui annoncer leur bonheur. Elle attendait le bébé tant désiré. Hazak oubaroukh ! Force et bénédiction à toi, notre Rabbin éclairé et sage ! <br>
La nuit tombe d'un coup après un court crépuscule. Il est temps d'allumer. C'est l'heure du souper. On doit se lever. Mère, douce et affectueuse, surtout envers ce frère unique et prestigieux, dit : "Ce moment qu'on vient de vivre, c'est déjà du passé. Le retrouvera-t-on encore aussi serein et chargé d'autant d'amour et d'émotion ? " <br>
J’ai grandi dans cette atmosphère familiale paisible qui m’a laissé tant d’heureux souvenirs. Aujourd'hui grand-mère, j'apprécie ces moments de mon enfance que je garde avec tendresse et reconnaissance dans mon cœur.

Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:40 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 07 octobre 2007, 09:51 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Au temps de mon aïeule, les Juifs vivaient repliés sur eux-mêmes, jamais assurés de leur sécurité. Hommes et femmes exceptionnels, ils avaient l'esprit large et tolérant, une foi que rien n’ébranlait, un courage à toute épreuve. Malgré le climat d’ignorance et de superstition qui prévalait à l’époque, ils choisissaient de ne pas se plaindre. Le visage paisible, ils accomplissaient leur devoir et attendaient la mort sans appréhension. <br>
Telle était mon aïeule que j’ai connue à travers les récits qu’en faisaient ma mère et mes tantes qui, avant que l’oubli n'efface leurs souvenirs, évoquaient affectueusement la vie de dévouement de leur grand-mère. Comme bien des femmes de sa génération, l’aïeule Mira semblait venue au monde pour le devoir et le sacrifice. Toute jeune, elle avait éprouvé le besoin de venir en aide à ses semblables. Mariée, elle avait mis au monde sept enfants et, tout en les élevant, elle trouvait le temps d’assister les accouchées de la famille ou celles des familles voisines. Elle savait réconforter les malades, écoutait les doléances des femmes chargées d'enfants et souvent démunies, parlait de paix dans les foyers instables. Elle avait une forte personnalité et maniait l’autorité avec discernement. Sa seule présence imposait le respect. <br>
Son époux mourut après une courte maladie. Ses enfants déjà mariés, elle se retrouva seule. Elle retroussa ses manches et pratiqua le bénévolat à un haut niveau. Elle avait aménagé, dans un placard, tout un nécessaire de premiers soins : des flacons de gouttes pour les yeux, - la sécheresse de l'air, la chaleur et le manque d'hygiène irritaient les yeux - des pansements faits d'une toile fine appelée hayati, des tisanes contre les coliques et les indigestions, des graines de lin pour les cataplasmes, de la barbe de maïs pour calmer les troubles de la vessie, bref, tout un arsenal de remèdes naturels dont on se transmettait la liste de mère en fille. Mais ses remèdes les plus efficaces étaient une grande compassion et une patience infinie pour les malades, grands et petits. Sa réputation dépassait l’enceinte du Mellah. Parfois arrivaient de la médina des voisins arabes. Elle les soignait sans jamais accepter argent ou cadeaux. <br>
La dévotion de l’aïeule était telle qu’elle unissait dans un même élan son amour de D et celui des êtres humains. Elle disait qu’on ne pouvait aimer et respecter D sans aimer et respecter toutes ses créatures, quelles qu’elles fussent. Tôt levée le matin, elle commençait sa journée en priant avec des mots à elle. J’ai appris cette prière de ma mère qui l'avait apprise de mon aïeule, dans la seule langue qu'elle connaissait à l'époque, l’arabe. Les mains derrière le dos elle priait, se balançant d'avant en arrière d'un mouvement cadencé. Elle suppliait D et lui disait qu’Il était l’Éternel, l’Unique, le Roi du monde, Celui de qui on attend pitié et miséricorde. Quand on demandait à l’aïeule de se reposer, elle répondait qu’elle ne pouvait se présenter à son Créateur les mains vides alors qu’Il lui avait fait don d’un esprit sain dans un corps sain. Elle a gardé jusqu’à sa mort, une grande sérénité venue du sentiment du devoir accompli dans la paix du cœur. <br>
Que je les trouve admirables, ces femmes vertueuses, si sages et dévouées ! <br>

Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/06/2008 13:43 par Dafouineuse.
|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 12 octobre 2007, 09:17 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Le 22 novembre 1942 est resté gravé à jamais dans ma mémoire car il a marqué un tournant douloureux dans ma vie et celle de mes frères et sœurs. Nous avons perdu notre mère ce jour-là. Elle était âgée de 42 ans. Pour comble de malheur, nous perdions notre père deux mois plus tard. Une épidémie de typhus s’était déclarée à Fès et dans d’autres villes du Maroc, fauchant petits et grands. Les antibiotiques, dont la pénicilline, ne devaient faire leur apparition chez nous qu'une année plus tard. Nous étions huit enfants, dont le plus jeune n’avait que quatre ans, subitement devenus orphelins. <br>
Ma sœur aînée, Heftsiba Elkeslassy, était déjà mariée et mère de trois enfants. Elle a décidé sans hésiter de s’occuper de nous. Dans son esprit, il n’y avait pas d’autre solution. Voilà qu’elle se retrouvait, à 26 ans, avec la charge de dix enfants ! Mes frères et mes neveux étaient bien heureux d'être réunis et, petit à petit, une nouvelle vie familiale s’organisait, comme il se devait. Malgré notre chagrin, l’absence de nos parents devenait moins pénible à supporter. Je n’ai aucun doute quant aux difficultés que ces responsabilités présentaient pour ma sœur, même si elle n'en montrait rien.<br>
Elle avait beaucoup de patience et le don du dialogue. Après une de nos incartades, elle faisait semblant d’être en colère, mais elle ne réussissait pas vraiment à nous en convaincre. Cela nous la rendait encore plus attachante. Nous étions plus de garçons que de filles. Parfois, quand elle s’absentait de la maison, une petite bagarre éclatait, mais ce n’était jamais bien méchant. Quant à mon beau-frère Shaul, il nous prodiguait l'affection et le respect d'un père, sans faire de différence entre nous et ses propres enfants.<br>
Je dois, malgré la modestie de ma sœur, mentionner sa grande beauté de brune aux yeux verts. J’estime qu’elle était parmi les plus belles femmes de Fès et certainement une des plus élégantes. Elle avait de plus une démarche noble. Quand elle passait dans la rue, personne ne restait indifférent.<br>
Il y a eu au cours des ans de nombreuses célébrations : bar-mitsvas, fiançailles, mariages, naissances. C'est ma sœur Heftsy qui se chargeait de tout organiser. Elle était sollicitée de partout . Malgré ses énormes responsabilités familiales, elle trouvait le temps de faire partie d’innombrables sociétés de bienfaisance et de comités touchant les affaires de la communauté. Je peux dire qu’à l’époque, les organisations juives n’avaient rien à envier à celles d’aujourd’hui.<br>
Les années passaient. Mes deux sœurs et moi-même étions mariées. Sa charge devenue moins lourde, elle décida d’immigrer en Israël, ce qu’elle fit comme bien d'autres, en 1954. Son mari devait la rejoindre après avoir liquidé ses affaires. Il avait acheté une maison en Israël. Il avait fait confiance à des gens qui venaient au Maroc vendre des résidences toutes prêtes à être habitées, auxquelles il ne manquait que l’essuie-pieds. Arrivés là-bas, quelle déception ! Il n’y avait ni eau, ni électricité et il manquait même les vitres aux fenêtres. Bien sûr, beaucoup, déçus, voulaient s'en retourner. Mais ma sœur réussissait à les faire patienter. Elle disait qu’il fallait souffrir pour mériter d’habiter en Israël. <br>
Les débuts de son installation furent très difficiles car son mari ne put la rejoindre que deux années plus tard. Elle s'est donc retrouvée avec, en plus de la charge de ses enfants et de mes frères, celle de ses beaux-parents.<br>
Au mochav, ma sœur était organisatrice, porte-parole, activiste. Avec les autres familles installées à proximité, le mochav Yad Rambam fut fondé. Quelques années plus tard, rendant visite à ma sœur j'ai été émerveillée. Une magnifique rangée de douze palmiers géants bordait sa maison. Tout était verdoyant et fleuri. Chacun possédait un grand terrain et l'exploitait comme il voulait, gagnant sa vie grâce à la culture ou l’élevage. <br>
Dès le début, elle fit construire un mikvé. C’est elle qui tenait à y accompagner les femmes. Puis ce fut le tour d’un four à pain. Ensuite, elle et Shaul ont mis sur pied le projet de construction d'une synagogue. Tout se passa comme il fallait, et c’est même mon tout jeune frère Méïr qui écrivit à la main les prières, sur le parchemin d'un superbe Séfer Torah. Elle m’a longtemps parlé de ce séfer, que mon frère a mis sept ans à écrire, comme s’il s’agissait d’une pièce de musée. Méïr est aujourd’hui rabbin en Israël et il écrit des téfillim (phylactères) de temps en temps. C’est un vénérable grand-père. <br>
Devenue plus âgée, ma sœur continuait à faire du bénévolat comme elle l'avait fait au Maroc. Elle visitait les malades, réconfortait les familles endeuillées et, comme notre grand-mère qui s’occupait de la hevra kadisha à Fès, Heftsy devint la responsable de cette tâche au mochav. Elle commençait à être connue à travers le pays, recevait chez elle députés et ministres. Feuilletant un jour son livre d’or, j'ai été surprise de découvrir le nombre de personnalités qui étaient venues dans sa belle demeure du mochav. <br>
Un jour, elle devait aller à Haïfa. En se dirigeant vers l’autobus, elle voit une jeune femme qui pleurait à chaudes larmes. On venait de lui voler son argent. Ma sœur ouvre son propre sac et lui remet une somme. Quelques jours plus tard, elle reçoit l’argent accompagné d'une lettre de remerciements de la jeune femme. C’était une arabe palestinienne qui avait raconté à tout son voisinage comment une Juive avait eu pitié d’elle. J’ai encore la lettre de cette jeune femme, écrite dans un hébreu impeccable. <br>
En 1976, au cours d'une cérémonie officielle, Hefsty reçut le prix de Mère de l’année. Il lui fut remis à côté de la tombe de Rachel par Golda Meïr. Cette même année fut cependant une année doublement mémorable pour elle car, lors de son premier voyage hors d’Israël le 27 juin 1976, elle s'est retrouvée à bord de l’avion d’Air France qui fut détourné à Entebbe, en Ouganda, par des terroristes armés. Elle a raconté les terribles jours qui suivirent, ses longues discussions avec ses compagnons d'infortune, ses confrontations avec les terroristes, ainsi que le choc du sauvetage extraordinaire des otages par un bataillon d’élite de l’armée israélienne dans un ouvrage intitulé : Sauvée de l’enfer. Elle s’y est consacrée dès son retour d’Entebbe. <br>
Quelques jours après, je me trouvais chez elle en Israël, à la réception qu’elle donnait pour ses compagnons d’infortune. La maison et le jardin étaient pleins de monde. Il y avait de nombreuses personnalités politiques, des journalistes, des amis, des membres de la famille. Je me tenais à côté de Shlomo Goren - l'aumônier de l’armée - et de son épouse. Je me suis dit que peu de femmes avaient eu une vie aussi remplie que celle de ma sœur Heftsy. <br>
Elle est décédée en septembre 1998, alors que je revenais d'un séjour en Israël. Rien ne m'avait laissé prévoir que je la voyais pour la dernière fois. Elle a eu des obsèques dignes d’un chef d'état. Elle avait demandé que l'on inscrive sur sa pierre tombale les noms de nos parents et de nos grands-parents. Elle a demandé aussi que l'on pose sur sa tombe, pendant la cérémonie, son beau caftan vert, rappel de son pays natal. Il n‘y avait pas une seule personne dans la foule, paraît-il, qui ne rendît un témoignage de ce que ma sœur avait accompli autour d’elle, durant sa vie. <br>
Elle me manque tellement. Je suis si triste depuis son départ, j’ai l’impression d'être devenue orpheline une seconde fois. Pour moi, ma sœur était le rempart qui nous avait toujours protégés du mal. Elle a été pour nous un si bel exemple. Tout ce qu’elle accomplissait, elle le faisait avec humilité, voire dans l’anonymat le plus total. Elle reste dans ma mémoire telle que l’ai connue, alliant une intelligence vive à une immense générosité. J’ai la chance d’avoir conservé une merveilleuse correspondance accumulée durant plus de vingt années. Chacune des ses lettres finissait par une citation biblique, par une prière ou par un sage conseil. Elle m'a tant appris ! A tous points de vue, ma sœur Heftsy était unique. Elle a suivi un parcours qu'il est donné à bien peu de connaître. <br>
On dit, quand on perd un être cher, que sa présence physique disparaît mais que son souvenir demeure. Pour nous qui l’avons connue et aimée, ce souvenir nous accompagnera durant toute notre vie et nous aidera à surmonter l’immense chagrin de sa perte. Quant à moi, je ne vais jamais, je ne pourrai jamais l’oublier. Que sa néchama, son âme, soit à la place qu'elle mérite, dans le domaine des Justes. <br>

|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 19 octobre 2007, 01:26 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Du plus loin que je me souvienne ma grand-mère vivait chez nous. Elle avait atteint un âge très avancé, elle devait avoir plus de cent ans. Elle n’était plus capable de marcher, était devenue aveugle, mais avait gardé toute sa mémoire et sa clarté d'esprit. Nous l'aimions beaucoup. Pour éviter qu’elle ne tombe, on avait placé son matelas par terre, auprès du lit de mon frère Aaron. Quand il se couchait elle lui disait : “Dors mon fils, sois béni”. Si elle avait besoin d’aide pendant la nuit, elle le réveillait, il lui donnait de l’eau ou il allait chercher Maman.<br>
C’était une conteuse extraordinaire. Elle nous narrait des histoires par épisodes. Elle arrêtait à un moment palpitant et nous laissait impatients de connaître la suite qu’elle continuait le lendemain. C’est tout ce qu’elle pouvait encore faire après une vie de dévouement pour les siens. Elle passait la journée assise sur son matelas. Maman lui donnait à manger, veillait à tous ses besoins. <br>
Un grand balcon longeait toutes les pièces au-dessus du rez-de-chaussée. Les chaudes soirées d'été, nous ouvrions toutes grandes les portes vitrées du salon, nous prenions des matelas et nous dormions à l’air frais. Une nuit, mon frère a ouvert les yeux et a vu ma grand-mère se détacher dans la nuit claire, debout, agrippée à la balustrade du balcon. Il a eu une exclamation de surprise qui nous a tous réveillés. Nous l'avons entourée et Maman lui a demandé : <br> "Comment t'es-tu levée toute seule ? Comment es-tu arrivée ici, toi qui n’as pas marché depuis des années ? " <br>
Elle a répondu : <br> “Laisse-moi, ma fille, les portes du ciel étaient ouvertes”.<br>
“Ima, maman, est-ce que tu as prié pour nous ?”<br>
“Oui, pour qu'Il vous garde toujours sous Sa protection.”<br>
Maman a dit :<br> “la Bérakha - la bénédiction du Seigneur - est sur notre maison.”<br>
Nous avons aidé ma grand-mère à se remettre au lit. Elle n’a jamais plus marché.<br>
Nous avons été très impressionnés par cet incident qui est devenu un de nos plus chers souvenirs. J'espère que les portes du ciel se sont ouvertes quand son heure est venue de nous quitter. <br>

|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 26 octobre 2007, 05:33 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
La vie de ma grand-mère illustre bien la place importante que les femmes de cœur avaient dans la société de son temps et le rôle primordial qu’elles y tenaient. J’ai voulu, ici, lui rendre un affectueux hommage, ainsi qu’à toutes celles, ma sœur Heftsy en a fait partie, à qui la société juive sépharade du Maroc qui a été celle de mes jeunes années, doit tant. <br>
Ma grand-mère Messody Gozlan habitait Fès, où elle est née. Je suis la première petite-fille, parmi mes nombreuses cousines, à porter son prénom. Je suis la cinquième de ma famille, après trois sœurs et un frère. Je me souviens de la place qu’elle tenait dans la famille, de son affection, de son sens du devoir. Je me la rappelle dans ses moindres gestes, la revois exprimer l’approbation ou le mécontentement d’un seul regard. Je pense à sa propreté méticuleuse qui faisait que tout luisait autour d’elle. Je veux espérer que nous avons tous, petits et grands, hérité de son savoir-faire. <br>
Elle faisait partie de la Hévra Kadisha et s’occupait de la toilette mortuaire des personnes décédées. Il n’y avait pas à l’époque de salons funéraires. Tout se faisait au domicile du défunt. Il n’y avait pas de téléphone non plus, pourtant tous les bénévoles étaient présents au jour et à l’heure nécessaire. Les réunions se tenaient chez elle qui assignait sa tâche à chacun. Sa maison était une sorte d’agence de service social, car il n’y avait pour les démunis ni aide organisée, ni C.L.S.C ni assurance chômage ! Parfois, les bénévoles se cotisaient entre eux mais les moyens n’étaient pas toujours suffisants. Souvent, mon père apportait sa contribution ; mes oncles le faisaient aussi. Il fallait voir à tout car les situations urgentes ne manquaient pas. Tantôt c’était un veuf pour qui il fallait chercher une compagne. Il fallait nettoyer sa maison, trouver des habits propres pour lui et pour elle, préparer la cérémonie du mariage. Ou bien c’était un malade à visiter ; ou un couple en instance de divorce qu’il fallait conseiller ; ou encore un chalom qu’on allait faire, c’est-à-dire une tentative de régler un conflit, de résoudre un problème dans un foyer. <br>
Ma grand-mère s’occupait de ces affaires à toute heure du jour ou de la nuit. Je la vois encore rentrant chez elle après une “mission impossible”. Elle habitait un troisième étage. Nous étions deux ou trois petits-enfants à lui tenir la main, non seulement pour l’aider à monter les hautes marches de l’escalier, mais parce que nous aimions être à ses côtés. Il nous arrivait parfois, mes cousines et moi, de passer chez elle en sortant de l’école pour boire son thé parfumé. Elle nous le servait accompagné de son délicieux pain coupé en petits bâtonnets et de friandises qu’elle nous réservait toujours. Il fallait qu’on se lave les mains et que l’on mange proprement. <br>
Je me rappelle les fêtes, les grands mariages de mes tantes. Toute la famille aidait à la préparation des nombreuses pâtisseries et friandises. La spécialité pour les mariages, c’était le massapane et le palébé. Pour les fêtes de Hanoukah, c’était le beignet et la moufleta. Les premiers étaient mes préférés. Tout était d’une saveur exquise et d’une présentation si soignée ! Ma grand-mère avait l’œil à tout. Les préparatifs prenaient des jours et on essayait de s’assurer que les enfants ne toucheraient à rien avant la réception. Mais mes cousins et moi trouvions toujours les bonnes cachettes. Ah les bons gâteaux! <br>
Quelle joie que de nous retrouver tous chez notre grand-mère ! C’était notre paradis sur terre. Elle était toujours profondément heureuse de nous recevoir. Ses soirées étaient plus fastueuses les unes que les autres. Sa maison était le lieu où se côtoyaient les humbles et les puissants et cette alchimie était sa joie. Combien ses mitsvot (actions pieuses) étaient nombreuses, quotidiennes, toutes réalisées dans une grande humilité et avec une discrétion absolue. <br>
Je ne peux passer sous silence la belle maison que nous avait laissée notre grand-père, à Fès, avec ses fontaines d’où une eau limpide coulait jour et nuit. Nous avions un mikvé (bain rituel) où plusieurs venaient faire des immersions à l’occasion du chabbat. Un jour, ma grande sœur a entendu le rabbin de la ville dire à sa sortie de chez nous : “Aujourd’hui j’ai pris le bain dans un bassin de cristal”, tellement le marbre et les cuivres des fontaines, resplendissaient. Une autre fois, j’ai entendu mon père raconter comment grand-père faisait fondre de l’or et en appliquait une couche sur les sculptures des murs et sur les fontaines. Malheureusement, ceux qui ont visité cette maison il y a quelques années m’ont dit que tout cela n’est plus. <br>
Chaque vendredi, ma grand-mère venait chez mon père pour qu’il lui explique le sens de la paracha (lecture hebdomadaire de la Torah) de la semaine. Puis, chaque samedi, c'est elle qui l’expliquait à ses amies. Elle avait une mémoire prodigieuse. Dommage, je n’en ai pas hérité ! Mon père lisait le passage à haute voix et elle le répétait sans une faute après lui. Elle était très pieuse. Elle nous disait que ce monde n’est qu’un passage. Elle récitait toutes ses prières par cœur trois fois par jour, sans jamais y manquer. Elle allait à la synagogue tous les chabbats et les jours de fête. La 'azara, la salle des femmes, devait être toujours propre. Ce sont elles qui en faisaient l’entretien. <br>
Ma grand-mère était une très belle femme aux yeux bleu clair. Je me souviens d’elle vêtue d’une jupe large et d’une veste brodée de fil d’or et portant la coiffure traditionnelle des grands-mères de l’époque. Au musée de Jérusalem sont exposés, don de mes oncles, son costume de fête avec la large ceinture brodée d’or, ainsi que sa grande coiffure, le choileff. Au musée de la Diaspora à Tel Aviv, j’ai vu un film sur la ville de Fès, et là aussi, elle apparaît dans sa belle maison. <br>
Elle n’a jamais été malade de sa vie. Elle est morte paisiblement, sans souffrir, lucide jusqu’au dernier moment. Le jour de son décès, tous les commerces du Mellah de Fès ont fermé l’après-midi pour permettre à ceux qui la connaissaient de l’accompagner à sa dernière demeure. <br>
Les années ont passé. Aujourd’hui grand-mère à mon tour, c’est toujours avec une grande joie que j’accueille mes enfants et mes petits-enfants. Bientôt je serai, si Dieu veut, arrière grand-mère. J’essaie de ressembler à cette grande dame de qui j’ai tout appris et qui a beaucoup marqué mon enfance. <br>
J’espère que ces quelques souvenirs que je livre communiquent la saveur d’une époque et surtout la générosité d’une femme de cœur qui, tout en élevant une nombreuse famille, a beaucoup aidé sa communauté. Je ne l’oublierai pas. <br>
Dieu ait son âme et que de là-haut elle veille sur nous et nous protège, Amen. <br>

|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 02 novembre 2007, 00:04 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
C’était en 1936, pendant la guerre civile en Espagne. Nous habitions à Alcazar, aujourd'hui Alcazarquivir, dans un quartier résidentiel, non loin d'une base militaire. <br>
Je me souviens du grand boulevard qu'on appelait El Paseo où tout le monde venait se promener. Nous aimions, mes camarades et moi, âgées de 7 ans à peine, aller souvent dans cette place entourée de haut-parleurs, pour écouter l'hymne espagnol. Dès que résonnaient les premières notes, tous les promeneurs devaient s'immobiliser, bras droit levé, main ouverte, jusqu'à la fin de l'hymne, puis crier à tue-tête : "España Una, España Grande, España Libre, Arriba España" Cela nous amusait de chanter et de crier avec la foule, même si nous ne comprenions pas le pourquoi de ce rite. Nous n'étions que des gamines et ne connaissions pas la signification de ces gestes ni de ces paroles.<br>
J'ai un jour demandé à ma sœur aînée, âgée de douze ans, de se joindre à nous. Nous avions à peine fini de crier "Arriba España", qu'un militaire qui nous guettait s'approcha de nous. Prenant de force la main de ma sœur, il a arraché les bracelets en or qu'elle portait. (elle en portait sept) avant de nous lancer des coups de pied en crachant par terre et en criant : "Vous n'êtes pas des Espagnoles mais des Juives, fichez le camp d'ici." Terrorisées, nous nous sommes enfuies de la place en pleurant. Nous avons couru tout en larmes raconter cet incident à ma mère qui est devenue livide et tremblante d'apprendre que le militaire s'était permis de nous voler et de nous battre. Elle savait tout ce que les militaires espagnols faisaient, allant dans les quartiers juifs, battant les hommes pour enlever leur argent, violant femmes et enfants, pillant tout ce qui était bon à prendre". Quand mon père est arrivé le soir elle l'a mis au courant de ce qui s'était passé. Il nous a défendu de sortir seules de la maison. Nous devions parler à voix basse, ne pas attirer l'attention.<br>
Mon père, qui avait beaucoup de biens, avait déjà commencé à liquider ses affaires. Il décida de hâter les préparatifs de notre départ. Dans notre quartier, un berger arabe, Saliman, venait tous les matins avec sa chèvre nous vendre du lait, ainsi qu'à nos voisins. Nous l'appelions Saly. Dès que nous entendions les clochettes, nous lui apportions la grande bassine pour qu’il puisse traire le lait de la petite chèvre que nous buvions tout chaud. Après l'incident sur la place, mon père a fait entrer Saly avec sa chèvre dans la cour de notre maison et a discuté longuement avec lui. Le lendemain matin, le berger lui a apporté trois gros paquets. Mon père nous a tous réunis dans le salon. La gorge serrée, il nous a parlé très bas pendant que Maman luttait pour retenir ses larmes. Nous nous rendions compte que la situation était très grave et nous l'écoutions sans un mot. Il nous a dit:
"Mes chers enfants, je dois vous quitter pour trouver un moyen de vous sortir de la zone espagnole. Je pars chercher refuge en zone française et je vous enverrai chercher dès que je le pourrai. Je vous recommande d'obéir en toutes choses à votre mère et d'être très prudents. Surtout, ne parlez à personne de ce qui se passe dans cette maison."<br>
Maman a fait cuire trois gros pains après avoir caché à l’intérieur des petites bourses en tissu bourrées de billets. C'était un moyen de sortir de l'argent en le cachant dans la nourriture pour le chemin. À minuit, mon père et nos deux voisins vêtus à la manière arabe de la djellaba, (robe longue), chaussés de cherbils (sandales) et coiffés de tarbouches (coiffure traditionnelle en feutre rouge) que Saly avait apporté dans ses trois paquets, quittaient la maison dans le plus grand secret, accompagnés par le jeune Arabe. Ils ont pris le chemin des montagnes, Saly nous l'a appris à son retour, marchant la nuit, se cachant le jour. Après quatre nuits de marche, ils arrivèrent à Souk-el-Arba, à la frontière française. Là, mon père devait se débrouiller pour que nous puissions le rejoindre dès que possible. On fait des projets, mais bien souvent, hélas, ils ne se réalisent pas comme on l’espérait, surtout en temps de guerre.<br>
La guerre civile en Espagne battait son plein. Les militaires se croyaient tout permis. Sur les ordres du Général Franco on fusillait des gens par milliers. Nous attendions des nouvelles de mon père qui n’arrivaient pas. Nous ne sortions que pour aller voir Rachel et ses dix enfants, Marthe et ses douze enfants, pour savoir si elles avaient des nouvelles. Rien. Nous nous regardions, les larmes aux yeux. Nous vivions dans la peur. Cela dura un an et demi. Pendant ce temps, Maman ne se laissait pas abattre et préparait petit à petit le départ qu'elle espérait. Nous avions des meubles importés de France, de la vaisselle de Limoges, beaucoup d'argenterie, des bibelots précieux. Cela faisait mal de penser qu'il allait falloir tout abandonner.<br>
Tous les matins, Saly venait avec sa chèvre et repartait avec quelques objets de valeur soigneusement enveloppés. Il les vendait et nous apportait l'argent qu'il avait changé auparavant en francs français.<br>
Deux mois avant la Hilloula, le Grand Rabbin, qui se rendait chez tous les Juifs de la ville, est venu nous dire de nous préparer pour le voyage. Il avait obtenu du gouverneur de notre province l'autorisation pour les Juifs de faire le pèlerinage. Ils auraient des laissez-passer. Il s'est entretenu longuement avec ma mère qui s'est mise au travail dès le lendemain. Elle a commencé par acheter plusieurs sacs de farine, puis elle a acheté des mètres et des mètres de grosse toile pour faire un gros sac de voyage pour chacun de nous ainsi que des petites pochettes pour ses nombreux bijoux. Elle a acheté ensuite je ne sais combien de tubes de dentifrice. Elle les a coupés du bas et vidés aux trois-quarts. Ensuite elle a roulé des francs bien serré, quatre billets par quatre. Elle a mis un rouleau dans chaque tube avant de le refermer comme si le tube avait servi. Elle a fait ainsi un tas de préparatifs. Nous la regardions faire et nous l'aidions comme nous pouvions. Malgré notre jeune âge, nous étions conscients du danger qui nous menaçait et de l'importance de garder le plus grand secret sur ce qu’elle faisait.<br>
Trois jours avant notre départ, elle a pétri une quantité énorme de pâte pour en faire de grosses miches. Après un début de cuisson dans le grand four que nous avions dans la cour, elle a caché à l'intérieur de chacune des petits sacs contenant ses bijoux puis les a tressées et y a planté des œufs avant de terminer leur cuisson. Cette coutume des " hallas " du samedi n'a pas changé jusqu'à ce jour, sauf qu'on n'y met pas des bijoux ! <br>
Deux jours avant le départ, le Grand Rabbin, accompagné d'un cordonnier qui tenait une valise et avait un rouleau de caoutchouc sous le bras, est venu de nouveau chez nous. Installé sur une petite chaise pliante devant le tas de nos souliers, Isaac, le cordonnier, en prenait un et découpait une cache dans la demi-semelle extérieure. Maman y mettait des francs pliés en quatre. Le cordonnier clouait ensuite par-dessus, avec des dizaines de petits clous, une nouvelle semelle coupée dans son rouleau. Toutes nos chaussures, neuves ou pas, furent ainsi dotées d'une cachette. Ensuite, après avoir caché les gros pains à l’intérieur des sacs de voyage, elle a rempli ceux-ci. Elle les a ensuite fermés, le bord cousu à l'aiguille en points serrés.<br>
Le jour tant attendu du départ arriva enfin. Le Rabbin nous avait apporté les laissez-passer. quelques jours plus tôt. Au petit matin, nous avons fermé toutes les fenêtres et les avons fixées avec de grosses barres. Nous avons mis les sacs dans la cour et tous sont sortis, sauf moi. J'ai barricadé aussi de l'intérieur la porte d'entrée avant de me glisser au dehors, (à neuf ans j'étais toute menue et souple comme un chat) entre les barreaux d'une petite fenêtre. <br>
Pour cette Hilloula, je crois que toute la ville s'était vidée. Il fallait voir le nombre de familles, chacune avec une ribambelle d'enfants, qui partaient, abandonnant tout. Car on avait eu beau barricader les maisons, on savait bien qu'on ne reviendrait pas. Le grand Rabbin était à la gare pour nous réconforter et nous guider, pour nous bénir.<br>
" Les biens terrestres ne sont rien à côté de la vie. Sauvez-vous " disait-il ". Dieu a donné, Dieu a repris. Il redonnera. Ayez confiance en lui, partez sans regret. " <br>
La gare était pleine de militaires espagnols qui veillaient à ce que chacun n'emporte qu'un seul sac. Nous avons attendu pendant des heures. Quand le train est enfin arrivé, une vieille ferraille toute branlante de laquelle dépendait notre liberté et notre vie, les familles s'y sont entassées l'une après l'autre. On était debout dans les couloirs, serrés à étouffer les uns contre les autres. Cela sentait mauvais, les enfants criaient, pleuraient, c'était affreux. Le départ eut lieu à minuit. Le train roulait avec une lenteur désespérante. On avait presque envie de descendre le pousser. Il s'est enfin arrêté à Casablanca après douze heures d'un trajet épouvantable, douze heures sans un seul arrêt. Quel soulagement d'arriver enfin ! <br>
À la descente du train, beaucoup de familles sont parties. Beaucoup d'autres sont restées dans la salle d'attente, seules dans un pays inconnu. Après un temps qui nous a paru bien long, quatre messieurs de la Communauté juive sont arrivés dans une calèche tirée par deux chevaux. Ils nous ont donné des renseignements avant de nous diriger vers des synagogues. Là, il fallait prendre une décision. Ma mère a tout de suite cherché un logement. Nous n'avions plus à craindre guerre civile, persécutions ou massacres, nous étions en sécurité.<br>
Il fallait à Maman un grand courage pour s'occuper seule de sept enfants. Nous ne parlions que l'espagnol et à Casablanca on parlait le français et l'arabe. Inscrits à l'école, nous avons vite fait d'apprendre le français. Nous étions heureux, libres de chanter, de crier, de jouer avec nos nouveaux camarades dans cette ville blanche où le soleil était plus brillant qu'ailleurs. Mes deux petits frères allaient à Talmud Torah, mes sœurs et moi allions au Lycée Lyautey, école française mixte. Ma sœur aînée n'y a pas été admise, elle avait 14 ans, ne parlait pas le français. Elle ne pouvait pas commencer par les petites classes. Elle est allée apprendre la broderie dans un atelier. Elle est devenue par la suite une brodeuse professionnelle très recherchée. <br>
J'étais très heureuse d'apprendre le français. L'école me plaisait, je me suis fait des camarades. Ma famille et moi n'avions plus à craindre les militaires espagnols. Nous étions plus ou moins installés. Ma mère se débrouillait avec les économies qu'elle avait apportées dans les tubes de dentifrice, dans les semelles des chaussures, dans les pains. De temps en temps, elle vendait un bijou. Malgré tout, elle éprouvait une grande tristesse. Nous n'avions pas de nouvelles de mon père depuis son départ, depuis déjà deux ans. Qu'était-il devenu ?<br>
Un soir, il y a eu un grattement à la porte, comme des doigts qui pianotaient. Nous avons tous eu très peur car, sans mon père, la frayeur nous habitait toujours. Inquiète, ma mère nous a fait un rempart de son corps et a ouvert la porte d'un coup. Nous sommes restés bouche bée, muets de surprise, sans savoir si nous devions rire ou pleurer. Ma mère s'est presque évanouie. Mon père était devant nous, il pleurait. Nous nous sommes enfin jetés dans ses bras. Il nous embrassait et nous cajolait, muet d'émotion. Quand nous nous sommes calmés il nous a raconté les difficultés qu'il avait eues depuis son départ et nous lui avons raconté les nôtres. Nous sommes restés réveillés très tard ce soir-là. Nous étions autour de mon père, enfin réunis, tranquilles et heureux.<br>
Mais pour combien de temps ? Un an et demi plus tard en 1940, la France a été occupée par les Allemands. La loi d’Hitler est arrivée au Maroc par l'intermédiaire du Maréchal Pétain. Un jour le directeur a visité les classes une à une et en a fait sortir tous les élèves de religion juive, nous compris. Il nous a fait attendre dans la cour. Il y avait aussi beaucoup de professeurs. Il nous a rassemblés deux par deux, a ouvert toute grande la porte de l'école et nous a dit de sortir d'une voix pleine de regret et d'émotion : "Mes enfants, vous êtes Juifs. D'après la loi du Maréchal Pétain, vous n'avez plus le droit de rester dans une école française. Les professeurs juifs ont aussi été renvoyés."<br>
Malgré tout ce que nous avons vécu par la suite, c'est avec une grande émotion que je pense à ces années dramatiques de mon enfance, à la force et au courage de ma mère, à sa confiance inébranlable dans le retour de mon père, au jour qui nous a vus enfin réunis. Comme des centaines de milliers de personnes en Europe et ailleurs de par le monde, nous avons vécu d'autres déplacements par la suite, Juifs errants malgré nous. Maintenant chez nous, au Canada, je garde l'espoir que nous n'aurons plus à nous arracher à notre terre d'accueil, terre qui a vu naître nos enfants.
<br>

|
Re: Livre en ligne : La m?moire vivante- Recits de l'?ge d'or s?pharade 16 février 2008, 02:48 |
Administrateur Membre depuis : 19 ans Messages: 2 417 |
Propos recueillis par Sarah Arditti Ascher
Au début des années soixante, au Maroc, deux de mes neveux, le fils de ma sœur, et celui de mon frère, faisaient, comme tant d’autres adolescents, partie d’un groupement qui aidait les jeunes qui voulaient quitter le Maroc pour aller vivre en Israël. L’un des deux y était déjà depuis l’âge de douze ans. Après quelques années de séjour, il a commencé à revenir au pays, sans que ses parents le sachent, pour organiser des départs clandestins. Ces départs étaient risqués, non seulement à cause du danger d’être découverts et arrêtés, mais aussi parce que les groupes devaient voyager de nuit sur de vieux bateaux qui n’offraient pas grande sécurité.
Au cours des ans, mon neveu a contribué à l’organisation de plusieurs de ces départs, entrant dans le pays vêtu à la marocaine, et ne faisant connaître sa présence à personne, pas même à sa propre mère. Il allait regarder du coin de la rue les membres de sa famille entrer et sortir de la maison familiale, mais ne se permettait pas le moindre signe de reconnaissance pour ne pas leur nuire. Tout le monde le croyait mort, sauf sa mère, très affectée par le silence de son fils. Elle espérait qu’il était toujours installé en Israël et qu’il reviendrait un jour. Tant qu’elle ne verrait pas son corps, elle était déterminée à le croire vivant.
Douze années ont passé. Au cours d’une soirée, alors qu’elle dansait avec un jeune homme qu’on venait de lui présenter, une de mes jeunes nièces avait été troublée par la certitude qu’un des jeunes gens présents ne lui était pas étranger. Fouillant dans sa mémoire, elle avait même cru le reconnaître malgré tous les changements apportés par le temps. Elle fit tant et si bien que, sous le sceau du secret, il lui dévoila son identité véritable. C’était bien lui, son cousin que l’on croyait disparu. Elle lui fit promettre d’aller voir sa mère. Il exprima sa crainte de compromettre toute la famille en allant dans la maison de ses parents. Sa cousine lui offrit de les inviter tous pour le chabbat. ‘‘Je les préparerai, ta mère surtout, pour amortir un peu le choc de te voir vivant après tant d’années de silence, et tu viendras pour qu’elle te serre dans ses bras’’. Je vous laisse à imaginer la scène de cette rencontre entre mon neveu et sa mère, ma sœur, ainsi qu’avec le reste de la famille.
Le jour où il s’est fiancé, il décida d’arrêter ses activités clandestines. Il n’allait toujours pas voir sa mère, sa famille, pour ne pas les mettre en danger. Il vivait sous une fausse identité et craignait d’être découvert. Un autre membre du groupe a pris sa place. Une semaine avant son mariage, son remplaçant vint le trouver. Par un cas de force majeure, il ne pouvait pas accompagner les quarante-deux jeunes gens qui attendaient leur départ. Il était trop tard pour changer de plan. Mon neveu seul pouvait le remplacer et ne pouvait donc refuser. Sans avertir fiancée ni famille - peut-être espérait-il être de retour à temps - il a embarqué avec le groupe. Le départ eu lieu le 10 janvier 1961, de nuit, par une mer agitée, sur un vieux rafiot, le Pisces, devenu tristement célèbre. Le capitaine espagnol craignant le pire, fit mettre à l’eau l’unique embarcation de sauvetage et s’enfuit avec les deux seuls membres de l’équipage. Il abandonna tous les passagers à leur sort. Il n’y eut que trois passagers qui furent recueillis à l’aube par un chalutier espagnol. Son capitaine donna l’ordre de se diriger sans tarder sur les lieux du naufrage. Il était malheureusement trop tard. On retrouva quarante-et-un corps à la dérive dans le détroit de Gibraltar, tous portant des gilets de sauvetage. Les naufragés étaient morts de froid. Cette tragédie aurait pu être évitée si le capitaine du Pisces avait donné l’alarme dès son arrivée au port ! Les corps furent recueillis et enterrés au cimetière d’Alhucemas, au bord de la mer.
Toute la communauté juive a été endeuillée par cet acte criminel qui a coûté la vie à tant de jeunes dont la seule faute fut de vouloir aller vivre dans le pays de leurs ancêtres. On peut voir à l’entrée du Rabbinat sépharade à Montréal une plaque commémorative qui relate ce triste événement.
À la même époque, mon autre neveu avait été fait prisonnier des Arabes avec un groupe de jeunes qui placardaient des tracts. Lui aussi aidait des Juifs à partir pour la Palestine. Tous les jours je faisais soixante kilomètres de route de Fès à Meknès. Mon mari travaillait dans une entreprise et me laissait disposer d’une voiture et d’un chauffeur. Je remplissais un panier : nourriture, vêtements, objets de toilette pour les porter à mon neveu. Comme on m’empêchait de le voir, je donnais de l’argent aux Arabes pour qu’ils le lui remettent. Ce n’est qu’au bout de quinze jours qu’il a pu me faire savoir que le panier lui arrivait presque vide. Mon mari m’a dit d’arrêter. Il a fallu que des personnalités haut placées interviennent auprès du roi pour que ces jeunes soient relâchés. Aujourd’hui, ils sont presque tous en Israël.
Récemment, les ossements des victimes du naufrage, ont été retirés de leur fosse commune. Au cours d’une cérémonie émouvante, ils ont été ensevelis au pied d’un monument érigé à Ashdod, en Israël, en commémoration de la mort tragique de ces innocentes victimes de l’intolérance des hommes.

Désolé,vous ne pouvez pas répondre à cette discussion, elle est fermée.