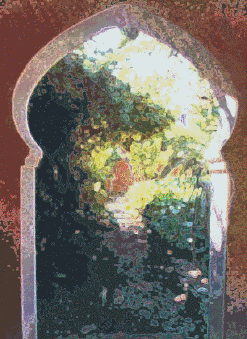|
EDMOND AMRAM L MALEH DANS TEL QUEL
Envoyé par mimi
|
EDMOND AMRAM L MALEH DANS TEL QUEL 04 janvier 2005, 13:16 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 1 |
Interview, Edmond Amran El Maleh : Je ne suis pas juif marocain, mais Marocain juif
A 86 ans, Edmond Amran El Maleh reste un écrivain discret. En l’interrogeant sur son rapport à la judaïté, à la Palestine, au Maroc, à son passé de communiste, à la peinture, nous levons le voile sur les vérités d’un personnage à part. Propos recueillis par Driss Ksikes
"Je ne suis pas un juif marocain, mais un Marocain juif", dites-vous. D’un côté, cette équation montre que vous êtes plus attaché à votre marocanité qu’à votre judaïté. D’un autre, "le drame du dernier juif", récurrent dans votre littérature, montre que l’exode massif des juifs
marocains vers Israël en 1967, vous a terriblement marqué. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Je voudrais tout d’abord préciser mon attitude. Je suis hostile au judéo-centrisme, dont on commence à voir les méfaits. Donc, je ne parle pas à partir d’une conviction ou d’un point de vue juif. En parlant d’une position marocaine, cela n’a rien de nationaliste. Je n’ai pas de visée politique, mais juste une appartenance à la réalité de mon pays. Je ne me reconnais pas dans ces juifs qui ont écrit, de l’extérieur, pour prendre acte qu’ils ont vécu au Maroc comme "un corps étranger" et qu’à un moment donné, ils ont été rejetés. Ce type d’analyse, loin d’être schématique et fort courant, se lie à une méconnaissance totale de l’histoire du Maroc, de ce que veut dire être juif au Maroc et des conséquences tragiques de leur exode. Ils ne savent pas que c’est "une blessure profonde". Lorsque j’ai dit cela dans un colloque sur les minorités nationales, une historienne de renom m’a rétorqué sur un ton ironique, "la blessure va se cicatriser". Comme si ce n’était pas si grave que cela. Je ne me reconnais pas non plus dans ceux qui défendent la marocanité des juifs, en évoquant la fameuse "tolérance", dont l’islam éclairé et le judaïsme consentant faisaient preuve, moyennant quelques épisodes sombres, de persécution, sous les Almohades, par exemple. J’ai voulu éviter l’idéologie et la langue de bois, et raconter, une fois ce départ massif effectué, la vie des juifs, comme ils ont vécu, avec toutes les insuffisances que cela supporte, dans Mille ans, un jour et plus tard dans Le retour d’Abou AlHaki. J’en viens à l’idée que juifs et musulmans ont partagé le même destin, pour le bien comme pour le pire, partagé une langue, l’arabe ou le berbère, un imaginaire, tout ce qui fait la vie d’un homme. Ils n’avaient pas la même religion, mais ils ont vécu ensemble quand même. On évoque souvent le dhimmi pour minimiser cette cohabitation. On oublie que c’était un statut de protection et non de domination. Et que - ceci est une révolution dont personne ne parle - l’indépendance a fait des juifs des citoyens et plus jamais des protégés. En plus, on occulte le nombre de kabbalistes qui ont existé ici. Ce qui me frappe, surtout, c’est l’immense liberté avec laquelle les juifs ont développé leur quête spirituelle dans ce pays.
Si vous n’aviez pas été antisioniste, auriez-vous traité cette question avec la même intensité ? Auriez-vous noté que ces juifs étaient extirpés de leur terre marocaine par des "rapaces" au service d’Israël ?
Le sionisme est fondamentalement le premier responsable de cette cassure. Je n’insiste pas trop dessus pour ne pas avoir un discours idéologique, mais au fond, le sionisme a tenté conjointement de liquider le peuple palestinien chez lui et, dans une logique incontestable, détruire les communautés juives dans le monde arabe. Au lendemain de l’exode des juifs marocains orchestré en 1967, je n’avais pas de projet politique préalable que mon écriture serait venue illustrer. Mais lorsque la revue, Les temps modernes, a publié un numéro sur les juifs marocains et que j’ai lu ce que soutenaient certains auteurs, comme Albert Memmi sur les juifs sépharades dans le monde arabe, et les amalgames qu’ils faisaient, ma réaction a été d’écrire pour m’insurger contre la manipulation de l’Histoire et la vision idéologique mensongère qu’ils développaient. A partir de là, j’ai perçu la nécessité de défendre une certaine liberté d’être juif, en accord avec mon enracinement dans mon pays. J’ai d’abord écrit des articles ouvertement politiques dans la revue Études palestiniennes. Puis vint le choc émotionnel de l’invasion du Liban en 1982. Dans le feu, le désir et la volonté de casser la discours idéologique et politique, s’est enclenché ce que j’appelle une procédure d’écriture-mémoire, à travers laquelle des images archaïques, fondamentales, évoquent autant un précieux coffret de thuya tenu par un juif marocain qu’un enfant brûlé au napalm au Liban. On m’a accusé alors de souhaiter la destruction d’Israël. Une éditrice m’a même dit : "Pourquoi vous êtes encombré par le problème palestinien ?". Voyant que mon texte n’était pas si nul que cela, elle ajouta, "vous auriez très bien pu écrire une simple histoire d’un jeune juif marocain".
Est-ce toujours l’antisionisme qui vous a rapproché de Jean Genet qui, lui, a cherché à donner de la visibilité à la question palestinienne ?
Genet, je l’ai rencontré à Paris. Il y a eu Sabra et Chatila puis Le captif amoureux. Et ce que j’ai trouvé chez lui est la confirmation que, par les voies de la création littéraire, on pouvait parvenir à une certaine vérité humaine. Cela a approfondi les affinités entre nous.
Dans une vie antérieure, vous avez été un dirigeant du parti communiste. Vous vous êtes à peine inspiré de cette période pour évoquer ce qui s’est passé en 1965 dans Le parcours immobile. Pourquoi n’avez-vous jamais écrit sur votre expérience politique ?
Au risque d'en surprendre plus d’un, je vous affirme que je ne suis pas un homme politique et je ne l’ai jamais été. Cela peut paraître paradoxal, vu mon engagement. Mais quand j’ai adhéré au PC en 1945, à Casablanca, où vivait ma famille, il y avait un idéal. S’est greffé pour moi le désir d’indépendance, de liberté. Sur le terrain, notre action transcendait le réel. On rêvait d’une humanité nouvelle, de la chaleur, de la fraternité. Et tout mon parcours a été déterminé par mon statut de jeune juif, provenant d’une famille bourgeoise, plongé au cœur du peuple. Je me suis retrouvé, du jour au lendemain, partageant la vie de fellahs, de dockers. Grâce à ces gens, j’ai découvert en moi le Marocain vivant, partageant la harira avec les gens, habitant dans des douars, etc. Tout cela m’a métamorphosé. Ce capital inestimable, j’en tire une grande fierté et il m’en est resté une admiration, un attachement, au peuple marocain, aussi longtemps que cette notion continue d’exister et n’est pas réduite à néant par celle des "masses populaires". J’ai, dans un premier temps, au début des années 80, voulu sauvegarder cette expérience et été tenté d’écrire sur mon parcours proprement politique, communiste. J’ai même commencé un livre que j’allais intituler "Le jumeau du parcours immobile". Mais j’y ai renoncé. Parce qu’en me remettant dans l’expérience, j’allais ressortir plusieurs exemples négatifs. Or, j’ai considéré que l’autobiographie à la Semprun était le modèle à éviter. C’est ainsi que je me suis orienté vers l’ouverture littéraire.
Vous avez quitté le Maroc en 1965 et n’êtes revenu, la première fois qu’en 1975. Entre temps, vous ne vous êtes jamais considéré comme un exilé politique. Pourquoi ?
Quand j’ai démissionné du bureau politique en 1959, j’ai rompu définitivement avec la politique. Mon unique intervention que l’on peut considérer comme politique est en lien avec la Palestine. Je suis parti en 1965, parce que j’avais été emprisonné, épuisé par 14 ans de vie militante et incapable de rester pour affronter de nouvelles complications. En plus, le contrat de mon épouse, Marie-Cécile, comme coopérante, arrivait à expiration. Je suis donc parti et ma décision politique était de me désengager, donc je ne pouvais me prévaloir d’un statut d’exilé. Mais quoiqu'installé à Paris, j’ai toujours refusé d’avoir la nationalité française. Depuis 1975, j’ai fait énormément d’aller-retour. La réalité marocaine a toujours été l’aliment fondamental de mon écriture.
Et la darija, un condiment indispensable pour donner à vos textes littéraires une identité propre ?
Il ne faut pas oublier que l’arabe est ma langue maternelle. Nous n’avons jamais parlé l’hébreu. Cette langue était morte jusqu’au jour où les sionistes ont décidé de lui redonner vie. Il y a eu chez les juifs marocains une ouverture sur le français. Donc, lorsque j’introduisais l’arabe dans mes textes, ce n’était nullement comme si je mettais des épices exotiques. J’avais conscience de ma conditions ambiguë, complexe, difficile, d’être hors de ma langue maternelle, dans l’écriture. Aujourd’hui, je suis également intéressé par la relation qui existe entre l’arabe classique et dialectal, et sur l’ouverture qui peut se créer en direction du berbère.
Outre votre apport littéraire, vous êtes l’un des plus grands connaisseurs de la peinture marocaine. Votre approche singulière, vous la devez à votre formation philosophique ou à vos liens étroits avec certains artistes ?
Certainement pas de la philosophie. Et c’est d’ailleurs cela qui me prémunit de l’aborder avec un bagage théorique. C’est tout d’abord ma rencontre avec Ahmed Cherkaoui en 1965 qui a été déterminante. Il en est né une amitié profonde et une perception commune que la pratique du dessin, des arts plastiques, est quelque chose d’enracinée dans la réalité marocaine. D’autres liens, toujours à Paris, avec Fouad Bellamine, Mohamed Kacimi et Khalil Gharib, sont venus renforcer ce sentiment et nourrir certains de mes écrits, comme L’œil et la main. Aujourd’hui, mon intérêt pour la peinture va grandissant et mon sentiment est que sa participation au corps de la société marocaine s’approfondit. Mais je ne pense pas avoir abouti à une théorie et je refuse que l’on réédite mes écrits comme s’il s’agissait de références en la matière. Je rejette aussi l’optique des critiques d’art avec tout ce que cela suppose comme usage de jargon. Enfin, je déplore, en ce qui concerne le Maroc en particulier, l’absence d’une vision claire de ce qu’est la peinture marocaine. Au lieu d’aller dans l’épaisseur secrète des toiles, on produit un discours métaphysique. Il nous faut une cure, pour nous débarrasser de ce bavardage et un peu d’humilité pour aller vers les peintres. Je le dis d’autant que je crois en l’existence d’une parenté profonde entre peinture et écriture. Les deux sont une forme de tissage.
Portrait : Les fidélités d’un grand homme
Même s’il a été dirigeant du parti communiste jusqu’à sa démission en 1959, militant persécuté jusqu’à son départ en France en 1965, antisioniste notoire depuis l’exode massif des juifs marocains vers Israël orchestré en 1967, journaliste et critique littéraire dans Le Monde, depuis 1974, ami d’artistes et fin connaisseur des arts plastiques marocains, publié depuis 1975, écrivain et romancier, comparé à un Joyce, depuis Le Parcours immobile, en 1980, Edmond Amran El Maleh demeure peu connu. Et si l’on devait retracer son parcours, un seul mot s’impose : fidélité. Cet homme, lucide et humble à la fois, est d’abord resté fidèle à son pays, le Maroc, pour apprécier de près la pluralité culturelle de ce creuset qui lui permet d’être ce qu’il est. Il a ensuite été fidèle à la mémoire de sa femme, la philosophe Marie-Cécile Dufour, et au penseur Walter Benjamin, objet de ses recherches à elle et de sa curiosité intellectuelle à lui. Ils constituaient, à Montparnasse, un ménage à trois. Il est également fidèle à sa manière subversive d’écrire, au rythme de la mémoire, de la déchirure, avec ses mots en arabe du terroir qui surgissent pour rappeler sa marocanité. Fidèle à ses amis, Mohamed Berrada et Leila Chahid, avec lesquels il partage la passion de l’écrit et la brûlure de la Palestine ; le critique Mehdi Akhrif et le peintre Khalil Gharib, avec lesquels il apprécie le bleu d’Asilah, la force poétique de l’une de ses muses, Fernando Pessoa, et la force créatrice du geste pictural ; Juan Goytisolo, un auteur non mondain comme lui ; Hassan Bourqia son traducteur et Abdelhaq Jouitey, son ami de Beni Mellal, où il va pour partager un moment de quiétude; les chauffeurs de taxi, hommes du peuple dont il se sent toujours proche ; et ses lectures, sur le soufisme et la kabbale, ces deux versants d’une culture marocaine, millénaire et spirituelle. Depuis qu’il est revenu définitivement au bercail en 1998, seul, il avait un rêve politique : que l’alternance aboutisse. Il en a fait son deuil. Et un rêve culturel : continuer la bataille pour un Maroc réellement pluriel. Comme à Paris, cet homme singulier ne s’est jamais laissé impressionner par les discours de salon. Il continue de croire en la capacité des Marocains à réinventer leur richesse. Et si les juifs ne sont plus légion, il est surtout concerné aujourd’hui par l’ouverture qui s’amorce envers les Amazighs. Signe de cette générosité qui le caractérise.
© 2003 TelQuel Magazine. Maroc. Tous droits résérvés
A 86 ans, Edmond Amran El Maleh reste un écrivain discret. En l’interrogeant sur son rapport à la judaïté, à la Palestine, au Maroc, à son passé de communiste, à la peinture, nous levons le voile sur les vérités d’un personnage à part. Propos recueillis par Driss Ksikes
"Je ne suis pas un juif marocain, mais un Marocain juif", dites-vous. D’un côté, cette équation montre que vous êtes plus attaché à votre marocanité qu’à votre judaïté. D’un autre, "le drame du dernier juif", récurrent dans votre littérature, montre que l’exode massif des juifs
marocains vers Israël en 1967, vous a terriblement marqué. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Je voudrais tout d’abord préciser mon attitude. Je suis hostile au judéo-centrisme, dont on commence à voir les méfaits. Donc, je ne parle pas à partir d’une conviction ou d’un point de vue juif. En parlant d’une position marocaine, cela n’a rien de nationaliste. Je n’ai pas de visée politique, mais juste une appartenance à la réalité de mon pays. Je ne me reconnais pas dans ces juifs qui ont écrit, de l’extérieur, pour prendre acte qu’ils ont vécu au Maroc comme "un corps étranger" et qu’à un moment donné, ils ont été rejetés. Ce type d’analyse, loin d’être schématique et fort courant, se lie à une méconnaissance totale de l’histoire du Maroc, de ce que veut dire être juif au Maroc et des conséquences tragiques de leur exode. Ils ne savent pas que c’est "une blessure profonde". Lorsque j’ai dit cela dans un colloque sur les minorités nationales, une historienne de renom m’a rétorqué sur un ton ironique, "la blessure va se cicatriser". Comme si ce n’était pas si grave que cela. Je ne me reconnais pas non plus dans ceux qui défendent la marocanité des juifs, en évoquant la fameuse "tolérance", dont l’islam éclairé et le judaïsme consentant faisaient preuve, moyennant quelques épisodes sombres, de persécution, sous les Almohades, par exemple. J’ai voulu éviter l’idéologie et la langue de bois, et raconter, une fois ce départ massif effectué, la vie des juifs, comme ils ont vécu, avec toutes les insuffisances que cela supporte, dans Mille ans, un jour et plus tard dans Le retour d’Abou AlHaki. J’en viens à l’idée que juifs et musulmans ont partagé le même destin, pour le bien comme pour le pire, partagé une langue, l’arabe ou le berbère, un imaginaire, tout ce qui fait la vie d’un homme. Ils n’avaient pas la même religion, mais ils ont vécu ensemble quand même. On évoque souvent le dhimmi pour minimiser cette cohabitation. On oublie que c’était un statut de protection et non de domination. Et que - ceci est une révolution dont personne ne parle - l’indépendance a fait des juifs des citoyens et plus jamais des protégés. En plus, on occulte le nombre de kabbalistes qui ont existé ici. Ce qui me frappe, surtout, c’est l’immense liberté avec laquelle les juifs ont développé leur quête spirituelle dans ce pays.
Si vous n’aviez pas été antisioniste, auriez-vous traité cette question avec la même intensité ? Auriez-vous noté que ces juifs étaient extirpés de leur terre marocaine par des "rapaces" au service d’Israël ?
Le sionisme est fondamentalement le premier responsable de cette cassure. Je n’insiste pas trop dessus pour ne pas avoir un discours idéologique, mais au fond, le sionisme a tenté conjointement de liquider le peuple palestinien chez lui et, dans une logique incontestable, détruire les communautés juives dans le monde arabe. Au lendemain de l’exode des juifs marocains orchestré en 1967, je n’avais pas de projet politique préalable que mon écriture serait venue illustrer. Mais lorsque la revue, Les temps modernes, a publié un numéro sur les juifs marocains et que j’ai lu ce que soutenaient certains auteurs, comme Albert Memmi sur les juifs sépharades dans le monde arabe, et les amalgames qu’ils faisaient, ma réaction a été d’écrire pour m’insurger contre la manipulation de l’Histoire et la vision idéologique mensongère qu’ils développaient. A partir de là, j’ai perçu la nécessité de défendre une certaine liberté d’être juif, en accord avec mon enracinement dans mon pays. J’ai d’abord écrit des articles ouvertement politiques dans la revue Études palestiniennes. Puis vint le choc émotionnel de l’invasion du Liban en 1982. Dans le feu, le désir et la volonté de casser la discours idéologique et politique, s’est enclenché ce que j’appelle une procédure d’écriture-mémoire, à travers laquelle des images archaïques, fondamentales, évoquent autant un précieux coffret de thuya tenu par un juif marocain qu’un enfant brûlé au napalm au Liban. On m’a accusé alors de souhaiter la destruction d’Israël. Une éditrice m’a même dit : "Pourquoi vous êtes encombré par le problème palestinien ?". Voyant que mon texte n’était pas si nul que cela, elle ajouta, "vous auriez très bien pu écrire une simple histoire d’un jeune juif marocain".
Est-ce toujours l’antisionisme qui vous a rapproché de Jean Genet qui, lui, a cherché à donner de la visibilité à la question palestinienne ?
Genet, je l’ai rencontré à Paris. Il y a eu Sabra et Chatila puis Le captif amoureux. Et ce que j’ai trouvé chez lui est la confirmation que, par les voies de la création littéraire, on pouvait parvenir à une certaine vérité humaine. Cela a approfondi les affinités entre nous.
Dans une vie antérieure, vous avez été un dirigeant du parti communiste. Vous vous êtes à peine inspiré de cette période pour évoquer ce qui s’est passé en 1965 dans Le parcours immobile. Pourquoi n’avez-vous jamais écrit sur votre expérience politique ?
Au risque d'en surprendre plus d’un, je vous affirme que je ne suis pas un homme politique et je ne l’ai jamais été. Cela peut paraître paradoxal, vu mon engagement. Mais quand j’ai adhéré au PC en 1945, à Casablanca, où vivait ma famille, il y avait un idéal. S’est greffé pour moi le désir d’indépendance, de liberté. Sur le terrain, notre action transcendait le réel. On rêvait d’une humanité nouvelle, de la chaleur, de la fraternité. Et tout mon parcours a été déterminé par mon statut de jeune juif, provenant d’une famille bourgeoise, plongé au cœur du peuple. Je me suis retrouvé, du jour au lendemain, partageant la vie de fellahs, de dockers. Grâce à ces gens, j’ai découvert en moi le Marocain vivant, partageant la harira avec les gens, habitant dans des douars, etc. Tout cela m’a métamorphosé. Ce capital inestimable, j’en tire une grande fierté et il m’en est resté une admiration, un attachement, au peuple marocain, aussi longtemps que cette notion continue d’exister et n’est pas réduite à néant par celle des "masses populaires". J’ai, dans un premier temps, au début des années 80, voulu sauvegarder cette expérience et été tenté d’écrire sur mon parcours proprement politique, communiste. J’ai même commencé un livre que j’allais intituler "Le jumeau du parcours immobile". Mais j’y ai renoncé. Parce qu’en me remettant dans l’expérience, j’allais ressortir plusieurs exemples négatifs. Or, j’ai considéré que l’autobiographie à la Semprun était le modèle à éviter. C’est ainsi que je me suis orienté vers l’ouverture littéraire.
Vous avez quitté le Maroc en 1965 et n’êtes revenu, la première fois qu’en 1975. Entre temps, vous ne vous êtes jamais considéré comme un exilé politique. Pourquoi ?
Quand j’ai démissionné du bureau politique en 1959, j’ai rompu définitivement avec la politique. Mon unique intervention que l’on peut considérer comme politique est en lien avec la Palestine. Je suis parti en 1965, parce que j’avais été emprisonné, épuisé par 14 ans de vie militante et incapable de rester pour affronter de nouvelles complications. En plus, le contrat de mon épouse, Marie-Cécile, comme coopérante, arrivait à expiration. Je suis donc parti et ma décision politique était de me désengager, donc je ne pouvais me prévaloir d’un statut d’exilé. Mais quoiqu'installé à Paris, j’ai toujours refusé d’avoir la nationalité française. Depuis 1975, j’ai fait énormément d’aller-retour. La réalité marocaine a toujours été l’aliment fondamental de mon écriture.
Et la darija, un condiment indispensable pour donner à vos textes littéraires une identité propre ?
Il ne faut pas oublier que l’arabe est ma langue maternelle. Nous n’avons jamais parlé l’hébreu. Cette langue était morte jusqu’au jour où les sionistes ont décidé de lui redonner vie. Il y a eu chez les juifs marocains une ouverture sur le français. Donc, lorsque j’introduisais l’arabe dans mes textes, ce n’était nullement comme si je mettais des épices exotiques. J’avais conscience de ma conditions ambiguë, complexe, difficile, d’être hors de ma langue maternelle, dans l’écriture. Aujourd’hui, je suis également intéressé par la relation qui existe entre l’arabe classique et dialectal, et sur l’ouverture qui peut se créer en direction du berbère.
Outre votre apport littéraire, vous êtes l’un des plus grands connaisseurs de la peinture marocaine. Votre approche singulière, vous la devez à votre formation philosophique ou à vos liens étroits avec certains artistes ?
Certainement pas de la philosophie. Et c’est d’ailleurs cela qui me prémunit de l’aborder avec un bagage théorique. C’est tout d’abord ma rencontre avec Ahmed Cherkaoui en 1965 qui a été déterminante. Il en est né une amitié profonde et une perception commune que la pratique du dessin, des arts plastiques, est quelque chose d’enracinée dans la réalité marocaine. D’autres liens, toujours à Paris, avec Fouad Bellamine, Mohamed Kacimi et Khalil Gharib, sont venus renforcer ce sentiment et nourrir certains de mes écrits, comme L’œil et la main. Aujourd’hui, mon intérêt pour la peinture va grandissant et mon sentiment est que sa participation au corps de la société marocaine s’approfondit. Mais je ne pense pas avoir abouti à une théorie et je refuse que l’on réédite mes écrits comme s’il s’agissait de références en la matière. Je rejette aussi l’optique des critiques d’art avec tout ce que cela suppose comme usage de jargon. Enfin, je déplore, en ce qui concerne le Maroc en particulier, l’absence d’une vision claire de ce qu’est la peinture marocaine. Au lieu d’aller dans l’épaisseur secrète des toiles, on produit un discours métaphysique. Il nous faut une cure, pour nous débarrasser de ce bavardage et un peu d’humilité pour aller vers les peintres. Je le dis d’autant que je crois en l’existence d’une parenté profonde entre peinture et écriture. Les deux sont une forme de tissage.
Portrait : Les fidélités d’un grand homme
Même s’il a été dirigeant du parti communiste jusqu’à sa démission en 1959, militant persécuté jusqu’à son départ en France en 1965, antisioniste notoire depuis l’exode massif des juifs marocains vers Israël orchestré en 1967, journaliste et critique littéraire dans Le Monde, depuis 1974, ami d’artistes et fin connaisseur des arts plastiques marocains, publié depuis 1975, écrivain et romancier, comparé à un Joyce, depuis Le Parcours immobile, en 1980, Edmond Amran El Maleh demeure peu connu. Et si l’on devait retracer son parcours, un seul mot s’impose : fidélité. Cet homme, lucide et humble à la fois, est d’abord resté fidèle à son pays, le Maroc, pour apprécier de près la pluralité culturelle de ce creuset qui lui permet d’être ce qu’il est. Il a ensuite été fidèle à la mémoire de sa femme, la philosophe Marie-Cécile Dufour, et au penseur Walter Benjamin, objet de ses recherches à elle et de sa curiosité intellectuelle à lui. Ils constituaient, à Montparnasse, un ménage à trois. Il est également fidèle à sa manière subversive d’écrire, au rythme de la mémoire, de la déchirure, avec ses mots en arabe du terroir qui surgissent pour rappeler sa marocanité. Fidèle à ses amis, Mohamed Berrada et Leila Chahid, avec lesquels il partage la passion de l’écrit et la brûlure de la Palestine ; le critique Mehdi Akhrif et le peintre Khalil Gharib, avec lesquels il apprécie le bleu d’Asilah, la force poétique de l’une de ses muses, Fernando Pessoa, et la force créatrice du geste pictural ; Juan Goytisolo, un auteur non mondain comme lui ; Hassan Bourqia son traducteur et Abdelhaq Jouitey, son ami de Beni Mellal, où il va pour partager un moment de quiétude; les chauffeurs de taxi, hommes du peuple dont il se sent toujours proche ; et ses lectures, sur le soufisme et la kabbale, ces deux versants d’une culture marocaine, millénaire et spirituelle. Depuis qu’il est revenu définitivement au bercail en 1998, seul, il avait un rêve politique : que l’alternance aboutisse. Il en a fait son deuil. Et un rêve culturel : continuer la bataille pour un Maroc réellement pluriel. Comme à Paris, cet homme singulier ne s’est jamais laissé impressionner par les discours de salon. Il continue de croire en la capacité des Marocains à réinventer leur richesse. Et si les juifs ne sont plus légion, il est surtout concerné aujourd’hui par l’ouverture qui s’amorce envers les Amazighs. Signe de cette générosité qui le caractérise.
© 2003 TelQuel Magazine. Maroc. Tous droits résérvés
|
Re: EDMOND AMRAM L MALEH DANS TEL QUEL 05 janvier 2005, 12:14 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 873 |
|
Re: EDMOND AMRAM L MALEH DANS TEL QUEL 08 janvier 2005, 06:58 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 161 |
Pour Hassan et Mimi cet article qui va de façon expotentielle va « alourdir » encore Dafina.
Lahcen Aouad, journaliste de l'hebdomadaire Assahifa Al Ousbouia, a été agressé, le 9 décembre 2004 à Rabat, par des membres des forces de l'ordre. Mohammed Bouhcini, collaborateur du magazine hebdomadaire Tel Quel, a été interpellé et inculpé de " trafic de drogue " après avoir servi de guide à une journaliste qui réalisait un reportage sur les circuits de drogue dans la région du Rif central.
Merci à notre chère Dafouineuse soit passer l’article en entier, de le déplacer, de donner simplement l’adresse du site. Bref de faire son travail excellent et surmenant de modératrice.
[www.rsf.org] ou que les fafinistes interressés contactent Agnès Devictor, RSF, 5, rue Geoffroy Marie, Paris 75009, France, tél: +33 1 44 83 84 84, téléc: +33 1 45 23 11 51, courrier électronique: norddelafrique@rsf.org, Internet: [www.rsf.org]. D’autres sources peuvent vous êtres tranmises en m’envoyant un mail
Reporters sans frontières condamne fermement le recours à la violence contre un journaliste ainsi qu'une instrumentalisation de la justice en vue d'intimider les professionnels des médias.
L'organisation demande aux autorités de mener une enquête sérieuse et approfondie afin que les auteurs de l'agression contre Lahcen Aouad soient identifiés et punis dans les meilleurs délais.
Reporters sans frontières demande par ailleurs aux autorités marocaines de produire les preuves de la culpabilité de M. Bouhcini ou d'ordonner sa libération immédiate.
Le 9 décembre dernier, à Rabat, des diplômés-chômeurs marocains ont organisé une marche, du Parlement au siège du Premier ministre, pour "revendiquer leur droit légitime et légal au travail". Le journaliste Lahcen Aouad couvrait l'événement pour Assahifa Al Ousbouia.
Les nombreux policiers présents sur les lieux lui ont réclamé à plusieurs reprises sa carte de presse. Il a d'abord été insulté et menacé pour qu'il quitte les lieux. Alors qu'il photographiait des manifestants tabassés par les forces de l'ordre, le journaliste a été victime, à son tour, de coups de pied et de bâton. Les policiers ont même essayé de lui prendre son appareil photo. M. Aouad souffre aujourd'hui de multiples contusions à la cuisse et à la tête, qui lui valent un arrêt de travail de 22 jours.
Après avoir passé une semaine dans les montagnes du Rif pour un reportage sur le trafic de drogue, la journaliste du magazine Tel quel, Chadwane Bensalmia, est rentrée à sa rédaction à Casablanca, le 12 décembre 2004. Le jour même, son collaborateur à Ouezzane (à environ 220 km de Casablanca), Mohamed Bouhcini, a reçu des menaces anonymes sur son portable pour avoir servi de guide à la journaliste. Le 13 décembre , ce dernier a été convoqué au bureau du commissaire principal de Ouezzane pour apprendre qu'un prisonnier, condamné pour trafic de drogue, l'accusait de lui avoir livré du haschich. Pourtant, comme les registres l'attestent, M. Bouhcini n'a jamais mis les pieds dans la prison de Ouezzane. Suite à ce témoignage, le collaborateur a été écroué dans la même prison que le plaignant. Depuis ce jour, M. Bouhcini est incarcéré sans qu'aucune plainte ait été déposée contre lui.
Fait exceptionnel, c'est le procureur du Roi en personne, M. Yassine Oumama, qui a demandé que le collaborateur soit présenté au juge d'instruction. Mohammed Bouhcini risque jusqu'à huit ans de détention si l'accusation de trafic de drogue est retenue. Trois demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées.
Joint par téléphone, Ahmed R. Benchemsi, directeur de la rédaction à Tel Quel, a déclaré à Reporters sans frontières, que " l'incarcération de Mohammed Bouhcini est une atteinte flagrante à la liberté d'informer. […] Inquiéter les sources et les contacts des journalistes est une nouvelle méthode pour les intimider et les empêcher de faire leur travail ".
Plusieurs rédactions marocaines, dont Al Ayyam, Al Ahdath Al Maghribiya et le Journal Hebdomadaire, ont rallié un mouvement de solidarité qui demande la libération de Mohamed Bouhcini.
Lahcen Aouad, journaliste de l'hebdomadaire Assahifa Al Ousbouia, a été agressé, le 9 décembre 2004 à Rabat, par des membres des forces de l'ordre. Mohammed Bouhcini, collaborateur du magazine hebdomadaire Tel Quel, a été interpellé et inculpé de " trafic de drogue " après avoir servi de guide à une journaliste qui réalisait un reportage sur les circuits de drogue dans la région du Rif central.
Merci à notre chère Dafouineuse soit passer l’article en entier, de le déplacer, de donner simplement l’adresse du site. Bref de faire son travail excellent et surmenant de modératrice.
[www.rsf.org] ou que les fafinistes interressés contactent Agnès Devictor, RSF, 5, rue Geoffroy Marie, Paris 75009, France, tél: +33 1 44 83 84 84, téléc: +33 1 45 23 11 51, courrier électronique: norddelafrique@rsf.org, Internet: [www.rsf.org]. D’autres sources peuvent vous êtres tranmises en m’envoyant un mail
Reporters sans frontières condamne fermement le recours à la violence contre un journaliste ainsi qu'une instrumentalisation de la justice en vue d'intimider les professionnels des médias.
L'organisation demande aux autorités de mener une enquête sérieuse et approfondie afin que les auteurs de l'agression contre Lahcen Aouad soient identifiés et punis dans les meilleurs délais.
Reporters sans frontières demande par ailleurs aux autorités marocaines de produire les preuves de la culpabilité de M. Bouhcini ou d'ordonner sa libération immédiate.
Le 9 décembre dernier, à Rabat, des diplômés-chômeurs marocains ont organisé une marche, du Parlement au siège du Premier ministre, pour "revendiquer leur droit légitime et légal au travail". Le journaliste Lahcen Aouad couvrait l'événement pour Assahifa Al Ousbouia.
Les nombreux policiers présents sur les lieux lui ont réclamé à plusieurs reprises sa carte de presse. Il a d'abord été insulté et menacé pour qu'il quitte les lieux. Alors qu'il photographiait des manifestants tabassés par les forces de l'ordre, le journaliste a été victime, à son tour, de coups de pied et de bâton. Les policiers ont même essayé de lui prendre son appareil photo. M. Aouad souffre aujourd'hui de multiples contusions à la cuisse et à la tête, qui lui valent un arrêt de travail de 22 jours.
Après avoir passé une semaine dans les montagnes du Rif pour un reportage sur le trafic de drogue, la journaliste du magazine Tel quel, Chadwane Bensalmia, est rentrée à sa rédaction à Casablanca, le 12 décembre 2004. Le jour même, son collaborateur à Ouezzane (à environ 220 km de Casablanca), Mohamed Bouhcini, a reçu des menaces anonymes sur son portable pour avoir servi de guide à la journaliste. Le 13 décembre , ce dernier a été convoqué au bureau du commissaire principal de Ouezzane pour apprendre qu'un prisonnier, condamné pour trafic de drogue, l'accusait de lui avoir livré du haschich. Pourtant, comme les registres l'attestent, M. Bouhcini n'a jamais mis les pieds dans la prison de Ouezzane. Suite à ce témoignage, le collaborateur a été écroué dans la même prison que le plaignant. Depuis ce jour, M. Bouhcini est incarcéré sans qu'aucune plainte ait été déposée contre lui.
Fait exceptionnel, c'est le procureur du Roi en personne, M. Yassine Oumama, qui a demandé que le collaborateur soit présenté au juge d'instruction. Mohammed Bouhcini risque jusqu'à huit ans de détention si l'accusation de trafic de drogue est retenue. Trois demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées.
Joint par téléphone, Ahmed R. Benchemsi, directeur de la rédaction à Tel Quel, a déclaré à Reporters sans frontières, que " l'incarcération de Mohammed Bouhcini est une atteinte flagrante à la liberté d'informer. […] Inquiéter les sources et les contacts des journalistes est une nouvelle méthode pour les intimider et les empêcher de faire leur travail ".
Plusieurs rédactions marocaines, dont Al Ayyam, Al Ahdath Al Maghribiya et le Journal Hebdomadaire, ont rallié un mouvement de solidarité qui demande la libération de Mohamed Bouhcini.
|
Re: EDMOND AMRAM L MALEH DANS TEL QUEL 12 janvier 2005, 04:22 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 7 |
|
Re: EDMOND AMRAM L MALEH DANS TEL QUEL 28 juin 2005, 03:38 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 357 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.