|
Ce
nom vient évidemment du mot hébreu Tsarfat,
désignant la France. Les ancêtres de la famille sont donc
originaires de ce pays. Après l’expulsion des juifs de France par
Philippe le Bel en 1306, un certain nombre d’entre eux se réfugient
en Espagne où ils choisissent des patronymes, souvent d’après
leur région d’origine. Parfois, dans des contrats entre juifs et
chrétiens, le nom a été traduit en « Frances » ou
« Franco ». La transcription de ce nom en lettres
latines varie suivant les prononciations et les langues. Après
l’expulsion d’Espagne, on retrouve ce nom dans tout le Bassin méditerranéen,
mais aussi en Angleterre, et plus tard en Hollande. La transcription
du nom Hassarfati en Serfaty, pourrait être la conséquence de
l’esprit colonialiste après 1912 qui, en éliminant le « Ha »,
annulait ce qui aurait pu paraître être un « titre
aristocratique », et en plaçant un « y »
(initiative bizarre : pourquoi cette lettre ?), était-ce
un moyen d’éviter une prétendue origine corse ou italienne ?
L’arbre
généalogique (ci dessous),
remonte certainement aux environs de 1450. Une ancienne tradition très
ancrée, retrouvée dans les ketoubot
familiales, le fait remonter à Rabbenou-Tam petit-fils de Rashi. Le
célèbre « Ha-hidah » (R. Haim Yossef David
Azoulay, né à Jérusalem, 1724-1806) rappelle cette ascendance.
Cependant il manquerait quelque 7 générations, et malgré de
longues recherches dans ce qui reste d’archives en Espagne, il
n’a pas été possible de combler ce vide (bien que l’on ait
retrouvé des rabbins célèbres du même nom, sans toutefois établir
de lien véritable). Cependant, seule la famille Hassarfati de Fès
conserve cette tradition. De quelle région d’Espagne cette
famille est-elle originaire ? Une tradition parle de la
Castille, et le fait est qu’ils transmettaient à Fès les
« taqqanot des juifs
expulsés de Castille ». Par ailleurs, le prénom Vidal, qui
revient constamment dans la famille, semblait être fréquent en
Aragon et en Catalogne, où la langue était le français ou ses dérivés.
Le mot hébraïque Haïm (vie) aurait été traduit par Vital en
espagnol et retranscrit Vidal en français (langue considérée
« dure » par rapport à l’espagnol) [15].
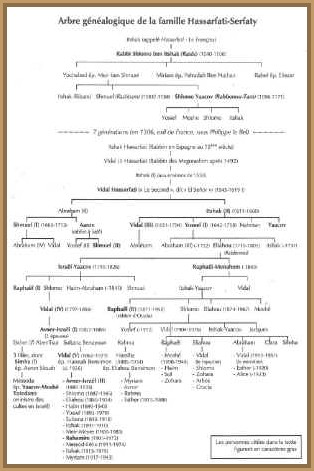
Arbre
genealogique de la famille Hassarfati-Serfaty
Cliquez dessus pour agrandir
Depuis
leur arrivée à Fès, après l’expulsion d’Espagne, les
Hassarfati ont engendré une longue lignée de rabbins, d’abord
des Megorashim, puis de la communauté dans son ensemble.
Parmi
ces nombreux ascendants, nous citerons, par ordre chronologique
[4,5,16,17] :
I)
Rabbi Vidal Hassarfati le second
(1545-1619 ?), appelé
aussi « El Señor » ou « Hakadmon » (l’Ancien),
fils de R. Itshak (I) et petit-fils de R. Vidal (I), également
juges célèbres à Fès. Ha-hidah écrit à son propos :
« l’un des génies de l’occident ». Il possède une
culture immense et cite aussi bien Platon, Aristote, Euclide, Sénèque,
que des philosophes arabes et évidemment Rambam, Yehuda Halevi et
tous les maîtres de la Torah. Il se réfère constamment à la
Kabbale. Il est aussi médecin.
Il
possède une importante bibliothèque et une partie de ses écrits
est encore sous forme de manuscrits. Ses principales œuvres sont « Piroush
le midrash rabah », publié à Varsovie en 1874, et
surtout le célèbre « Tsouf
dvach » (Nectar du miel), publié à Amsterdam en 1718. Ce
livre est un commentaire de la Torah auquel seront jointes des
explications sur les meguilot.
Sa diffusion dans tout le monde juif fut importante. Écrit dans un
style très concis, il a été réédité à différentes époques.
Rabbi Vidal avait la réputation de faire des miracles [18,19].
En
1884, le sultan Moulay Hassan I décide d’agrandir l’espace de
son palais et fait déplacer le vieux cimetière juif. La sépulture
de R. Vidal est la seule à rester à son emplacement sur une
petite hauteur, contre la nouvelle enceinte. De l’autre côté se
trouvait un établissement de bains juif. Les anciens du mellah
racontent que les eaux sales s’infiltraient dans la tombe et ses
alentours. Les rabbins demandèrent aux propriétaires de réparer
ou de se déplacer. Ils refusèrent. Un jour, un jeune homme prenant
son bain vit R. Vidal lui apparaître. Il raconta ce fait à
ses parents qui n’y prêtèrent point attention. Quelques jours
après le jeune homme décéda. Du jour au lendemain le bain fut en
faillite, puis détruit et les propriétaires réduits à la misère.
II)
Rabbi Itshak (II) (1611-1660), fils de R. Vidal (II), appelé
le « naguid »
(chef de la communauté, rôle important proposé par elle et devant
être approuvé, et parfois imposé par l’autorité musulmane). Il
remplit les deux fonctions de Dayan (juge) et Sheikh el Yehud (chef
des juifs, en arabe) à partir de 1642. Il est soutenu aussi bien
par les Megorashim que par les Toshavim. Mais bien plus ardue est sa
tâche dans les relations avec les autorités musulmanes qui exigent
constamment des sommes énormes. Moulay Mohamed Sherif, fondateur de
la dynastie Alaouite, essaie de le corrompre en 1650. Refusant, tous
ses biens sont confisqués et cherchant à s’enfuir, il est
emprisonné avec ses deux fils aînés et ne sera libéré qu’après
avoir versé une lourde caution. Il reprendra ses fonctions. Il
avait de plus sa yeshiva, et était connu pour ses sermons et
commentaires. Comme d’autres rabbins du Maroc, il expliquera que
la coutume du pèlerinage sur les tombes des Saints provient de ce
que le Sage « est le fondement du monde » et que Dieu
appliquera sa sentence. Le célèbre Yaavets (Rabbi Yaacov
Aben-Tsour) fera son éloge, rapporté dans « Malkhei
Rabanan » [5]. Son fils Vidal (III) lui succèdera comme
Dayan [20].
III)
Rabbi Shmuel (I) (1660-1713), petit-fils de R. Vidal (II).
Il écrivit son premier livre
« Divre Shmuel » (Paroles de Shmuel) à 39 ans
et, chose rare pour cette époque, fut publié de son vivant.
D’autres œuvres suivront. Il eut comme élève, puis comme
compagnon Yaavets [21].
Son
neveu Shmuel (II), fils de
Aaron, s’expatria à Amsterdam où il fit éditer les livres de
son oncle et de son arrière-grand-père Rabbi Vidal (II) [18]. Il
est possible qu’il soit l’ascendant de la famille de Samuel
Sarphati (1813-1866), célèbre médecin et économiste d’Amsterdam
[22]. Une rue de cette ville porte son nom.
IV)
Rabbi Eliahou (1715-1805) [23], fils de R. Yossef (I)
(1642-1718), qui décrivit les lois rituelles pour la viande selon
la coutume de Fès, et petit-fils de Itshak (II). Appelé Rabbenou,
il est considéré comme l’un des plus éminents rabbins du monde
juif. Dernièrement, des chercheurs ont trouvé des correspondances
de rabbins qui, ne sachant comment résoudre des problèmes de halakha,
proposèrent de se référer au « Roi » ("Hamelekh"),
ainsi était-il surnommé. Sa culture était immense et sa modestie
très grande. Il étudia avec les grands maîtres de l’époque :
R. Yehouda et R. Haïm Ben-Attar, R. Shmuel Elbaz, et
eut pour compagnons R. Haïm Ben-Attar et Yaavets, malgré la
différence d’âge. Ils seront à Tétouan les élèves de R. Menahem
Attia, appelé « le prince du Zohar » vers 1740.
Jeune,
en 1738, il se prépara à se rendre en Eretz Israël (mais il ne
put réaliser ce projet) avec son ami R. Haïm Ben-Attar et ses
disciples qui fondèrent la célèbre yeshiva Knesset Israël à Jérusalem.
Le Baal Shem Tov (1700-1760), fondateur du Hassidisme en Russie,
ayant pris connaissance de l’existence de cette yeshiva, envoya
son beau-frère étudier chez Rabbi Haïm Ben-Attar (appelé depuis « Or
Hahayim » [17]. Il est intéressant de constater que
le judaïsme de Fès, avec ses traditions et sa connaissance de la
Kabbale a, d’une certaine manière, pu influencer le développement
du hassidisme.
De
retour à Fès après Tétouan, R. Eliahou retrouva Yaavets,
devenu le Rav et Av Beth-Din (Président du Tribunal) qui avait créé
le très fameux « Tribunal des Cinq » avec entre autres
R. Eliahou et R. Raphaël-Oved Aben-Tsour (fils de Yaavets).
Jusqu’à nos jours on se réfère aux décisions de ce Tribunal.
Malgré les nombreux malheurs qui accablèrent R. Eliahou, il
poursuivit sa tâche. (Son ami Yaavets avait aussi connu des drames,
ayant perdu seize de ses dix-sept enfants). Orateur exceptionnel, il
a laissé des centaines de manuscrits de ses discours, qui furent
publiés il y a seulement quelques années. Ses principales œuvres
éditées sont « Kol
Eliahou » (La Voix d’Eliahou), « Aderet
Eliahou » (Gloire d’Eliahou), commentaires de la Torah,
et « Naar Bokhe »
(L’adolescent qui pleure), allocutions faites pour les moments de
deuil.
Il
décéda à l’âge de 90 ans. Lorsque la synagogue de la
famille fut fondée, on l’appela
« slah del Eliahou » ou « slah
del Haham » (du Sage). Elle fut délaissée après
l’exode du mellah et dernièrement, malheureusement transformée
en… salle de billard.
Les
anciens racontent qu’un jour, alors qu’il étudiait ou écrivait
dans sa petite chambre, sa servante lui apporta un verre de thé ;
arrivant à la porte, elle entendit la voix de deux hommes. Elle
alla chercher un autre verre et lorsque la porte s’ouvrit, elle
n’y vit que le maître. Étonnée, elle demanda où était la
seconde personne, et Rabbenou aurait répondu qu’il était en
discussion avec le Prophète Eliahou. Le musulman qui occupe
actuellement la maison raconte également cette anecdote et rajoute
qu’au plafond de sa chambre d’études était un crochet auquel
le Rav attachait ses cheveux, l’empêchant ainsi de s’endormir !
Il
eut trois fils, dont R. Israël-Yaacov et R. Raphaël-Menahem,
tous deux Rav de la ville et proches de l’autorité musulmane.
V)
Rabbi Raphaël-Menahem (décédé en 1843). Un jour arriva d’Espagne
un émissaire venant voir le sultan qui, ne pouvant loger en son
palais un chrétien, demanda au naguid
R. Raphaël-Menahem de l’accueillir. Ils devinrent amis.
Quelque temps après, un de ses fils se serait rendu en Espagne. Ne
le voyant pas revenir et inquiet, Rabbi Raphaël-Menahem décida
d’aller le chercher. A cette époque, les lois sur les juifs étaient
encore en vigueur et ils ne pouvaient entrer en Espagne (ce n’est
qu’en 1992, à la commémoration des 500 ans de l’expulsion
d’Espagne, que cette loi, même si elle n’était plus appliquée
depuis des années, sera officiellement abrogée). Il se cacha
jusqu’à ce qu’il arriva chez son ami qui lui demanda après
quelque temps de l’accompagner à la « maison de prières »
à l’occasion d’une fête. Comme il y avait foule, il
l’attacha de ceinture à ceinture par une chaîne. Sur place ils
entendirent le sermon du prêtre qui émettait des paroles
terriblement anti-juives, préconisant que celui qui tue un juif
aura droit au monde futur. Le Rabbi sentant que son ami était
influencé, se détacha lentement et s’enfuit. Lorsque le faux ami
hurla que se trouvait à ses côtés un juif, la foule se précipita
et lyncha un des participants. Mais le Rabbi réussit à se réfugier
chez la mère de son « ami » et lui narra l’événement.
Elle le cacha jusqu’au retour tardif du fils. A son arrivée elle
l’injuria, lui cracha au visage et lui ordonna de raccompagner le
Rabbi jusqu’à ce qu’il puisse rentrer chez lui [5].
VI)
Rabbi Raphaël (I), fils de R. Israël-Yaacov.
Il était un proche du Palais. Il employa tous les moyens possibles
pour sauver Solika Hatsadeket (Solika la Sainte). Lorsque, malgré
tout, on lui trancha la tête, il tint à récupérer le corps en
distribuant de grosses sommes d’argent dans la foule et en
soudoyant les chefs. Rappelons rapidement l’histoire ou l’une de
ses versions. Solika Hachuel, âgée de 14 ans, était d’une
beauté exceptionnelle. Un jour, s’étant disputée avec sa mère,
elle se réfugia chez sa voisine musulmane à Tanger, avec laquelle
elle s’était liée d’amitié. Celle-ci tenta de la convertir à
l’islam, et ce essentiellement par jalousie.
Devant
son refus, la famille musulmane annonça qu’elle s’était
convertie à l’islam, ce qui devait l’empêcher désormais de
revenir au judaïsme sous peine de mort. Refusant le mensonge, elle
déclara que son seul Dieu était le Dieu d’Israël et que jamais
elle n’avait accepté l’islam. Le témoignage d’un juif
n’ayant aucune valeur face à celui d’un musulman, elle fut
condamnée à mort. On la fit venir devant le sultan à Fès, et
malgré les cadeaux somptueux, les menaces, les discours, les essais
de persuasion de femmes converties à l’islam, elle refusa. Elle
fut décapitée sur la place publique. Lorsque ses restes furent
transportés au nouveau cimetière, elle fut enterrée près de la
tombe de R. Eliahou Hassarfati. Quelques années plus tard, R. Avner
Israël (I) demanda à être enterré près d’elle. Son mausolée
domine le carré et est un lieu de pèlerinage célèbre jusqu’à
nos jours. [4,5,12].
VII)
Rabbi Avner-Israël (I) (1827-1884).
Petit-neveu de Rabbi Raphaël (I) et fils de Rabbi Vidal (IV)
(1797-1856), Av Beth-Din et célèbre pour ses décisions. Il fut
non seulement un Rabbin très réputé, un kabbaliste, mais aussi un
connaisseur des philosophies, un historien. Sa calligraphie est une
véritable œuvre d’art (voir ci-contre). Les savants musulmans
aimaient converser et étudier chez lui. Il possédait une bibliothèque
extrêmement riche, et recevait régulièrement des revues du monde
ashkénaze en hébreu et en yiddish [24]. En 1879, à la demande de
l’Alliance Israélite de Paris, et du Board of Deputies de
Londres, il écrivit « Yahass
Fas », sans doute le premier essai d’histoire d’un
juif du Maroc. Il y décrit la vie, la culture, la situation économique [9].
Il œuvra pour la création de l’école de l’Alliance de Fès,
qui fut inaugurée le 2 mars 1884. Il était connu pour sa
modestie, ne mangeait de la viande que le chabbat et invitait
constamment les pauvres à sa table. Charles de Foucauld lui-même
écrivit : « Même
aux yeux des musulmans, il était un des hommes les plus justes de
son temps. Juifs et arabes le consultaient en toute occasion et sur
toutes sortes de différends ». Après la mort de son père,
sa mère décida de « monter » à Jérusalem. Il eut
trois épouses. Sa fille Simha de son premier mariage, décida de se
rendre en Eretz Israël, et fut accompagnée pour le voyage par son
demi-frère Rabbi Vidal (V). Sa fille épousa à Jérusalem le Rav
Yaacov-Moshé Toledano, ministre des cultes en Israël et auteur de « Ner
Hamaarav » [16]. Rabbi Avner-Israël eut un seul fils,
Rabbi Vidal (V).

Signature
de Rabbi Avner-Israël Hassarfati (I)
VIII)
Rabbi Vidal (V) (1862-1921).
Il fut nommé Dayan en 1892 et Av Beth-Din en 1920 par les autorités
musulmanes et françaises. Il semble qu’il fut le premier à
porter le titre de « Grand Rabbin du Tribunal Rabbinique »,
terme importé du système en vigueur en France. Il avait de bonnes
relations avec le sultan et les autorités françaises. Il obtint le
statut de protégé français. Son rôle au moment et après le
« Tritl » (saccage du mellah de Fès en 1912) fut
important, aidé par l’Alliance Israélite Universelle [13,25]. Il
exigea l’enseignement de l’anglais dans l’école de
l’Alliance.
Les
anciens du mellah racontaient qu’avant le chabbat, il passait dans
les rues du mellah sur un cheval blanc pour souhaiter « Chabbat
Chalom » à la population. (Il n’a sans doute commencé
cette coutume qu’après la signature du Protectorat, car
auparavant, un juif n’avait point le droit de monter un cheval).
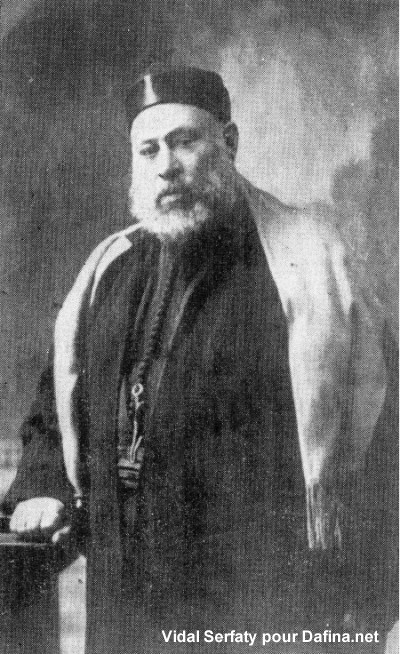
Le
Grand Rabbin Vidal Hassarfati (V)
(1862-1921)
Son
fils Rabbi
Avner-Israël (II) (1885-1933)
fut en 1909 secrétaire de la première association sioniste de Fès,
« Hibat Sion » (Les amants de Sion). Puis il fut
nommé rabbin de Safi et écrivit une préface au livre « Malkhei
Rabanan » [5]. Il a été le dernier rabbin de cette
lignée.
Dans
la seconde branche descendante de Rabbi Raphaël-Menahem, on connaît
Rabbi Raphaël (II) (1871-1956) qui fut rabbin de Mazagan et
d’Oujda et écrivit un livre de commentaires de la Torah.
Une
autre branche a vécu à Tétouan et descend de Rabbi Yaacov fils de
Itshak (II). L’un des descendants de cette branche, Rabbi Isaac
bar Vidal Haserfaty fut mohel
(circonciseur) dans cette ville de 1880 à 1940 [26].

La
bibliothèque de la famille était considérée comme la plus
importante des bibliothèques juives d’Afrique du nord, contenant
des milliers de manuscrits, des livres anciens rares, et même des
exemplaires uniques d’éditions disparues, des revues, des
journaux d’Europe, d’Eretz Israël. Mais elle fut négligée
durant de longues années, et lorsque Vidal (décédé en Israël en
1976), instituteur, fils d’Eliahou, qui s’occupa longtemps de la
comptabilité de la synagogue et Rahamim Serfaty, fils de Rabbi
Vidal (V) (et père de l’auteur du présent article) se rendirent
sur les lieux dans les années 1960, ce fut pour constater qu’une
partie avait été « empruntée » et qu’une autre
tombait en poussière, rongée par les vers. De ce qui restait, il y
eut un partage partiel entre les membres de la famille. Rahamim
apporta en Israël ce qu’il avait pu réunir et transmit à l’Université
Bar Ilan. Quelques éléments sont restés entre les mains de trois
descendants de la famille.
Anecdote :
Même dans les bonnes familles il peut y avoir une brebis galeuse.
On retrouve à Rome un certain Yossef Hassarfati, né à Fès, qui
se convertit au christianisme en 1552 et prit le nom d’Andrea
Filipo di Monti, appelé aussi « Joseph Moro ». Il
chercha à convertir ses ex-coreligionnaires. Une bulle du pape en
1584 contraignit les juifs, par groupes d’au moins 100 hommes
et 50 femmes, à écouter ses sermons. Il écrivit des livres
contre le judaïsme en hébreu en 1581, puis fut censeur
d’ouvrages hébraïques et causa de graves problèmes aux juifs.
Il mourut en 1597 [22].
Cet
article a paru dans"Etsi". Revue de Genealogie et
d'Histoire Sefarades. No 29. Juin 2005.
|
|

Ecriture
et signature de Rabbi Avner-Israël Hassarfati (I)
Bibliographie
[4].
Obadia, David : « Fas
veh’ah’ameah. Morocco ». [Fès et ses Sages]. Vol 1. Jérusalem,
1979. (en hébreu).
[5]. Ben Naïm, Yossef : « Malkhei
Rabanan » [Nos Rabbins les plus célèbres]. Jérusalem,
1931. (réédition : Ashdod, 1998). (en hébreu).
[6]. Hayoun, Maurice-Ruben : « Maïmonide
ou l’autre Moïse ». J.-C. Lattes, 1994.
[7]. Lettre en anglais adressée au Foreign Office le 10 avril
1873 par les consuls de France et de Grande-Bretagne. FO 99/154.
Recueil Pr E. Bashan, Université Bar Ilan.
[8]. Bouhsira, Abraham : « La
communauté juive de Fès ». Thèse de doctorat de
sociologie. Université de Strasbourg, 1997.
[9]. Hassarfati, Avner Israël : « Yahas
Ir Fas » (Propos sur la ville de Fès). Dans « Fas
veh’ah’ameah » [4].
[10]. Zafrani, Haïm : « Mille
ans de vie juive au Maroc ». Paris, Maisonneuve et Larose,
1983.
[11]. Laredo, Abraham I. : « Les
Taqqanot des juifs expulsés d’Espagne. Régime matrimonial et
successoral ». Traduit de l’espagnol par Elie Malka et
David Amsellem. Imprimerie Fontana, Casablanca, 1953, Casablanca,
1953.
[12]. Abensur, Philip : « Sol
Hachuel (1820-1834) : histoire et généalogie ». Etsi,
vol. 3, n°11, décembre 2000.
[13]. Serfaty, Vidal : « Le
"Tritl" (saccage) de Fès en 1912 ». Etsi,
vol. 8, n°28, mars 2004.
[14]. Chouraqui, André : « La
condition de l’Israélite marocain ». Paris, Presses du
livre français, 1950. Note : Le statut des dhimmis, institué
par le décret d’Omar au 8ème siècle, impose aux non-musulmans
des contraintes difficiles.
[15]. Ces précisions nous ont été transmises
par le Professeur Elisheva Albert (Université Bar Ilan), spécialiste
de l’histoire du judaïsme médiéval.
[16]. Toledano, Yaacov Moshé : « Ner
Hamaarav » (Lumière de l’Occident). Jérusalem, 1911.
(2ème édition : Jérusalem, 1973). (en hébreu).
[17]. Bashan, Eliezer : « Yaadouth
Marocco. Avarah ve tarboutah ». (Le judaïsme du Maroc.
Son passé et sa culture). Tel-Aviv, Hakibbutz Hameuchad, 2000. (en
hébreu).
[18]. Ben Tov, Haïm : « Rabbi
Vidal Hassarfati Hasheni » (le second). Périodique, vol.
3. Université Bar-Ilan, 1981 (en hébreu).
[19]. Ben Abbou, David : « Tsouf
Dvash » (Nectar du miel) de Rabbi Vidal Hassarfati. Préface.
Mossad Beith Yossef, Bné Brak, 1998 (en hébreu).
[20].
Ben Tov, Haïm : « Toledot
Itshak ». Préface. Jérusalem, 1995 (en hébreu).
(Traduction en français de la préface par Anne-Marie
Serfaty-Charon).
[21].
Amar, Moshé : « Divre
Shmuel » (Paroles de Shmuel) de Rabbi Shmuel Hassarfati.
Préface. Orot Yahadouth Hamagreb, Lod, 1997. (en hébreu).
(Traduction en français de la préface par Anne-Marie
Serfaty-Sharon).
[22].
Laredo, Abraham I. : « Les
noms des juifs du Maroc ». Madrid, Institut Arias Montano,
1978, pp. 523-527.
[23].
Hassarfati, Eliahou : « Kol
Eliahou » (La Voix de Eliahou) de Rabbi Eliahou Hassarfati.
Édition Ahavat Chalom, Jérusalem 1995. (en hébreu). (Préface
traduite en français par le Rav Avner Israël Chokron).
[24].
Documents personnels.
[25]. Alliance
Israélite Universelle. Paris, Archives Maroc, Liasse I B 5.81.
[26].
López Álvarez, Ana María : « La
comunidad judía de Tetuán 1881-1940, Onomástica y sociología en
el libro de registro de circuncisiones del Rabino Yishaq bar Vidal
Haserfaty ». Tolède, Museo Sefardí, 2003.

The
Hassarfati, Serfaty family
This
family name comes from the Hebrew word Tsarfat
(France). In some contracts between Jews and Christians, the name
has been translated as « Frances » or « Franco ».
It can be found throughout the Mediterranean Basin, as well as in
England and Holland.
The
Hassarfati genealogical tree goes back to 1450, and even according
to tradition, to Rabbenu-Tam, grandson of Rashi, although some 7
generations are missing.
Since
their arrival in Fez, the Hassarfatis have produced a long line of
rabbis, of which the most important are mentioned here.
Rabbi
Vidal Hassarfati the second (1545-1619 ?), called « El Señor »
or « Hakadmon ». Son of R. Itshak and grandson of
R. Vidal (I), he had a vast knowledge, quoting Roman, Arab and
Jewish philosophers. His most important book, « Tsuf Dvash »,
was published in Amsterdam in 1718. He was said to have made
miracles.
Rabbi
Itshak (II) (1611-1660), son of R. Vidal (II), was the naguid
(leader) of the community. The sultan tried in vain to corrupt him
and imprisoned him with his two eldest sons. He had a yeshiva and
was known for his commentaries.
Rabbi
Shmuel (1660-1713), grandson of R. Vidal (II), published
several books, including « Divre Shmuel » and was a
colleague of Yaavets (Rabbi Yaacov Aben-Sur). His nephew Shmuel, son
of Aaron, emigrated to Amsterdam and might have descendants there.
Rabbi
Eliahu (1715-1805), son of R. Yossef (I) and grandson of R. Itshak
(II). Called « Rabbenu », he is considered as one of the
most distinguished rabbis in the Jewish world. He studied with R. Yehuda
and R. Haïm Ben-Attar, R. Shmuel Elbaz and Yaavets. He
was part of the « Tribunal of the Five », together with
Yaavets and his son Raphael-Oved Aben-Tsur. Some of his works have
been recently published. His synagogogue was unfortunately recently
transformed in a billiard room. He had three sons, among which R. Israel-Yaacov
and R. Raphael-Menahem.
Rabbi
Raphael-Menahem (died in 1843). He had a Spanish Christian friend
who once betrayed him when he was in Spain, but he fortunately
escaped thanks to his friend’s mother.
Rabbi
Raphael (I), son of R. Israel-Yaacov. In 1834, he
unsuccessfully tried to save Solika Hachuel Hatsadeket, a young
Jewish girl of Tangier, falsely accused to have rejected Islam after
having embraced that religion. Rabbi Raphael succeeded in recovering
her body by throwing a large number of coins into the crowd. Some
years later, R. Avner Israel (I) was buried near her.
Rabbi
Avner-Israel (I) (1827-1884), great nephew of R. Raphael (I)
and son of R. Vidal (IV). A very distinguished rabbi, kabbalist
and historian, he was a wonderful calligrapher and had a richly
stocked library. In 1879, he wrote « Yahass Fas », the
first history of the Jews of Fez. He helped for the opening of the
Alliance Israelite Universelle school in Fez, inaugurated in 1884.
He had three wives. His first daughter, Simha, emigrated to Israel.
Her daughter married R. Yaacov-Moshe Toledano, Minister for
Religious Affairs in Israel, author of « Ner Hamaarav ».
Rabbi
Vidal (V) (1862-1921), son of R. Avner-Israel (I), was the
first Chief Rabbi of the Rabbinical Tribunal of Fez and had good
relationships with both the sultan and the French authorities. He
helped the community during and after the « Tritl » (sack
of the mellah of Fez in 1912).
Rabbi
Avner-Israel (II) (1885-1933), his son, was secretary of the first
Zionist society in Fez and was later appointed rabbi of Safi. He
wrote a preface to the book « Malkhei Rabanan » and was
the last rabbi of the family.
Other
branches of the Hassarfati family include Raphael (II) (1871-1956),
rabbi in Mazagan and Oujda and Isaac bar Vidal, mohel in Tetuan from
1880 to 1940.
The
family library was considered the most important Jewish library in
Northern Africa, and included thousands of manuscripts, rare books
and old newspapers from Europe and Israel. Unfortunately a large
part of it was stolen and another was destroyed by worms. The
remaining documents have been shared between members of the family
and Bar Ilan University.
|