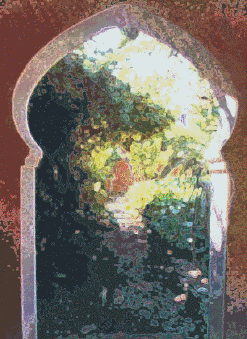|
LES FLEURS DE L'AUTOMNE
Envoyé par D.M. BENOLIEL
|
LES FLEURS DE L'AUTOMNE 14 février 2008, 10:33 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 3 |
Chers Amis,
Malgré mon âge (74), je reste tenté par l'aventure.
Je me suis donc lancé dans l'écriture d'un petit roman qui (après plusieurs autres demeurés dans mes tiroirs, a été édité chez Publibook au mois de Janvier.
Il s'appelle "Les Fleurs de l'Automne". Il est classé comme roman sentimental, ce qui est vrai, mais j'y ai inclus une petite réflexion personnelle sur l'âge, la solitude, l'amour et la mort.
J'ai voulu écrire quelque chose de plaisant, triste par moment, mais optimiste.
L'éditeur vient de me réserver deux séances de dédicace au Salon du Livre de Paris le 19 mars prochain à 13 H 30 et 16H.
C'est pour moi une vraie joie que je souhaite partager.
Si d'aventure certains d'entre vous a projeté de se rendre au Salon, je serais heureux de faire leur connaissance et de leur serrer la main.
J'ajoute à ce message la présentation faite par l'éditeur, et le premier chapitre.
Très amicalement à tous,
D.M. BENOLIEL
Malgré mon âge (74), je reste tenté par l'aventure.
Je me suis donc lancé dans l'écriture d'un petit roman qui (après plusieurs autres demeurés dans mes tiroirs, a été édité chez Publibook au mois de Janvier.
Il s'appelle "Les Fleurs de l'Automne". Il est classé comme roman sentimental, ce qui est vrai, mais j'y ai inclus une petite réflexion personnelle sur l'âge, la solitude, l'amour et la mort.
J'ai voulu écrire quelque chose de plaisant, triste par moment, mais optimiste.
L'éditeur vient de me réserver deux séances de dédicace au Salon du Livre de Paris le 19 mars prochain à 13 H 30 et 16H.
C'est pour moi une vraie joie que je souhaite partager.
Si d'aventure certains d'entre vous a projeté de se rendre au Salon, je serais heureux de faire leur connaissance et de leur serrer la main.
J'ajoute à ce message la présentation faite par l'éditeur, et le premier chapitre.
Très amicalement à tous,
D.M. BENOLIEL
|
Re: LES FLEURS DE L'AUTOMNE 18 février 2008, 23:58 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 3 |
Chers Amis,
J'avais annoncé avec mon message antérieur la présentation du roman faite par l'éditeur et le premier chapitre,mais je n'avais pas compris que l'on ne pouvait annexer un fichier word.
Grace à Jero, je viens de comprendre, et je joins les éléments annoncés ci-dessous.
Donc rendez-vous au Salon du Livre le 19 mars à 13 heures 30.
David Max Benoliel
PRESENTATION PAR L'EDITEUR
David Max Benoliel, né en 1934 au Maroc d’une double ascendance, juifs de Gibraltar par son père, catholiques espagnols par sa mère, a été victime de l’application des lois raciales en 1941 et rescapé du séisme d’Agadir en 1960.
Avocat au Maroc, puis en France, à Aix en Provence, il a été admis à l’honorariat en 2001. Il exprime son amour de la vie en racontant des histoires. Celle-ci est la première confiée au public.
Quinqua dandy et quelque peu échaudé par l’amour, Samuel, brillant architecte, cultive soigneusement sa solitude et sa liberté. Son existence connaît pourtant un bouleversement inattendu lorsqu’il rencontre Rachel Lucca, informaticienne deux fois plus jeune que lui. Immédiatement, cet homme à l’esprit corrosif et raffiné s’éprend d’elle, devient son ami et confident, et assiste au naufrage de sa relation amoureuse avec un homme marié.
Peu à peu séduite par le caractère atypique et l’insolence de
Samuel, Rachel succombe à son tour et entame une relation qu’elle veut profonde et sincère avec lui. Jusqu’à ce qu’elle l’abandonne brusquement pour retomber dans les bras de celui qui, quelques mois plus tôt, se jouait de ses sentiments…
Conte tendre et optimiste, Les Fleurs de l’automne donne la parole à un homme mûr qui s’épanouit, à l’âge où d’autres s’enlisent dans une existence morne et sans surprises, au contact d’une jeune femme fragile et qui attend tout de l’amour. Mais le bonheur est fragile et fugace, constamment remis en question par les aléas des sentiments et les tragédies que peut nous réserver la vie.
De rencontres en ruptures, de retrouvailles en drames, David Max
Benoliel, qui signe ici son premier roman, met ainsi en scène un chassé-croisé amoureux aux accents aussi bien badins que bouleversants.
CHAPITRE PREMIER
Seul à la barre - Coup de Foudre – Le verbe tomber – Bilan d’un demi siècle – Sagesse des Femmes – Chassés-croisés – Tant il est vrai que le droit mène à tout – Passage de la Faucheuse – Das Kapital – La banque –
Ensemble mais séparément – Au musée – La main chaude – La main froide – La Faucheuse repasse –Dum vivimus – Au bord de la Mer – La Belle Brigande
Au moment où je laissais sur ma gauche l’île de Ré, je modifiais ma direction vers le sud, et je resserrais les voiles pour tenir compte du changement de cap par rapport au vent. Je le fis sans quitter la barre, merveille des commandes électriques qui permettent à un plaisancier médiocre de naviguer en solitaire sans problème particulier.
C’était bien normal : les commodités de l’existence matérielle auxquelles nous a habitué le confort, font que, malgré les recommandations de l’Eternel, l’homme (et la femme, bien sûr) choisit souvent de vivre seul, s’en remettant à des esclaves électriques pour les tâches matérielles, à des récepteurs musicaux et visuels pour le distraire, à des ordinateurs pour surveiller le tout et à des amours passagères (parfois mercenaires) pour combler sa solitude. Alors, pourquoi pas sur un voilier de plaisance.
Le soleil de septembre s’apprêtait à prendre son bain quotidien rouge et or. C’est à ce moment que je me dis qu’il m’avait fallu attendre l’âge de cinquante ans (enfin presque, quarante huit) pour tomber amoureux.
Cette expression de « tomber amoureux », m’a toujours interloqué. Dans l’ensemble, tomber, normalement utilisé comme verbe intransitif, a une connotation désagréable, voire tragique : on tombe de haut, on tombe évanoui, voire en pâmoison, on tombe malade. On tombe mort, et même raide mort, comme passant directement de l’état de vie à celui de rigor mortis. Raide est d’ailleurs fort expressif, car dans l’argot de nos amis américains, stiff, raide, signifie cadavre. Il est aussi possible de tomber au champ d’honneur, ce qui est plus valorisant, mais n’améliore pas le résultat.
Tomber, il faut bien le dire, sonne comme tombe. Celle-ci, vient du grec tumbos, à travers le latin tumba, mots qui ont la même signification. Tomber, par contre, vient du francique tumon, dont le sens premier était « gambader ». Belle leçon de morale : nous avons beau gambader et nous agiter en tous sens, nous finirons dans une humble fosse. Tout comme ce pauvre comédien dont parlait Shakespeare dans Macbeth, qui s’égosille et s’agite à son heure, et que l’on n’entend jamais plus.
Donc, tomber, paraît assimiler l’éveil brusque de sentiments amoureux à quelque catastrophe. Il est vrai que c’est souvent exact. Cependant, pour moi, dans l’instant, j’étais très satisfait de ma situation.
Qu’avais-je fait durant ma vie ? J’avais grandi dans une famille aimable, mais plutôt indifférente. J’avais étudié et pratiqué l’architecture. J’avais lu et voyagé.
Sous l’angle affectif, je m’étais épris d’une jeune consoeur. Je dis consoeur, alors que l’usage du français classique exigerait que je dise confrère. Consoeur ne se dit qu’entre femmes. Je n’aurais pas voulu, en disant que je m’étais épris d’un jeune confrère, que l’on pense de moi que ma prédilection allait vers les éphèbes. Phobie, peut être. Mais si l’on peut être en échappant aux foudres de la loi, américanophobe, anglophobe, capitalophobe ou libéralophobe, pourquoi pas cette phobie là. J’avoue tout : pour moi, il n’y a rien de plus triste qu’être homosexuel, sinon d’être végétarien.
Donc cette jeune consoeur était grande, belle, solide, intelligente, spirituelle. Nous partageâmes les jeux du cœur et les joutes du corps. Nous devions même nous marier. Deux mois avant la date, elle m’annonça, sans trop de précautions oratoires qu’elle ne m’épouserait pas et qu’elle allait faire sa vie avec notre ami commun Fred. La douche.
Naïvement, je m’exclamai : « Ce n’est pas possible ! Je t’aime ! » Elle posa sur moi un regard bleu apitoyé : « Mon pauvre Samuel. Bien sûr que tu m’aimes. Moi aussi, je t’aime. Le malheur, c’est que nous ne sommes pas amoureux.
- Et Fred ?
- Lui, il est amoureux.
- Et moi ?
- Toi ? Tu vas souffrir un peu, et, bien vite, tu te rendras compte que je ne te manque pas. »
Elle avait raison. Après une assez courte période d’amertume, je me réveillai un matin ne ressentant aucun regret, et même vaguement soulagé. O sagesse féminine. Merveilleuse intuition qui fait que nos compagnes savent de la vie plus qu’elles ne peuvent en avoir appris.
Après cet épisode, un certain nombre d’aimables personnes croisèrent ma route. Parfois pour faire un petit bout de chemin ensemble, parfois très fugacement. Il m’était venu un jour, pour pimenter une vie sexuelle un peu monotone, de m’adresser à une call-girl. Je n’eus pas plus tôt poussé sa porte qu’elle poussa un cri en me voyant. Après quelques secondes, je reconnus dans la jeune personne en déshabillé affriolant, la fille d’un de mes amis, président du Lions Club. Nous nous tirâmes de cette situation embarrassante en éclatant de rire, et je l’emmenais dîner, sans donner aucune suite au but de ma visite.
Rhabillée, Sylvie était redevenue la jeune femme en tailleur distingué rencontrée chez ses parents. Elle m’expliqua entre la sole et la pintade, qu’après de bonnes études de droit, elle s’était vite rendu compte de ce que les hommes, voire les femmes, chez lesquels elle recherchait une situation, s’intéressaient plus à son charme physique qu’à ses capacités intellectuelles.
Quant le bâtonnier C… lui fit des avances dépourvues d’ambiguïté, elle lança un prix. Le lendemain matin, après une nuit plutôt ennuyeuse mais peu fatigante, elle mettait dans son sac quelques vignettes en couleur de la Banque de France représentant sensiblement un mois de rémunération de stagiaire.
Elle décida que cette activité en valait bien une autre. Comme elle avait un petit talent de sculptrice, elle fit admettre à sa famille qu’elle vivait de son ciseau. Ses parents atterrés au début par le choix d’une carrière artistique, rendirent rapidement les armes devant les résultats évidents de la réussite financière.
« Vous voyez, me dit-elle, comme le dit si bien la sagesse populaire : le droit mène à tout, à condition d’en sortir. Si l’on sait employer ses talents et investir judicieusement, naturellement». Elle faisait manifestement fort bien l’un et l’autre, et me donna même les références de son conseiller en placements.
A quelque temps de là, un frère de ma mère mourut. Il n’avait jamais fait grand-chose, sinon savourer les grands crus. Il succomba à une cirrhose, tant il est vrai que l’on meurt toujours d’avoir vécu. Nous n’avions jamais eu de rapports personnels. Convoqué chez son notaire, je découvris avec une double surprise que mon oncle était riche et qu’il m’avait institué son légataire universel. Il ne pouvait y avoir d’explication à cette bienveillance que le fait de l’avoir ignoré : j’étais vraisemblablement le seul membre de la famille à l’avoir laissé tranquille.
J’entrais sans remord en possession de ce qui me revenait, déduction fait de la lourde livre de chair coupée au passage par l’état. Sans remords : le capitalisme est justifié par l’existence du capital. N’en déplaise à l’oncle Karl.
Que faire de cet héritage ? Je décidais de le confier au conseiller en placement suggéré par Sylvie et pris rendez-vous à la banque où elle officiant. Ce conseiller, j’ai omis de le dire était une dame. Brune, les cheveux courts, à la beauté un peu pâle qui accompagne souvent le chagrin digne. Elle se montra d’une remarquable efficacité, et, des années plus tard, je tire toujours bénéfice de ses conseils. Comme nous fûmes amenés à nous revoir, nous fîmes plus ample connaissance et nous découvrîmes des amis et des goûts communs.
Dîners, concerts, plein air. Un jour, je pris sa main et effleurai ses lèvres. Notre liaison, fut la vie commune la plus longue que j’avais connu avec aucune femme. Commune était beaucoup dire. Il y avait un enfant, un petit garçon de sept ou huit ans, pâle comme sa mère, qui se remettait difficilement de la mort de son père, et qui avait une petite malformation cardiaque. Mon intrusion dans son quotidien aurait pu poser problème. Il accepta sans peine ma présence fréquente, mais je compris vite que c’était à condition que je n’occupe pas le terrain.
Un jour de vacances où Claude, sa mère, mon amie, devait être retenue au chevet d’une parente malade, elle me confia le petit Alain. Je ne savais que faire, ni qu’en faire. Déambulant dans la rue, je lui en posais la question. Il fixa dans le mien son regard clair, un peu globuleux et me dit : « Je veux voir des gens !
- Des gens comment ?
- Comme ça ! »
Nous étions devant la vitrine d’un antiquaire. Son petit doigt me montrait le portrait d’un homme rubicond, peut-être aviné, en tenue de cuirassier.
Après tout, pourquoi pas ? J’emmenais l’enfant au musée. Comme dans bien des musées de province, les œuvres exposées étaient loin de présenter le même intérêt artistique et même humain. Alain gardait le silence en déambulant, ses petites mains blanches fourrées sous son manteau. Nous passâmes devant plusieurs grands portraits qui n’attirèrent pas son attention. Une salle était consacrée à la mer, à la marine et aux bateaux. Une assez jolie toile du XIXème représentait un beau jeune homme portant un habit bleu et une cravate de foulard, la mâchoire crispée et le regard vers l’horizon, appuyé au bastingage d’un navire : La Fayette sur le pont de l’Hermione, partant pour les Amériques. « C’est un pirate ? » me demanda Alain.
A ma connaissance, personne avant cet enfant n’avait qualifié ce sympathique personnage de pirate. Il est vrai dans un sens que le Marquis avait aidé ceux qui seraient les Américains à pirater leur indépendance, tant il est vrai que la liberté s’acquiert toujours un peu par la force, ne serait-ce qu’entre enfant et parents.
Je n’avais aucune expérience des enfants. Le seul que j’avais fréquenté intimement était moi-même, et je l’avais oublié. Les enfants de ma sœur ne me détestaient pas, mais ne me considéraient pas vraiment comme partie de la famille. Cette manifestation d’intérêt d’Alain m’encouragea. « Tu veux que je te raconte son histoire ? » Un hochement de tête aussi vif qu’éloquent m’y invita.
Une sorte de banc capitonné se trouvait plus ou moins en face du tableau. Je m’y installai, l’enfant près de moi. A proprement parler je ne savais guère de La Fayette que ce que j’en avais appris dans le livre de Debû-Bridel, avec quelques éclairages latéraux glanés dans Fenimore Cooper. Je racontais cela comme cela me revenait. Lorsque je racontai l’admission du jeune marquis de quatorze ans dans les mousquetaires noirs, je sentis une petite main chaude se glisser dans la mienne et la serrer. Je la tins longtemps avec une sorte d’émotion contenue que je ne connaissais pas.
L’après midi se passa agréablement. L’histoire lancée, le musée n’était plus nécessaire. Les guerres de l’indépendance américaine se déroulèrent pendant nous longions le parc. Ce fut dans une pâtisserie salon de thé, devant des mille feuilles que je racontais l’évasion d’Allemagne avec l’aide de Frères anglais.
Alain n’oubliait rien. Au moment où nous arrivions chez sa mère, il me tira par le bras : « Quand est-ce qu’on ira la voir ? » Quelle « la » ? L’Hermione, sur laquelle La Fayette avait traversé l’océan. Je promis : nous irions voir l’Hermione sur le chantier de Rochefort où on la reconstruisait à l’identique.
Le soir au dîner, Claude, avec, aux joues, un rose que je ne lui connaissais que trop rarement, écoutait le récit animé de l’enfant, en me lançant de temps en temps un regard furtif mêlé de surprise et de reconnaissance. Je passais la soirée avec elle, après qu’Alain se soit endormi. Cette nuit là nos corps se parlèrent avec moins de fougue et plus de tendresse.
Mes escapades avec Alain devinrent une sorte d’habitude. Plus ou moins fréquemment, Claude poussait Alain vers moi, et nous deux vers la porte : « Ouste ! Dehors les hommes ! J’ai des choses à faire : allez vous promener. Ce fut l’Hermione, bien sûr, mais de nouveau le musée, le zoo, l’aquarium, le mini-golf, l’aérodrome, la forêt … Et toujours cette petite main chaude dans la mienne.
Ce petit garçon qui par rapport aux liens du sang ne m’était rien, me révéla que je détestais les enfants beaucoup moins que je le croyais. Sans que j’aie pu le prévoir, j’éprouvai pour lui une affection grandissante. Il m’aurait peut-être même totalement réconcilié avec l’enfance si …
S’il n’avait pas fallu un soir le conduire d’extrême urgence à l’hôpital. Sa petite anomalie cardiaque s’aggravait. Le surlendemain, il était mort.
Je ramenais du cimetière une Claude murée dans le silence, indifférente à tout, qui n’avait même pas adressé la parole à sa famille. Peu après, rapidement, sa santé se mit à décliner. Son médecin habituel n’y comprenait rien. Elle accepta de voir le mien, Francis Brandt, qui était de mes amis. Il lui concocta un régime vitaminé, re-minéralisant accompagné d’antidépresseurs. En privé, il me confia : « Elle n’a plus envie de vivre. Si cette envie ne la reprend pas, personne ne pourra rien pour elle ».
Et personne ne put rien pour elle. Ni Francis, ni le psychothérapeute, ni le psychiatre, ni le prêtre, ni ses amis, ni sa famille, ni moi. Au bout de peu de mois, elle se coucha un soir pour ne plus se réveiller. Je suivis accablé le cortège qui la menait vers le carré de verdure où l’attendaient son mari et son fils.
Cette très triste histoire eut pour moi des suites bénéfiques. La supériorité des juifs sur d’autres peuples vient de leur capacité à tirer des enseignements de leurs malheurs. La formule française « La vie continue » s’énonce comme un constat somme toute accablant. Un peu comme si la prohibition chrétienne du suicide nous condamnait à devoir vivre dans la souffrance.
Mes amis anglais, eux, disent : « Life must go on ! ». La vie doit continuer. Pas de résignation : un positivisme volontariste. Je décidais donc alors de faire mienne la devise latine « Dum vivimus, vivamus ! » Tant que nous sommes vivants, vivons.
Certes, je versais sur Alain et sur Claude les larmes brûlantes de l’homme mûr, mais puisque Atropos avait séparé nos routes, je devais continuer mon chemin.
Dans les biens que m’avait légués mon oncle se trouvait une petite maison au bord de l’Atlantique, avec un petit bout de jardin, non loin d’un petit port de pêche. Entre elle et moi, ce fut l’entente totale et elle devint ma résidence préférée.
En allant me promener vers le port je passais à proximité d’un petit chantier naval, qui maintenait en ordre de service les bateaux de pêche et quelques petites unités de plaisance. J’aime l’odeur du bois qu’on travaille, du goudron qui sèche, des voiles qui ont trop reçu d’eau de mer et des filets qui y ont mariné. J’entrai un jour sans intention particulière. Dans le fond se trouvait une coque, pas entretenue mais en bon état, qui portait un reste de peinture noire. Une carène curieuse, une sorte de pinasse trop large ou de bateau de pêche trop étroit ou trop long. Il restait la base de deux mâts. Cela aurait pu être ceux d’une petite goélette ou d’un brigantin, mais effilé comme un cotre, avec un poste de barre avancé derrière la misaine et un emplacement de moteur très important.
J’en parlais à Julien, le patron du chantier que j’avais côtoyé au bistrot local.
-Ah, me dit-il, la noire ?
- C’est son nom ?
- Elle n’a pas de nom, mais on l’appelle comme ça.
- C’était un bateau de pêche ?
- Si on veut …
- Avec une coque aussi élancée ?
- Vous vous y connaissez ?
- Pas vraiment, mais j’ai un peu barré en amateur. J’aime le bord de mer et les histoires de pirates »
Julien éclata de rire : « Vous tombez à pic. Je n’ai pas connu son propriétaire, mais mon père oui. C’était un drôle de bonhomme, moitié corse et moitié anglais qui s’appelait Johnny Argento.
- Que faisait-il ?
- On n’a jamais su. Contrebande, voire même un peu de piraterie
- A notre époque, ici ?
- Pourquoi non ?
- Personne ne l’a embêté ?
- Pendant la guerre, il a rendu des services en allant chercher en haute mer des gens qu’amenaient les sous-marins anglais, commandos, agents …., alors tout le monde a regardé à côté. Johnny est mort en ne laissant rien que son bateau en mauvais état et des dettes. Mon père l’a racheté pour presque rien.
- Est-ce que vous me le vendriez ? »
C’est ainsi que j’ai acheté la noire. Je l’ai fait remettre en état. J’ai tenu à ce qu’elle reste de cette couleur, mais j’ai fait peindre le plat bord et la flottaison d’une bande blanche. Elle est équipée à présent d’un diesel marin suédois. J’ai fait remonter les mats et j’ai choisi pour la gréer des voiles rouges : un foc génois et une brigantine, une trinquette et une grand voile à corne.
C’est un joli spectacle lorsqu’elle file à pleine toile. C’est donc, vous l’avez compris d’un bateau que je suis tombé amoureux vers la cinquantaine. Compte tenu de son passé, et puisqu’elle n’avait pas de nom, je l’ai appelé La Belle Brigande.
J'avais annoncé avec mon message antérieur la présentation du roman faite par l'éditeur et le premier chapitre,mais je n'avais pas compris que l'on ne pouvait annexer un fichier word.
Grace à Jero, je viens de comprendre, et je joins les éléments annoncés ci-dessous.
Donc rendez-vous au Salon du Livre le 19 mars à 13 heures 30.
David Max Benoliel
PRESENTATION PAR L'EDITEUR
David Max Benoliel, né en 1934 au Maroc d’une double ascendance, juifs de Gibraltar par son père, catholiques espagnols par sa mère, a été victime de l’application des lois raciales en 1941 et rescapé du séisme d’Agadir en 1960.
Avocat au Maroc, puis en France, à Aix en Provence, il a été admis à l’honorariat en 2001. Il exprime son amour de la vie en racontant des histoires. Celle-ci est la première confiée au public.
Quinqua dandy et quelque peu échaudé par l’amour, Samuel, brillant architecte, cultive soigneusement sa solitude et sa liberté. Son existence connaît pourtant un bouleversement inattendu lorsqu’il rencontre Rachel Lucca, informaticienne deux fois plus jeune que lui. Immédiatement, cet homme à l’esprit corrosif et raffiné s’éprend d’elle, devient son ami et confident, et assiste au naufrage de sa relation amoureuse avec un homme marié.
Peu à peu séduite par le caractère atypique et l’insolence de
Samuel, Rachel succombe à son tour et entame une relation qu’elle veut profonde et sincère avec lui. Jusqu’à ce qu’elle l’abandonne brusquement pour retomber dans les bras de celui qui, quelques mois plus tôt, se jouait de ses sentiments…
Conte tendre et optimiste, Les Fleurs de l’automne donne la parole à un homme mûr qui s’épanouit, à l’âge où d’autres s’enlisent dans une existence morne et sans surprises, au contact d’une jeune femme fragile et qui attend tout de l’amour. Mais le bonheur est fragile et fugace, constamment remis en question par les aléas des sentiments et les tragédies que peut nous réserver la vie.
De rencontres en ruptures, de retrouvailles en drames, David Max
Benoliel, qui signe ici son premier roman, met ainsi en scène un chassé-croisé amoureux aux accents aussi bien badins que bouleversants.
CHAPITRE PREMIER
Seul à la barre - Coup de Foudre – Le verbe tomber – Bilan d’un demi siècle – Sagesse des Femmes – Chassés-croisés – Tant il est vrai que le droit mène à tout – Passage de la Faucheuse – Das Kapital – La banque –
Ensemble mais séparément – Au musée – La main chaude – La main froide – La Faucheuse repasse –Dum vivimus – Au bord de la Mer – La Belle Brigande
Au moment où je laissais sur ma gauche l’île de Ré, je modifiais ma direction vers le sud, et je resserrais les voiles pour tenir compte du changement de cap par rapport au vent. Je le fis sans quitter la barre, merveille des commandes électriques qui permettent à un plaisancier médiocre de naviguer en solitaire sans problème particulier.
C’était bien normal : les commodités de l’existence matérielle auxquelles nous a habitué le confort, font que, malgré les recommandations de l’Eternel, l’homme (et la femme, bien sûr) choisit souvent de vivre seul, s’en remettant à des esclaves électriques pour les tâches matérielles, à des récepteurs musicaux et visuels pour le distraire, à des ordinateurs pour surveiller le tout et à des amours passagères (parfois mercenaires) pour combler sa solitude. Alors, pourquoi pas sur un voilier de plaisance.
Le soleil de septembre s’apprêtait à prendre son bain quotidien rouge et or. C’est à ce moment que je me dis qu’il m’avait fallu attendre l’âge de cinquante ans (enfin presque, quarante huit) pour tomber amoureux.
Cette expression de « tomber amoureux », m’a toujours interloqué. Dans l’ensemble, tomber, normalement utilisé comme verbe intransitif, a une connotation désagréable, voire tragique : on tombe de haut, on tombe évanoui, voire en pâmoison, on tombe malade. On tombe mort, et même raide mort, comme passant directement de l’état de vie à celui de rigor mortis. Raide est d’ailleurs fort expressif, car dans l’argot de nos amis américains, stiff, raide, signifie cadavre. Il est aussi possible de tomber au champ d’honneur, ce qui est plus valorisant, mais n’améliore pas le résultat.
Tomber, il faut bien le dire, sonne comme tombe. Celle-ci, vient du grec tumbos, à travers le latin tumba, mots qui ont la même signification. Tomber, par contre, vient du francique tumon, dont le sens premier était « gambader ». Belle leçon de morale : nous avons beau gambader et nous agiter en tous sens, nous finirons dans une humble fosse. Tout comme ce pauvre comédien dont parlait Shakespeare dans Macbeth, qui s’égosille et s’agite à son heure, et que l’on n’entend jamais plus.
Donc, tomber, paraît assimiler l’éveil brusque de sentiments amoureux à quelque catastrophe. Il est vrai que c’est souvent exact. Cependant, pour moi, dans l’instant, j’étais très satisfait de ma situation.
Qu’avais-je fait durant ma vie ? J’avais grandi dans une famille aimable, mais plutôt indifférente. J’avais étudié et pratiqué l’architecture. J’avais lu et voyagé.
Sous l’angle affectif, je m’étais épris d’une jeune consoeur. Je dis consoeur, alors que l’usage du français classique exigerait que je dise confrère. Consoeur ne se dit qu’entre femmes. Je n’aurais pas voulu, en disant que je m’étais épris d’un jeune confrère, que l’on pense de moi que ma prédilection allait vers les éphèbes. Phobie, peut être. Mais si l’on peut être en échappant aux foudres de la loi, américanophobe, anglophobe, capitalophobe ou libéralophobe, pourquoi pas cette phobie là. J’avoue tout : pour moi, il n’y a rien de plus triste qu’être homosexuel, sinon d’être végétarien.
Donc cette jeune consoeur était grande, belle, solide, intelligente, spirituelle. Nous partageâmes les jeux du cœur et les joutes du corps. Nous devions même nous marier. Deux mois avant la date, elle m’annonça, sans trop de précautions oratoires qu’elle ne m’épouserait pas et qu’elle allait faire sa vie avec notre ami commun Fred. La douche.
Naïvement, je m’exclamai : « Ce n’est pas possible ! Je t’aime ! » Elle posa sur moi un regard bleu apitoyé : « Mon pauvre Samuel. Bien sûr que tu m’aimes. Moi aussi, je t’aime. Le malheur, c’est que nous ne sommes pas amoureux.
- Et Fred ?
- Lui, il est amoureux.
- Et moi ?
- Toi ? Tu vas souffrir un peu, et, bien vite, tu te rendras compte que je ne te manque pas. »
Elle avait raison. Après une assez courte période d’amertume, je me réveillai un matin ne ressentant aucun regret, et même vaguement soulagé. O sagesse féminine. Merveilleuse intuition qui fait que nos compagnes savent de la vie plus qu’elles ne peuvent en avoir appris.
Après cet épisode, un certain nombre d’aimables personnes croisèrent ma route. Parfois pour faire un petit bout de chemin ensemble, parfois très fugacement. Il m’était venu un jour, pour pimenter une vie sexuelle un peu monotone, de m’adresser à une call-girl. Je n’eus pas plus tôt poussé sa porte qu’elle poussa un cri en me voyant. Après quelques secondes, je reconnus dans la jeune personne en déshabillé affriolant, la fille d’un de mes amis, président du Lions Club. Nous nous tirâmes de cette situation embarrassante en éclatant de rire, et je l’emmenais dîner, sans donner aucune suite au but de ma visite.
Rhabillée, Sylvie était redevenue la jeune femme en tailleur distingué rencontrée chez ses parents. Elle m’expliqua entre la sole et la pintade, qu’après de bonnes études de droit, elle s’était vite rendu compte de ce que les hommes, voire les femmes, chez lesquels elle recherchait une situation, s’intéressaient plus à son charme physique qu’à ses capacités intellectuelles.
Quant le bâtonnier C… lui fit des avances dépourvues d’ambiguïté, elle lança un prix. Le lendemain matin, après une nuit plutôt ennuyeuse mais peu fatigante, elle mettait dans son sac quelques vignettes en couleur de la Banque de France représentant sensiblement un mois de rémunération de stagiaire.
Elle décida que cette activité en valait bien une autre. Comme elle avait un petit talent de sculptrice, elle fit admettre à sa famille qu’elle vivait de son ciseau. Ses parents atterrés au début par le choix d’une carrière artistique, rendirent rapidement les armes devant les résultats évidents de la réussite financière.
« Vous voyez, me dit-elle, comme le dit si bien la sagesse populaire : le droit mène à tout, à condition d’en sortir. Si l’on sait employer ses talents et investir judicieusement, naturellement». Elle faisait manifestement fort bien l’un et l’autre, et me donna même les références de son conseiller en placements.
A quelque temps de là, un frère de ma mère mourut. Il n’avait jamais fait grand-chose, sinon savourer les grands crus. Il succomba à une cirrhose, tant il est vrai que l’on meurt toujours d’avoir vécu. Nous n’avions jamais eu de rapports personnels. Convoqué chez son notaire, je découvris avec une double surprise que mon oncle était riche et qu’il m’avait institué son légataire universel. Il ne pouvait y avoir d’explication à cette bienveillance que le fait de l’avoir ignoré : j’étais vraisemblablement le seul membre de la famille à l’avoir laissé tranquille.
J’entrais sans remord en possession de ce qui me revenait, déduction fait de la lourde livre de chair coupée au passage par l’état. Sans remords : le capitalisme est justifié par l’existence du capital. N’en déplaise à l’oncle Karl.
Que faire de cet héritage ? Je décidais de le confier au conseiller en placement suggéré par Sylvie et pris rendez-vous à la banque où elle officiant. Ce conseiller, j’ai omis de le dire était une dame. Brune, les cheveux courts, à la beauté un peu pâle qui accompagne souvent le chagrin digne. Elle se montra d’une remarquable efficacité, et, des années plus tard, je tire toujours bénéfice de ses conseils. Comme nous fûmes amenés à nous revoir, nous fîmes plus ample connaissance et nous découvrîmes des amis et des goûts communs.
Dîners, concerts, plein air. Un jour, je pris sa main et effleurai ses lèvres. Notre liaison, fut la vie commune la plus longue que j’avais connu avec aucune femme. Commune était beaucoup dire. Il y avait un enfant, un petit garçon de sept ou huit ans, pâle comme sa mère, qui se remettait difficilement de la mort de son père, et qui avait une petite malformation cardiaque. Mon intrusion dans son quotidien aurait pu poser problème. Il accepta sans peine ma présence fréquente, mais je compris vite que c’était à condition que je n’occupe pas le terrain.
Un jour de vacances où Claude, sa mère, mon amie, devait être retenue au chevet d’une parente malade, elle me confia le petit Alain. Je ne savais que faire, ni qu’en faire. Déambulant dans la rue, je lui en posais la question. Il fixa dans le mien son regard clair, un peu globuleux et me dit : « Je veux voir des gens !
- Des gens comment ?
- Comme ça ! »
Nous étions devant la vitrine d’un antiquaire. Son petit doigt me montrait le portrait d’un homme rubicond, peut-être aviné, en tenue de cuirassier.
Après tout, pourquoi pas ? J’emmenais l’enfant au musée. Comme dans bien des musées de province, les œuvres exposées étaient loin de présenter le même intérêt artistique et même humain. Alain gardait le silence en déambulant, ses petites mains blanches fourrées sous son manteau. Nous passâmes devant plusieurs grands portraits qui n’attirèrent pas son attention. Une salle était consacrée à la mer, à la marine et aux bateaux. Une assez jolie toile du XIXème représentait un beau jeune homme portant un habit bleu et une cravate de foulard, la mâchoire crispée et le regard vers l’horizon, appuyé au bastingage d’un navire : La Fayette sur le pont de l’Hermione, partant pour les Amériques. « C’est un pirate ? » me demanda Alain.
A ma connaissance, personne avant cet enfant n’avait qualifié ce sympathique personnage de pirate. Il est vrai dans un sens que le Marquis avait aidé ceux qui seraient les Américains à pirater leur indépendance, tant il est vrai que la liberté s’acquiert toujours un peu par la force, ne serait-ce qu’entre enfant et parents.
Je n’avais aucune expérience des enfants. Le seul que j’avais fréquenté intimement était moi-même, et je l’avais oublié. Les enfants de ma sœur ne me détestaient pas, mais ne me considéraient pas vraiment comme partie de la famille. Cette manifestation d’intérêt d’Alain m’encouragea. « Tu veux que je te raconte son histoire ? » Un hochement de tête aussi vif qu’éloquent m’y invita.
Une sorte de banc capitonné se trouvait plus ou moins en face du tableau. Je m’y installai, l’enfant près de moi. A proprement parler je ne savais guère de La Fayette que ce que j’en avais appris dans le livre de Debû-Bridel, avec quelques éclairages latéraux glanés dans Fenimore Cooper. Je racontais cela comme cela me revenait. Lorsque je racontai l’admission du jeune marquis de quatorze ans dans les mousquetaires noirs, je sentis une petite main chaude se glisser dans la mienne et la serrer. Je la tins longtemps avec une sorte d’émotion contenue que je ne connaissais pas.
L’après midi se passa agréablement. L’histoire lancée, le musée n’était plus nécessaire. Les guerres de l’indépendance américaine se déroulèrent pendant nous longions le parc. Ce fut dans une pâtisserie salon de thé, devant des mille feuilles que je racontais l’évasion d’Allemagne avec l’aide de Frères anglais.
Alain n’oubliait rien. Au moment où nous arrivions chez sa mère, il me tira par le bras : « Quand est-ce qu’on ira la voir ? » Quelle « la » ? L’Hermione, sur laquelle La Fayette avait traversé l’océan. Je promis : nous irions voir l’Hermione sur le chantier de Rochefort où on la reconstruisait à l’identique.
Le soir au dîner, Claude, avec, aux joues, un rose que je ne lui connaissais que trop rarement, écoutait le récit animé de l’enfant, en me lançant de temps en temps un regard furtif mêlé de surprise et de reconnaissance. Je passais la soirée avec elle, après qu’Alain se soit endormi. Cette nuit là nos corps se parlèrent avec moins de fougue et plus de tendresse.
Mes escapades avec Alain devinrent une sorte d’habitude. Plus ou moins fréquemment, Claude poussait Alain vers moi, et nous deux vers la porte : « Ouste ! Dehors les hommes ! J’ai des choses à faire : allez vous promener. Ce fut l’Hermione, bien sûr, mais de nouveau le musée, le zoo, l’aquarium, le mini-golf, l’aérodrome, la forêt … Et toujours cette petite main chaude dans la mienne.
Ce petit garçon qui par rapport aux liens du sang ne m’était rien, me révéla que je détestais les enfants beaucoup moins que je le croyais. Sans que j’aie pu le prévoir, j’éprouvai pour lui une affection grandissante. Il m’aurait peut-être même totalement réconcilié avec l’enfance si …
S’il n’avait pas fallu un soir le conduire d’extrême urgence à l’hôpital. Sa petite anomalie cardiaque s’aggravait. Le surlendemain, il était mort.
Je ramenais du cimetière une Claude murée dans le silence, indifférente à tout, qui n’avait même pas adressé la parole à sa famille. Peu après, rapidement, sa santé se mit à décliner. Son médecin habituel n’y comprenait rien. Elle accepta de voir le mien, Francis Brandt, qui était de mes amis. Il lui concocta un régime vitaminé, re-minéralisant accompagné d’antidépresseurs. En privé, il me confia : « Elle n’a plus envie de vivre. Si cette envie ne la reprend pas, personne ne pourra rien pour elle ».
Et personne ne put rien pour elle. Ni Francis, ni le psychothérapeute, ni le psychiatre, ni le prêtre, ni ses amis, ni sa famille, ni moi. Au bout de peu de mois, elle se coucha un soir pour ne plus se réveiller. Je suivis accablé le cortège qui la menait vers le carré de verdure où l’attendaient son mari et son fils.
Cette très triste histoire eut pour moi des suites bénéfiques. La supériorité des juifs sur d’autres peuples vient de leur capacité à tirer des enseignements de leurs malheurs. La formule française « La vie continue » s’énonce comme un constat somme toute accablant. Un peu comme si la prohibition chrétienne du suicide nous condamnait à devoir vivre dans la souffrance.
Mes amis anglais, eux, disent : « Life must go on ! ». La vie doit continuer. Pas de résignation : un positivisme volontariste. Je décidais donc alors de faire mienne la devise latine « Dum vivimus, vivamus ! » Tant que nous sommes vivants, vivons.
Certes, je versais sur Alain et sur Claude les larmes brûlantes de l’homme mûr, mais puisque Atropos avait séparé nos routes, je devais continuer mon chemin.
Dans les biens que m’avait légués mon oncle se trouvait une petite maison au bord de l’Atlantique, avec un petit bout de jardin, non loin d’un petit port de pêche. Entre elle et moi, ce fut l’entente totale et elle devint ma résidence préférée.
En allant me promener vers le port je passais à proximité d’un petit chantier naval, qui maintenait en ordre de service les bateaux de pêche et quelques petites unités de plaisance. J’aime l’odeur du bois qu’on travaille, du goudron qui sèche, des voiles qui ont trop reçu d’eau de mer et des filets qui y ont mariné. J’entrai un jour sans intention particulière. Dans le fond se trouvait une coque, pas entretenue mais en bon état, qui portait un reste de peinture noire. Une carène curieuse, une sorte de pinasse trop large ou de bateau de pêche trop étroit ou trop long. Il restait la base de deux mâts. Cela aurait pu être ceux d’une petite goélette ou d’un brigantin, mais effilé comme un cotre, avec un poste de barre avancé derrière la misaine et un emplacement de moteur très important.
J’en parlais à Julien, le patron du chantier que j’avais côtoyé au bistrot local.
-Ah, me dit-il, la noire ?
- C’est son nom ?
- Elle n’a pas de nom, mais on l’appelle comme ça.
- C’était un bateau de pêche ?
- Si on veut …
- Avec une coque aussi élancée ?
- Vous vous y connaissez ?
- Pas vraiment, mais j’ai un peu barré en amateur. J’aime le bord de mer et les histoires de pirates »
Julien éclata de rire : « Vous tombez à pic. Je n’ai pas connu son propriétaire, mais mon père oui. C’était un drôle de bonhomme, moitié corse et moitié anglais qui s’appelait Johnny Argento.
- Que faisait-il ?
- On n’a jamais su. Contrebande, voire même un peu de piraterie
- A notre époque, ici ?
- Pourquoi non ?
- Personne ne l’a embêté ?
- Pendant la guerre, il a rendu des services en allant chercher en haute mer des gens qu’amenaient les sous-marins anglais, commandos, agents …., alors tout le monde a regardé à côté. Johnny est mort en ne laissant rien que son bateau en mauvais état et des dettes. Mon père l’a racheté pour presque rien.
- Est-ce que vous me le vendriez ? »
C’est ainsi que j’ai acheté la noire. Je l’ai fait remettre en état. J’ai tenu à ce qu’elle reste de cette couleur, mais j’ai fait peindre le plat bord et la flottaison d’une bande blanche. Elle est équipée à présent d’un diesel marin suédois. J’ai fait remonter les mats et j’ai choisi pour la gréer des voiles rouges : un foc génois et une brigantine, une trinquette et une grand voile à corne.
C’est un joli spectacle lorsqu’elle file à pleine toile. C’est donc, vous l’avez compris d’un bateau que je suis tombé amoureux vers la cinquantaine. Compte tenu de son passé, et puisqu’elle n’avait pas de nom, je l’ai appelé La Belle Brigande.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.