
De l’historicité de l’Exode - David Bensoussan

De l’historicité de l’Exode
David Bensoussan
Auteur de La Bible prise au berceau – Les Éditions Du Lys
Un croyant convaincu n’a pas besoin des preuves apportées par l’archéologie. La foi est un élan de l’esprit qui dépasse les cadres du raisonnement scientifique. Elle s’affirme comme un engagement personnel, transmis à travers les siècles, sans dépendre de la vérification historique des récits bibliques. Cela dit, comme le message biblique cherche surtout à transmettre une leçon humaine et morale à partir de l’Histoire — ou d’une lecture spirituelle des événements —, la rigueur des faits rapportés n’en constitue pas l’essentiel. Cela dit, les éclairages apportés par l’exégèse biblique comme par la recherche académique offrent des perspectives précieuses. Leur contribution mérite d’être reconnue, surtout si l’on considère l’influence profonde de la Bible dans le façonnement de notre civilisation.
La tentative de situer l’Exode dans l’histoire constitue un défi majeur auquel se heurtent nombre de spécialistes. En marge de l’exégèse biblique, ceux-ci s’efforcent de croiser les apports du texte biblique avec des disciplines comme l’archéologie, la climatologie, la géologie, ou encore la critique littéraire. Ce croisement d’approches permet d’éclairer partiellement certains éléments du récit biblique, sans pour autant en confirmer ni infirmer l’ensemble. Dans ce texte, le terme « Hébreux » désigne la nation d’Israël avant l’Exode. Toutes les dates mentionnées sont avant l’ère commune.
Données archéologiques et indices égyptiens
La documentation archéologique offre peu de traces directes d’un séjour des Hébreux en Égypte. Cependant, les sources égyptiennes évoquent, sous différentes désignations (Shassou, Habirou, Sémites, Cananéens, Hourrites), une présence étrangère significative sur plusieurs siècles. Les Hyksos en particulier — populations d’origine majoritairement hourrite — ont régné sur le delta égyptien entre 1650 et 1550.
La plupart des récits égyptiens anciens étant des textes de propagande pharaonique, ils tendent à travestir la réalité, allant parfois jusqu’à présenter des défaites comme des victoires. C’est le cas notoire de la bataille de Qadesh (1274), opposant Ramsès II au roi hittite Moutawalli, et décrite dans les bas-reliefs égyptiens comme un triomphe égyptien malgré l’impasse militaire. Aussi, l’omission d’une révolte d’esclaves réussie n’aurait rien de surprenant.
Parmi les documents les plus intrigants figure le Papyrus d’Ipou-Our, (Ipower) conservé au Musée national des antiquités de Leyde. Ce texte datant probablement du milieu du XIIIe siècle, durant la XIXe dynastie (1292–1203), décrit une série de catastrophes sociales et naturelles — fleuve en sang, manque d’eau potable, végétation détruite, effondrement de l’ordre social — qui évoquent certaines des dix plaies de l’Exode.
La construction de la ville de Pi-Ramsès, dans l’est du delta du Nil, sous Ramsès II, concorde avec le récit biblique (Exode 1-11) qui évoque l’édification des villes de Pithom et Ramsès par des esclaves hébreux. Pi-Ramsès est aussi mentionnée comme point de départ de l’Exode.
La stèle de Mérneptah (1209), fils de Ramsès II, affirme quant à elle qu’« Israël est dévasté, sa semence n’existe plus », ce qui indique que des groupes d’Israélites étaient déjà établis en Canaan à cette date.
Toutefois, cette mention pourrait ne viser qu’une fraction de la descendance de Joseph, notamment une partie des tribus d’Éphraïm et de Manassé, restées au pays de Canaan après les funérailles de Jacob. Le psaume 81:6-7 évoque à cet égard une libération spécifique à Joseph : « J’ai déchargé du fardeau son épaule… ».
Le terme hébraïque shekhem signifiant épaule désigne également la ville de Sichem (aujourd’hui Naplouse) léguée par Jacob à Joseph. Cette ville n’a pas été conquise par Josué, ce qui pourrait indiquer que la tribu d’Éphraïm y était déjà implantée avant l’entrée en Canaan. Cela expliquerait aussi l’augmentation importante de la tribu de Manassé entre le début et la fin de l’errance dans le désert.
Apports de la climatologie et de la géologie
L’éruption du volcan Théra (Santorin), datée du XVe ou XVIe siècle, accompagnée d’un tsunami, a pu inspirer les récits du passage miraculeux de la mer Rouge et les perturbations naturelles analogues aux dix plaies : faune et flore dévastées
Selon le récit biblique, Jéricho fut la première ville prise d'assaut par les Israélites après leur passage du Jourdain et leur entrée en Canaan. Or, la Jéricho de l’âge du bronze, que Josué aurait conquise peu après la mort de Moïse, aurait en réalité été détruite par un violent tremblement de terre au XVIe siècle, entraînant l'effondrement de la ville. Cet événement aurait pu être intégré au récit biblique plus tardivement.
Une crise climatique mondiale survenue vers le milieu du XIIIe siècle pourrait avoir déclenché de vastes migrations : invasion des Peuples de la Mer, chute de l’empire hittite, conflits avec l’Égypte. Ces derniers sont abondamment représentés dans les bas-reliefs égyptiens de Médinet Habou.
Dans ce contexte chaotique, une révolte d’esclaves hébreux devient historiquement plausible. Leur itinéraire, qui évite la route côtière fortement militarisée, suggère une stratégie d’évitement en temps de guerre. L’état de conflit entre l’Égypte et les Peuples de la mer aurait favorisé un exode par le désert.
Influences culturelles
Au nombre des influences égyptiennes dans le récit biblique, soulignons celle de la structure du Tabernacle (Mishkane), aux dimensions similaires à la tente de guerre de Ramsès II à Kadesh. On y retrouve des expressions telles que « main forte et bras étendu », fréquentes dans la rhétorique égyptienne.
La théologie monothéiste d’Akhénaton (XIVe siècle) a parfois été rapprochée du culte de YHWH, bien que le dieu Aton soit indissociable de la figure du pharaon. Dans cette optique, les Lévites, qui n’eurent pas de territoire en héritage, seraient d’anciens opposants à la divinisation du souverain égyptien, ayant rejoint et guidé les Hébreux. Par ailleurs, plusieurs noms d’Hébreux d’origine égyptienne sont portés par des Lévites: Moïse (Mses), Aaron, Pinhas, Merari, Moushi, Pashour, Hofni, Hour.
Certains chercheurs dont Richard Elliott Friedman restreignent l’Exode à la seule tribu de Lévi — dont le nom signifie « accompagnateur » — qui, contrairement aux autres tribus, ne reçut pas de territoire. Ces Lévites auraient introduit le culte de Yahweh, fusionné avec celui d’Élohim, et imposé à la population qui occupa les hautes terres cananéennes à la fin du XIIIe siècle. Ainsi, les Lévites adorateurs de YHWH venues d’Égypte auraient rejoint les tribus d’Israël vénérant Élohim qui comprenaient une partie de la descendance de Joseph et les tribus d’Israël fraichement immigrées du Bassan au Nord de la Transjordanie.
Le Deutéronome (6:20-23) évoque la transmission intergénérationnelle du souvenir de la sortie d’Égypte lors de la présentation des prémices au prêtre : « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Yahvé nous a fait sortir… ». Ce « nous » collectif rappelle comment une minorité active pourrait influencer l’ensemble d’un peuple, à l’image des puritains écossais qui ont imposé la fête de Thanksgiving en Amérique du Nord.
La critique textuelle du Pentateuque identifie plusieurs sources rédactionnelles : Yahviste (Y), Élohiste (É), Sacerdotale (P), Deutéronomiste (D), et Rédactrice (R). Cette dernière aurait découpé et combiné les autres sources pour composer le Pentateuque. La source P, d’inspiration sacerdotale, est pratiquement la seule à développer les lois concernant les étrangers, le statut d’esclave et la sortie d’Égypte.
Références temporelles et complexité du récit
Les hypothèses visant à dater l’Exode sont nombreuses et loin de faire consensus. En voici un échantillon représentatif.
Dans la correspondance du pharaon Akhénaton (XIVᵉ siècle), découverte à Tell el-Amarna en Égypte, plusieurs roitelets cananéens se plaignent d’attaques menées par les Habirous. Certains chercheurs ont avancé que ces Habirous pourraient être assimilés aux Hébreux, arrivés en Canaan antérieurement.
D’autres théories situent la rédaction du récit au VIIᵉ siècle, sous le règne du roi Josias (640–609), une époque marquée par la résistance de la Judée face à l’Égypte, tout juste affranchie de l’emprise assyrienne. Des descriptions géographiques du Néguev et de la Transjordanie auraient alors été intégrées au texte. Cependant, l’Exode est déjà évoqué par les prophètes Amos et Joël au VIIIᵉ siècle, ce qui en repousse l’origine à une époque antérieure.
Par ailleurs, le Cantique de la mer (Exode 15:1-18) cite les Philistins, Édom, Moab et Canaan — des peuples précisément attestés au XIIᵉ siècle.
Un obstacle majeur à l’adhésion littérale au récit est le nombre de 603 500 hommes adultes recensés. Le terme hébraïque éleph pourrait désigner un clan plutôt qu’un millier, mais cela entre en contradiction avec d’autres chiffres bibliques (par exemple, les 22 273 aînés). D’ailleurs, plusieurs passages bibliques insistent sur la petitesse d’Israël (Exode 23:29-30 ; Nombres 3:13). Soulignons que la source du recensement du nombre de personnes sorties d’Égypte est la source sacerdotale (P) qui pourrait avoir pris en considération les statistiques d’une période historique ultérieure à l’Exode.
Une composition mosaïque de peuples et de récits
Il est possible qu’il y ait eu plusieurs exodes : d’abord le retrait des Hyksos ; ensuite, celui d’une partie de la famille de Joseph venue enterrer Jacob au Canaan ; enfin, l’Exode mosaïque, que l’on pourrait situer autour de 1230.
Aucune théorie ne recoupe parfaitement le récit biblique. Le récit de l’Exode semble une construction élaborée à partir de récits authentiques, de traditions et de légendes. Les chercheurs proposent des hypothèses souvent partielles, voire contradictoires. La complexité ethnique d’Israël — incluant des composantes sémites, chamites et indo-européennes — renforce cette pluralité. L’Exode 12:38 évoque une « population nombreuse » qui suivit les Hébreux. Le psaume 107:2-4 confirme également cette diversité venue « de l’Orient et du Couchant, du Nord et de la Mer ».
Qui constituait cette population nombreuse ? Les esclaves en Égypte étaient en grande partie des prisonniers de guerre : Peuples de la Mer indo-européens venus de la mer Égée, Libyens berbères en guerre contre l’Égypte sous Séthi I, Ramsès II, Merneptah et Ramsès III, Hittites indo-européens ennemis historiques de l’Égypte ou encore Nubiens chamites soumis puis en révolte depuis Toutmès III. L’historien Flavius Josèphe rapporte d’ailleurs que Moïse, dans sa jeunesse, aurait conduit une expédition militaire contre l’Éthiopie.
Une quête universelle de liberté
La précision psychologique du texte biblique contraste avec son flou chronologique. Comme l’écrit Renan dans la préface de l’Histoire du peuple d’Israël : « L’âge patriarcal… se perd dans la nuit ». Cette remarque de Renan semble s’appliquer au Pentateuque dans son entier. Le Pentateuque invite à la critique et à la quête d’une cohérence historique, mais chaque hypothèse débouche sur de nouvelles conjectures. Son message est avant tout didactique. Les images du récit biblique frappent par leur puissance et leur ancrage dans la mémoire collective.
C’est ce que soulignait Heinrich Heine dans une formule célèbre :
« Depuis l’Exode, la liberté a toujours parlé avec un accent hébreu. »
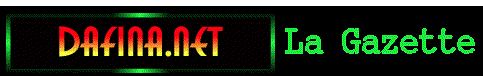
Commentaires
Publier un nouveau commentaire