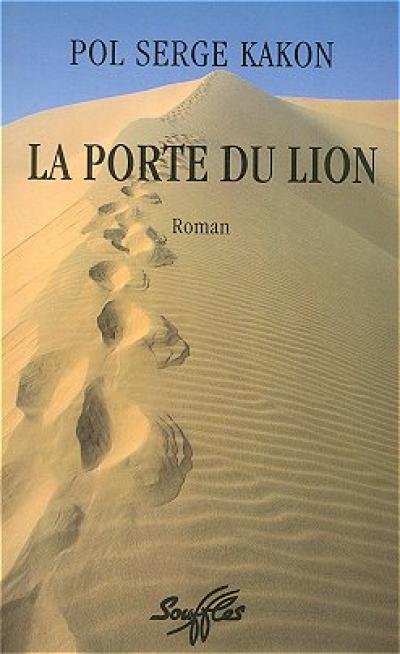
RĂ©pondre au commentaire
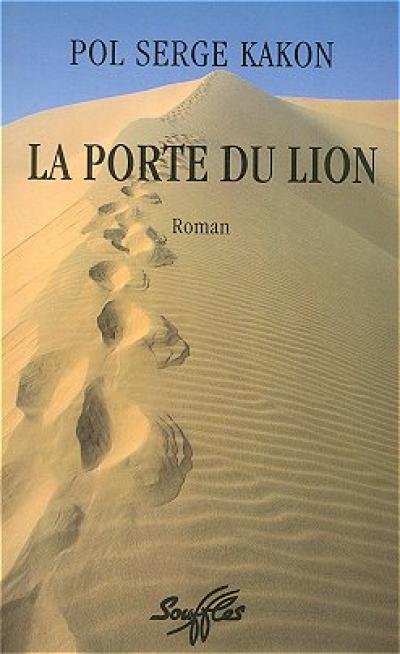
LA PORTE DU LION, par Pol Serge Kakon
Dafina.net a le plaisir d'offrir à ses lecteurs un premier chapitre de La Porte du Lion , le roman de Pol Serge Kakon et publiera la suite prochainement.
"C'est toute la saga des juifs du Maghreb qui se dessine avec son inaltérable appétit de vivre" . Le Figaro Littéraire
Josef revenait à Igli.
Josef, 73 ou 75 ans, ou plus encore peut-être, la silhouette déliée, le corps alerte, le pas ferme, l’insulte aux lèvres et ce quelque chose dans le regard qui lui avait valu tant de provocations, de rixes, de balafres et de fuites. Josef, la fureur au bout des doigts et la magie d’embellir ce qu’ils touchaient. Il n’y a pas si longtemps encore, il pouvait soulever une jarre pleine d’olives et la fracasser sur sa tête, pour s’apaiser le cœur, disait- il, lorsqu’un de ses fils l’avait mis en colère. Voilà Josef, tendre, hérissé, traduisant ses émotions par des rires, des rugissements ou des jurons, comme si les piments si forts qu’il avait l’habitude de croquer, entrecoupés d’eau de vie ressortaient de sa bouche en mots enflammés. Et les yeux de Josef, toujours en mouvement, aux aguets du moindre signe de beauté, de révolte, de charme ou d’outrage.
Un papillon. Les papillons sont des âmes en ballade dans l’attente de mutations célestes. Donc quelqu’un venait de mourir quelque part et le papillon de son âme — livré aux caprices de l’air, virevoltant, s’écartant d’un buisson fleuri — vint tournoyer au-dessus de la tête de la mule qui secoua les oreilles, agacée. Josef, qui suivait le papillon des yeux tout en rêvant, sursauta et s’en prit à sa monture.
— Qu’est-ce qu’il t’a fait ? En quoi il te dérange, stupide animal, aberration des sexes ? Péter, manger, c’est tout ce que tu sais faire. De lui, il sortira peut-être une adorable créature. Mais toi, Dieu seul sait pourquoi il t’a faite stérile. Pour ne pas perpétuer ta sottise.
Et Josef se mit à rire, se surprenant à discourir seul, sur sa mule comme dans l’ancien temps, par les routes et les chemins cachés, à la tête de sa caravane. Il rit, Josef. De son rire qui faisait fondre en un éclair toutes les contradictions. On aurait dit que ses dents broyaient ces petits génies malfaisants suspendus dans l’air qui sécrètent la discorde entre les hommes. De ce rire même qu’il avait simulé pour annoncer à Faucon et à Bon-Œil son départ pour la Terre Sainte.
— En Terre Sainte... Toi ? s’étonna Bon-Œil.
— Eh bien oui ! Moi. Comme tu l’entends mon vieux frère, en Terre Sainte.
— Mais pour quoi faire ? demanda l’autre d’un air ahuri.
— Mais pour me balader, pardi, visiter les Lieux Saints. Et pour me faire voir ailleurs. Et je n’en sais rien pourquoi. Mes fils m’offrent le voyage. J’aurais tort de m’en priver.
Josef s’abstint de leur expliquer que de jeunes rabbins étrangers, de passage à Mogador, avaient proposé aux membres des familles aisées ou riches un pèlerinage en groupe à Jérusalem. Deux personnes seulement avaient décidé d’y participer, « les deux petits sages ». Des frères jumeaux, très pieux, célibataires d’âge avancé, pâles et de petite taille, d’une grande naïveté. Ils avaient la démarche craintive, s’habillaient encore pareillement et se rendaient aux trois offices quotidiens de la grande synagogue, ponctuels et silencieux, comme de bons petits écoliers. Les fils de Josef, trop pris par leurs affaires et si peu intéressés, suggérèrent, non sans ironie, ce voyage à leur père, au cours du repas du samedi. Josef y flaira l’occasion de « s’évaporer », comme il se le disait depuis un certain temps et répondit avec sérieux : « Excellente idée. Ça me fera du bien de changer d’air. »
Les fils de Josef — plus émus qu’embarrassés — l’inscrivirent et le départ du « Voyage des trois sages », comme l’appellera plus tard Bon-Œil, fut fixé.
— Ça alors ! s’exclama Faucon qui s’estima trahi ; musulman, il se voyait exclu d’un tel voyage.
La voix serrée par l’émotion, il ajouta :
— La Terre Sainte..., si tu veux. Mais à Igli, pour quoi faire ?
— Ben, pour prendre congé de nos ancêtres. Sait-on jamais à mon âge ! Tout de même, c’est une grande aventure qui m’attend à mon retour d’Igli. Alors, il vaut mieux que j’aille dire adieu à notre belle jeunesse.
— Un peu tard, je trouve, pour lui rendre la politesse. Elle s’est tirée sans s’excuser, la jeunesse. Alors ? répondit Faucon.
— Tu ne comprends rien à ces choses-là, dit Josef.
— Admettons. Et après ? Que comptes-tu faire ?
— Après, je reviens à Mogador préparer ma malle, je prends le bateau et salut : le tour est joué, dit Josef éclatant d’un grand rire.
— Quel tour ? Qu’est-ce que c’est encore que cette nouvelle folie qui le prend ? dit Bon-Œil en regardant Faucon.
Puis s’adressant à Josef, il ajouta :
— Je trouve que tu te noircis la vie depuis quelque temps. Remarque, une balade jusqu’à Igli ne te fera pas de mal, ça va te calmer la citrouille. Tu verras plus tard pour la Terre Sainte.
Puis après un silence, il ajouta :
— Ça va faire plus de quarante ans qu’on n’y a pas mis les pieds, à Igli. Tu crois que quelqu’un te reconnaîtra ?
— Diablotin, s’il est toujours en vie, répondit Josef.
— Va où tu veux, intervint Faucon. Mais le destin nous a toujours voulu ensemble. Il ne faut pas nous séparer. Maintenant que nous sommes des vieillards enragés, allons ensemble au Paradis ou en Enfer, comme Dieu le voudra. Alors je pense qu’il faut que je t’accompagne.
— Où donc ? En Terre Sainte ?
— Je vais t’accompagner d’abord à Igli si tu veux bien, répondit Faucon en souriant.
Puis il ajouta :
— Qu’est-ce que c’est que cette manie que vous avez tous, vous, les juifs, de vouloir aller à Jérusalem ? Si Dieu vous avait voulu là-bas, il ne vous aurait pas envoyé ici, et... Eh ! Dis-moi, en Terre Sainte, qu’est- ce que tu y feras sans nous ?
— Je pourrai toujours mourir d’ennui ou prier jusqu’à la fin des Temps pour le pardon de tous les péchés que vous m’avez fait commettre, dit Josef. Allez, accompagnez-moi jusqu’à l’autocar.
— A l’autocar ! s’étonna Bon-Œil. Alors Monsieur a prévu son coup depuis longtemps ?
— Probablement depuis hier samedi, intervint Faucon. Tous les samedis, ils ont des histoires. C’est sans doute le résultat d’une dispute avec ses fils, après une bonne dafina* bien arrosée d’eau de vie. Ils sont tous emportés et violents dans cette famille. Alors ils prennent des décisions irrévocables le samedi qu’ils regrettent le dimanche.
— Non, pas une dispute, dit Josef, une conversation, voilà. Ils me l’ont proposé comme une blague. Je les ai pris au mot. Après tout, c’est le rêve de tous les juifs d’aller à Jérusalem. Alors, pourquoi pas ? Je vais aller voir un peu. Ça m’occupera, ça les débarrassera. Comme j’aime bien voyager, et ça fait trop longtemps que je n’ai pas bougé mon cul...
— Ah, au moins comme cela je comprends mieux, dit Faucon. Tes fils te conseillent de prendre le large. Mais j’apprécie ta pieuse idée de bouger ton cul. C’est péché que je t’accompagne ?
— Moi tout seul, passe encore dit Josef en éclatant de rire. Mais à nous deux, nous allons profaner toute la Terre Sainte.
Et il se mit en marche, suivi de ses deux amis, tout à coup silencieux, en direction de la Place des Doukalas, d’où partaient les autocars vers le Sud. A la Porte du mellah*, sous le porche, ils croisèrent Chmouel, le vieux cordonnier, croque-mort bénévole et zélé, retiré dans une surdité complète et toujours rasant les murs par crainte de se faire écraser par une charrette. Josef détesta cette rencontre. Faucon fit comme s’il saluait le vieux Chmouel en disant :
— Bonjour, dévoreur de cadavres.
L’autre crut à une formule de politesse, se pencha obséquieusement et répondit :
— Bonne journée, mes Seigneurs.
Quant à eux, ils pressèrent le pas en étouffant leurs rires pour se mêler à la foule des voyageurs agglutinés autour des autocars. Les bleus et verts qui assuraient la ligne Mogador-Agadir-Taroudant, appartenaient aux fils de Josef et faisaient leur orgueil et leur fortune.
— Adieu, les amis, dit Josef en se hissant lestement sur le marchepied du car.
Puis il se retourna, embarrassé par leur présence et les invita à se retirer.
— Allez, tirez-vous maintenant. Vous n’allez tout de même pas vous mettre à distiller le chagrin en jubilant de cette aubaine comme deux vieilles filles ! Nous allons nous revoir dans quatre à cinq jours à peine.
— « Route de salut », dit Bon-Œil qui détourna rapidement le regard.
— Et pas d’imprudence, vieux brigand, dit Faucon en riant pour se donner une contenance.
Ils lui tournèrent le dos, firent quelques pas, se retournèrent à nouveau, firent des signes de la main et une fois encore, avant de s’engouffrer parmi la foule qui entrait à la ville par la Porte des Doukalas qu’on refermait à la tombée de la nuit.
— Pas de valise, Monsieur Josef ? s’enquit le contrôleur, comme Josef lui tendait un petit balluchon.
— Rien de plus, toujours léger, répondit-il.
Puis il s’installa derrière le siège du conducteur qui prenait son thé et s’empressa de lui en offrir un verre. Josef accepta en remerciant.
Peu à peu, le car se remplit de passagers qui retournaient dans leur douar, chargés de sacs, de paniers ou de ballots.
Le conducteur mit le moteur en marche et accéléra pour démarrer. Les passagers, qui n’attendaient que ce signal, crièrent en chœur « Route de salut » et le car s’ébranla. L’expression plaisait à Josef qui sourit.
Bientôt, on quitta l’agglomération pour apercevoir à droite la plage et les deux petites îles dans la rade de Mogador, à gauche des collines boisées et devant soi la route qui s’enfonçait dans les terres et dont la seule vue pouvait griser Josef. Sur le bas-côté, un groupe de femmes s’éloignait de la ville. Elles semblaient poussées par le vent — fort ce jour-là — qui plaquait contre elles leur haïk blanc et soulignait les formes arrondies de leurs corps. « Elles doivent se rendre à un mariage » pensa-t-il et cette idée le réjouit. Le car s’arrêtait de temps à autre pour prendre ou déposer un voyageur. Au premier arrêt, une femme imposante, à l’allure de matrone, monta, essoufflée. Elle portait le voile, mais ses grands yeux noirs entourés de khol semblaient avides de subjuguer. Son regard croisa celui de Josef. Ils se mesurèrent une ou deux secondes. Puis elle avança provocante vers les banquettes à l’arrière, suivie d’un petit homme bossu qui marchait plié en deux.
A chaque étape importante, Josef descendait se dégourdir les jambes en scrutant des yeux la foule des souks, voyageurs, badauds et mendiants devant les fondouks*, attentif aux visages et aux choses comme s’il traquait un souvenir. Long et fatigant trajet. Rien n’avait changé. Il apercevait les mêmes gens trottinant sur leurs ânes vers les mêmes foyers, humbles et secrets, vers les mêmes solitudes. Enfin, à nouveau la mer, à l’approche d’Agadir. Bleue, bordée de brume comme un miroir d’où se retire la buée pour accueillir le regard.
Le car s’arrêta. Le petit bossu descendit et Josef vit un signe favorable dans ce départ. Quant à la matrone, il vérifia qu’elle était encore là. A nouveau, leurs regards se croisèrent. En d’autres temps — peut-être aujourd’hui encore — Josef n’aurait pas dédaigné établir entre elle et lui quelque complicité étrange, mais... Il se rappela à l’ordre aussitôt : « Josef, tu n’es qu’un vieux cinglé, après l’âge, c’est plus l’âge ! » et il se retourna vers les montagnes arides au pied desquelles, dans les champs de pierres et de cactus, se dressaient,
entourés de leurs sabres, les agaves aux troncs longilignes, surmontés d’une touffe comme un panache, combattants hautains et absurdes. La route se poursuivit. Josef s’assoupit malgré les chaos et les arrêts, jusqu’à Taroudant.
Il y fut reçu avec empressement par la famille Oizana qui prospérait dans une affaire de meunerie dont David, le fils de Josef, avait été le principal commanditaire. Ils auraient souhaité le retenir quelques jours afin de prévoir une réception digne de son rang. « Mon rang », pensa Josef, « mon rang, c’est le large, c’est la route ». Et devant sa hâte de partir dès le lendemain, ils lui firent seller leur meilleure mule qu’il enfourcha dès l’aube pour prendre la route d’Igli.
Il faut se souvenir que c’est sur sa mule, ce jour-là, que Josef fit la rencontre du papillon, qu’il injuria sa monture et, enfin, s’était mis à rire. Parallèlement au chemin poussiéreux il prit en contrebas un sentier étroit que les sabots obstinés des ânes avaient gravé sur de larges pierres comme des dalles espacées, à travers les buissons, rasant parfois les enclos de ronces ou des murets de pierres. La solitude de ce petit sentier qu’il retrouvait après tant d’années inchangé, lui procura un bonheur simple. « Enfin tranquille », se dit-il. Une brise légère porta à ses narines un parfum qui le fit sourire et au même instant, d’une bergerie proche qui semblait inhabitée, sortit une adolescente potelée qui portait une cruche sur son épaule. Elle descendit vers une source que Josef avait connue plus loin au pied de la colline. Il la vit s’éloigner à regret en suivant des yeux le balancement de ses hanches. « C’est à se briser le cœur », murmura-t-il. Puis il s’étira, huma l’air à nouveau, reconnut le parfum du jasmin sauvage qui fleurissait en mai par touffes entières sur les versants les plus escarpés.
Il tuait les scorpions en les attirant avec cette fleur quand il était gamin à Igli. Dans la chaleur accablante des après-midi de printemps, le village semblait s’assoupir. Alors, Josef courait vers les collines en compagnie d’un camarade, coupait quelques tiges de jasmin sauvage dont la fleur conique, fine comme son petit doigt, dégageait un parfum enivrant, délicieux. Sous de grosses pierres, il repérait les trous habités par les scorpions. Puis, en silence, délicatement, progressivement il introduisait dans le trou l’épi parfumé dont raffolent les odieux animaux. Le scorpion, dérangé dans son refuge par cette intrusion, se méfiait tout d’abord et se terrait au fond sans donner le moindre signe de vie. Tout autre à sa place se serait impatienté. Mais Josef, lui, savait que le scorpion dissipait peu à peu ses hésitations et qu’il approchait très lentement, comme à tâtons, dans l’infime labyrinthe noir. Des vibrations lointaines et à peine perceptibles parvenaient enfin aux doigts de Josef tenant la tige entre le pouce et l’index et lui parcouraient l’épiderme. Mais lui demeurait immobile, tout son corps tendu. Des gouttelettes de sueur couraient sur ses joues et le long de son cou. Il attendait sans frémir. Le scorpion pinçait le jasmin, ne le lâchait plus. Josef, par petits coups, l’attirait progressivement au dehors, mesurant, le souffle coupé, la tension de la tige qui les reliait l’un à l’autre. Parfois, il lâchait prise, laissant Josef palpitant, les lèvres sèches, presque au bord des larmes. Mais tout à coup, comme s’il avait perçu le découragement ou l’abandon à l’autre bout de la tige, le scorpion se ravisant, animé par un nouvel instinct, de lutte ou de mort, s’accrochait désespérément à la fleur et se laissait extirper jusqu’à la lumière. Alors, Josef armé d’une lame tranchante taillée dans un roseau, d’un coup lui sectionnait la queue, pour le rendre, sans l’arme de ses crimes, inutile et grotesque.
Les yeux de Josef brillèrent au souvenir de ses jeux d’enfant. Tout en secouant les rênes pour hâter les pas de sa mule, il fit claquer sa langue avec un sentiment où se mêlaient le plaisir et l’amertume, comme s’il entendait Hannah le gronder en apprenant qu’il s’était encore livré à ses jeux dangereux avec ces maudites bêtes.
On peut dire que c’est Hannah qui l’avait élevé, depuis le jour même de sa naissance, un après-midi d’avril, pendant que les complications d’une rougeole emportaient son frère de deux ans son aîné. Josef avait poussé le cri de vie des nouveau-nés au même instant où son frère s’éteignait dans un râle de l’autre côté du patio au fond d’une chambre obscure. La double nouvelle avait traversé d’un même frisson le mellah d’Igli. Des femmes accoururent des maisons, les unes vers la chambre du défunt où les accueillaient les grands-mères, d’autres vers celle du nouveau-né dissimulant de leur mieux leur émotion devant la jeune mère cloîtrée dans un silence qui laissait peu de doute sur ce qu’elle avait déjà deviné. Quelques instants après l’accouchement, elle éclata en sanglots, se mit à hurler, à se débattre comme pour s’enfuir, les yeux traversés d’éclairs de douleur et de folie. Sa soeur Hannah ainsi que la sage-femme tentèrent de la calmer. Sans résultat. Elle se mit à hurler de plus belle, si bien que les femmes réunies dans le patio, n’en pouvant plus de se contenir, poussèrent à leur tour des cris déchirants et des pleurs qui mirent fin à l’atmosphère feutrée qui régnait dans la maison.
— Hannah..., dit la mère dans un sanglot en lui montrant le petit, emporte-le hors de cette maison, je n’ai pas le coeur à m’en occuper. A quoi ça sert ?
— Ne blasphème pas, malheureuse, répondit Hannah furieuse. Que connais-tu aux desseins de notre Dieu ? Il t’envoie la vie. Lève les yeux vers lui, il te donnera le courage.
Puis Hannah emmitoufla l’enfant, l’enroula dans une couverture et l’emporta chez elle, en face, hors de la demeure endeuillée, le serrant contre elle comme si elle l’avait volé.
Des hommes arrivèrent sombres et graves qui s’installèrent dans un angle du patio sur des chaises basses, chuchotant leur étonnement en formulant des paroles de circonstance : « Dieu est grand »... « Puisse notre Seigneur mettre un terme à nos peines »... « C’est lui qui donne et lui qui reprend. »
Le père, assis parmi eux, pleurait doucement en se couvrant la face de ses longues mains blêmes.
Ces mêmes hommes, réunis quelques jours plus tard, devaient célébrer la circoncision du petit, auquel on donnera le prénom de Josef, comme son grand-père. La cérémonie se déroula dans une atmosphère d’austérité et fut présidée par l’Oncle Eliahou, un grand géant excentrique et barbu. Assis sur la haute chaise réservée à ce rite, Eliahou, ému, tenait l’enfant pendant que le mohel* procédait à l’opération. Aussi, pour braver son trouble, il accompagnait les prières avec une ardeur ostentatoire. Hannah qui se tenait à ses côtés, à distance, observait les visages de ces hommes empreints d’une fidélité à la fois soumise et fervente. Sans distraire son attention du petit Josef, elle s’entendit murmurer pendant la prière : « On te demande mon Dieu d’élever nos garçons dans le respect de nos lois, l’obéissance à nos règles, permets-moi O mon Dieu, de te demander cette faveur, donne à ce petit Josef une santé de fer. » Et sans savoir pourquoi, elle ajouta : « et de l’insolence ».
Le mohel était un homme âgé, barbu et boiteux, affligé de surcroît d’un strabisme qui lui donnait un air d’inspiration permanente. Mais il s’acquitta de sa tâche remarquablement. Après son habile coup de rasoir, il s’emplit la bouche d’eau de vie pour en asperger le minuscule phallus qu’il recouvrit d’un pansement. Une autre prière enfin s’ensuivit qui fut reprise par tous les hommes. Lorsqu’elle se termina, Hannah laissa échapper un bref youyou, comme un défi, pour marquer cet instant d’un signe de joie malgré le deuil. Des regards réprobateurs auraient rappelé à l’ordre toute autre femme. S’agissant de Hannah, il n’en fut rien.
Enfin, Eliahou se redressa cérémonieusement pour restituer le petit à sa mère qui s’échappa en pleurs, laissant à Hannah le soin de le reprendre pour le calmer dans ses bras. On servit aux hommes des petits verres d’eau de vie, on fit passer des plateaux de fruits secs.
— Nous ferons à notre petit Josef de grandes fêtes, en d’autres circonstances heureuses par la grâce de Dieu, dit Eliahou en guise de discours. Il le mérite. Il nous a apporté la vie au moment où la mort frappait chez nous.
Les hommes approuvèrent de la tête, on entendit quelques femmes murmurer « Amen » et l’assemblée se dispersa pour s’éparpiller dans le mellah.
Le mohel s’en alla en boitillant, solitaire. En le voyant s’éloigner, Eliahou dit à Messager, intime de la famille :
— Il m’a étonné, ce brave homme. Je dois t’avouer que j’avais quelque appréhension, quelque crainte même, car il est à l’âge de l’approximatif. Mais tout mon respect. Il est plus adroit qu’un jeune homme. Il est dit dans le Talmud...
L’Oncle Eliahou aurait continué longtemps à pérorer, allant jusqu’à déformer des citations de la Bible, dans le seul but de provoquer une polémique pour servir ses interminables discours. Messager, qui savait à quoi s’en tenir, au premier coin de rue prétexta une course urgente et prit congé en lui disant :
— A très bientôt, cher Eliahou. J’espère que nous nous réunirons dans de plus belles fêtes à l’avenir.
C’est vrai qu’il y en eut, des fêtes, dans les années qui suivirent la naissance de Josef. Le mellah d’Igli occupait près de la moitié du village. Dans l’autre partie vivaient les familles musulmanes. La population se composait de petits cultivateurs, de pasteurs, de quelques négociants ou riches propriétaires. Mais parmi les juifs, on rencontrait des artisans, cordonniers, selliers, bijoutiers et des colporteurs qui proposaient des tissus et des articles de mercerie, de village en village, les jours de foire. Chacun son culte, son cimetière, ses traditions, ses sages et ses fous, ses pauvres et ses riches. Il y eut des fêtes car ce fut une période bénie, de tolérance et d’abondance. Plus de razzias de pillards qui mettaient parfois le village à feu et à sang. Les bandits de grands chemins qui assassinaient les voyageurs disparurent des routes. Les Caïds eux-mêmes ne rançonnaient plus, veillaient à l’ordre et à la justice, discrètement, comme s’ils redoutaient de contrarier le regard bienveillant de Dieu qui offrait sa protection à la contrée. Par négligence ou par distraction, le méchant vent de l’histoire se tenait à l’écart d’Igli qui s’endormait le soir étonnée, muette de gratitude.
A l’aube, en même temps que les prières qui s’élevaient de la mosquée, de la synagogue, avec les brumes du matin, on aurait dit que les chants des coqs, repris de maison en maison comme un écho, faisaient bleuir le ciel. La terre frémissait d’une multitude de sabots, du rythme des pilons écrasant les grains, pendant que l’air se chargeait de senteurs de menthe, de l’odeur de pain chaud et du parfum des vergers environnants. Jamais on n’avait vu de telles récoltes de céréales, de lin, de cumin, d’olives et de miel à profusion. Le bétail, bien nourri, suscitait des béné¬dictions de reconnaissance. Dans les deux commu¬nautés, des vieux moururent tranquilles comme s’ils se retiraient rassurés. Il y eut des naissances en grand nombre, des bar-mitsvah*, des mariages, des moussems* et des pèlerinages mémorables. Pour célébrer la circoncision d’un fils qu’il avait eu après quatre filles, le Cheik musulman fit égorger des moutons par dizaines, selon le rite de chacune des religions, et les villages à la ronde lui envoyèrent leurs délégations chargées de présents. Pour le mariage de sa fille unique, un négociant juif fit venir une troupe de musiciens et de danseuses de Tiznit. Leurs chants et leur musique résonnèrent dans le village toute la nuit. Longtemps après leur passage, les femmes reprochaient encore vertement à leurs maris les regards brûlants qu’ils avaient eus pour les danseuses.
Les enfants de cette époque bénie s’élevèrent sans connaître les privations, la sécheresse et son cortège d’épidémies et de famines, que leurs aînés avaient connus en d’autres temps. Bien sûr, ils participaient aux travaux des champs, à l’entretien du bétail, fréquentaient l’école coranique ou l’école juive, mais à certaines heures, à l’entrée du village — par petits groupes selon leur âge — on les voyait se poursuivre en riant, se battre, grimper aux arbres, harceler les ânes ou les chiens. En été, lorsque le soleil plongeait la vallée dans une stupeur bienheureuse, ils se réunissaient sous les figuiers, derrière ces hauts remparts d’argile qui défendaient Igli contre les assauts de ses ennemis et retenaient les nids des cigognes qui revenaient chaque hiver.
En ces années prospères, David, le père de Josef, prit place parmi les riches. Avec son associé musulman, Ould Talb, bel homme raffiné, d’une grande courtoisie, aux yeux clairs pétillants d’humour et d’ironie, ils achetaient, stockaient des céréales, du cumin, des amandes, de la cire d’abeilles, qu’ils expédiaient aux comptoirs anglais de Mogador. Leurn caravanes revenaient après plusieurs jours, chargées de sucre, de thé, de tissus qu’ils revendaient aux colporteurs de la région, et de quincaillerie rutilante qui attirait de très nombreux acheteurs, surtout le dimanche qui était jour de souk à Igli.
Hannah vint les surprendre un après-midi dans leur magasin. Comme ils étaient seuls, elle entra en leur criant :
— « Cinq sur vous. » Que le mauvais œil s’écarte de vos personnes.
— Sois la bienvenue, répondirent-ils.
— Quelle bonne surprise, dit Ould Talb. Tes pas seuls éloignent le mauvais œil et nous portent chance.
— Je passais par là. Alors, comment résister à la joie de te voir, répondit-elle d’un ton enjoué. Et puis, j’ai pensé que vous m’offririez quelques bougies pour les brûler sur la tombe du Saint. Nous partons demain pour le pèlerinage de Rabbi Chlomo.
— C’est déjà demain ? s’étonna Ould Talb. Alors le mellah va encore se vider de ses habitants.
— Pas complètement, intervint David. Beaucoup de gens n’iront que vendredi pour passer le Shabbat, puisque c’est seulement dimanche le jour de la Hiloula*. Mais Hannah et mon Josef font partie des privilégiés qui vont dès demain avancer avec les premiers pèlerins. Ils sont libres comme les oiseaux, alors il faut qu’ils en profitent... Ah ! ah! ah !... et il termina son propos par un petit rire de contentement, comme le font parfois les timides surpris de s’entendre énoncer jusqu’au bout, clairement, leur pensée.
— Fais comme chez toi, Hannah, dit Ould Talb. Prends tout ce qui pourrait te faire envie.
— Merci, mon Prince, répondit-elle. Je sais combien ton cœur est généreux. Je prendrai seulement quelques bougies et je prierai le Saint pour que Dieu te garde ainsi.
Puis elle ajouta dans un sourire, ses grands yeux noirs pleins de malice :
— Ainsi, tel que tu es.
— Je sais que votre Saint a grand pouvoir, dit Ould Talb amusé, mais il ne faut pas lui demander l’impossible. C’est déjà un privilège que d’entrer dans la vieillesse. Merci Hannah. Qu’il veille sur nous tous.
— Tiens, Hannah, dit David en lui tendant deux gros paquets de bougies. Ne te charge pas trop. Je pense qu’il y en aura assez pour chacun de tes vœux.
— Peut-être pas, dit-elle en riant. Je compte demander le bonheur pour toutes les créatures du Bon Dieu.
Et Hannah remarqua une fois de plus que David était détendu et souriant au magasin, alors qu’un ennui profond semblait le gagner dès qu’il rentrait à la maison.
Puis, en se retirant, elle les remercia encore, pivota sur elle-même et sortit, suivie de Josef. Devant le magasin, sous les arcades, elle se retourna, leur sourit, ajusta pour le renouer le châle qui retenait ses cheveux et traversa la petite place du marché, avec une grâce de fillette, pour entrer dans le mellah.
Un peu plus tard, elle sortit chercher Josef qui jouait devant la maison et le fit rentrer non sans mal pour le baigner. Debout, dans une grande bassine, il gigotait, s’impatientait pendant que Hannah tout en lui parlant, le savonnait en le frottant avec une touffe de crin.
— Avec qui t’es-tu encore battu, bandit ? Qui t’a griffé là au cou ? Et ce bleu, là, à l’épaule ? Mais...
— C’est de l’autre jour, répondit Josef, avec Yacov, le fils du maître. Il a voulu me prendre mes figues, je l’ai repoussé. On s’est battu. Son père a dit que c’était ma faute. Il m’a attrapé pour me frapper avec le nerf de bœuf, alors je me suis sauvé de l’école. Il ne m’aime pas.
— Il ne t’aime pas ? Il a pris parti pour son fils. Je vais lui casser son nerf de bœuf sur la tête, moi, à ce rabbin de parodie, dit-elle, exaltée.
— C’est quoi ça ? dit Josef.
— Enfin, je veux dire qu’il ne doit pas faire seulement semblant d’être un bon maître, s’il veut devenir un jour un rabbin, enchaîna-t-elle pour esquiver la question.
Un mois plus tard, Josef, poursuivi dehors par le maître qui voulait le corriger, le traita de rabbin de parodie. L’autre, furieux, handicapé par sa lourde djellabah noire tentait de le rattraper. Tout à coup, Josef, hors de lui, fit volte-face, prit un caillou et lui dit :
— J’ai rien fait. Si tu t’approches...
Le maître mesura la gravité de la situation, reprit son calme et l’invita à retourner en classe. L’incident fut clos, sans suite, tacitement.
— Allez, viens par là, je vais te sécher, dit Hannah. Il ne faut pas attraper froid ; il se fait tard, pas question que tu ressortes jouer. D’ailleurs, tu vas dormir ici, sinon les autres seront jaloux demain matin.
Une hirondelle sortit d’un nid sous le toit, dans l’angle du patio.
— Bonjour, porteuse de bonnes nouvelles, lui dit-elle.
— Pourquoi tu lui dis ça ? questionna Josef.
Et Hannah en profita pour le faire tenir tranquille en lui racontant :
— Un jour, le grand Roi Salomon, qui rendait la justice la plus équitable, reçut une délégation de femmes qui lui posèrent la question : « Pourquoi, nous, femmes, n’avons-nous pas le droit d’avoir plusieurs maris, alors que les hommes peuvent épouser plusieurs femmes ? » Le Roi, qui était toujours entouré d’animaux dont il connaissait le langage, tout en caressant la crinière de son lion, répondit aux femmes : « Votre question mérite réflexion. Laissez-moi quelque temps. Rentrez chez vous et je chargerai les hirondelles de vous porter ma réponse jusqu’à la porte de votre maison. » Alors, tu comprends, comme il n’a pas dit quand, à chaque fois que les femmes voient arriver une hirondelle, elles lui disent : « Bonjour, porteuse de bonnes nouvelles. »
