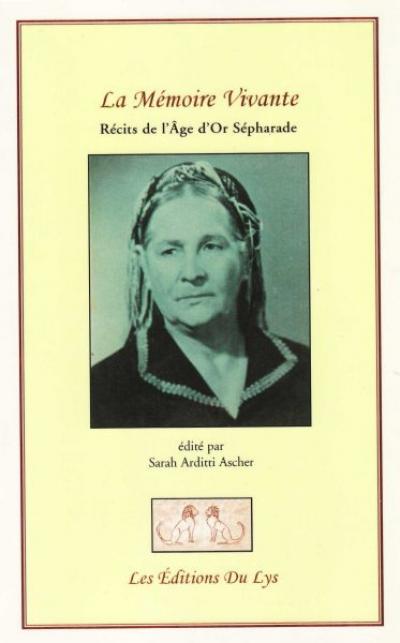
RĂ©pondre au commentaire
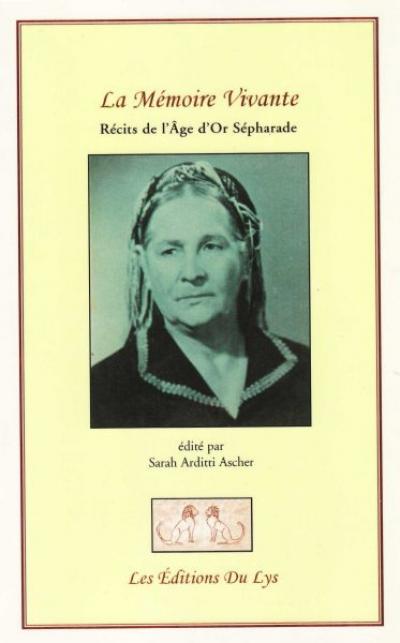
MON ENFANCE AU MAROC
Flory Ibguy
Propos recueillis par Sarah Arditti Ascher
Nous habitions dans une petite ville tranquille du Maroc, près de la côte, dans un quartier où il y avait une grande mosquée et des écoles arabes. Notre maison était un rez-de-chaussée sans étage. Maman, restée veuve très jeune, y a élevé neuf filles. Tout y était d'une propreté méticuleuse. Nos portes étaient toujours grandes ouvertes, nous vivions sans aucune crainte. Tout le monde nous respectait. Maman recevait tous ceux qui venaient demander un verre de thé, un morceau de pain, Juifs ou Arabes. Nous n'étions pas riches mais elle partageait avec tous ceux qui avaient moins que nous.
" Madame Sara, peux-tu me donner à manger ? À boire ? " Elle les faisait entrer, les servait.
La maison était au coin d'une rue par laquelle on passait pour arriver au domaine d'un Caïd, on appelait ainsi les grands et puissants propriétaires arabes, au Maroc. Il avait deux femmes dont une métisse, et six enfants. Chaque femme avait sa maison avec ses dépendances, ses servantes, ses esclaves. Elles ne sortaient jamais. Elles pouvaient regarder les visiteuses arabes, jamais les étrangères ni les hommes, à travers les moucharabiehs.
Le Caïd, nous voyant si polies, si propres, en bon termes avec tous les Arabes du quartier, nous a permis d'entrer au palais, dans la maison des femmes. Nous nous sommes vite fait aimer non seulement des enfants mais aussi des servantes et des esclaves. Chaque enfant avait son esclave personnelle qui était à sa disposition, nuit et jour. Mes sœurs étaient mariées ou travaillaient. Une seule venait quelquefois avec moi. J'étais de l'âge des jeunes enfants et c'est surtout moi qui allais jouer avec eux.
Suivant la coutume orientale, les murs et les planchers étaient recouverts de riches tentures et de tapis. Il n'y avait pas de meubles, mais des guéridons bas, des tables basses rondes en superbe marqueterie ou en cuivre repoussé, des matelas et des coussins posés sur les tapis. Quand les serviteurs apportaient la nourriture, ils posaient les plateaux sur les tables basses. On s'asseyait tout autour sur les coussins, et on mangeait d'une main, sans couteau ni fourchette. Les esclaves apportaient ensuite des bols d'eau et des serviettes et on lavait la main avec laquelle on avait mangé.
Les esclaves étaient la propriété du maître, comme des objets. Il avait des esclaves blancs, hommes, femmes et enfants qu'on lui donnait en cadeau ou qu'il achetait, et il avait des esclaves noirs. Ceux-ci étaient tout au bas de l'échelle. Gare s'ils déplaisaient à leur maître ou à leur maîtresse ! Ils étaient cruellement punis, battus jusqu’au sang. Mon cœur saigne quand je pense à la manière dont ils étaient traités. Ils faisaient les plus gros travaux : le nettoyage de l’argenterie, des cuivres, le tissage de la laine, le gros ménage, la lessive, et en plus ils faisaient la cuisine pour tous. Une esclave avait la charge du thé, une autre, celle du café. Chacun ou chaque groupe avait sa tâche et sa place dans la maison et dans les cuisines, rôtir les viandes, préparer les légumes, faire les pâtisseries, qui l'occupait du matin jusqu'à la nuit. Il y avait tant de ménage à faire dans cet énorme domaine, tant de personnes à nourrir !
Les esclaves faisaient trois sortes de pain : du pain blanc pour le maître et ceux de son rang, pour sa femme et ses enfants blancs. Ils faisaient du pain brun pour la femme métisse et ses enfants, pour les serviteurs et les servantes, et du pain noir pour les esclaves, blancs et noirs. Ceux-ci cuisinaient une quantité incroyable de nourriture et l'apportaient sur d'énormes plateaux en cuivre ou en argent. Ils servaient les maîtres, les maîtresses et leurs enfants d'abord. Quand ceux-ci avaient fini, dans leurs appartements séparés, les plateaux passaient aux serviteurs. Les esclaves avaient droit aux derniers reliefs, c'est-à-dire aux sauces et aux os. S'il arrivait à l'une d'elles de déplaire à sa maîtresse ou à un des enfants, la chef des esclaves, une esclave elle-même, la battait sans pitié avec une lanière en cuir. Nous en éprouvions beaucoup de peine sans pouvoir rien dire et nous rentrions chez nous pour cacher nos larmes.
Nous étions enfants, mais nous n'avons jamais touché à leur nourriture, viandes ou légumes, à cause de la cacheroute. Ils nous aimaient tous pour ça parce qu'ils disaient que nous n'avions pas vendu notre religion. Nous mangions leur pain, nous savions qu'il n'avait pas de gras, leurs gâteaux, leurs crêpes et leurs moufletas, quand ils les servaient à l'heure du thé. Les esclaves aussi nous aimaient beaucoup. Elles voyaient notre peine quand on les punissait ; nous étions gentilles avec elles.
Quand les chameaux venaient, chargés de montagnes de produits de la ferme : lait et beurre, céréales, pommes de terre, fruits, toutes sortes de choses, les esclaves cachaient au passage sous les cages des escaliers des légumes, des fèves, des sacs de farine, du riz, du sucre, du thé, du miel, et tout ce qu'ils pouvaient détourner avant d'envoyer les marchandises à la cuisine. Il y en avait tellement que ça ne se voyait pas. Il fallait bien qu'ils mangent pour pouvoir travailler !
Ils savaient que ma mère partageait avec tous les pauvres du quartier. Ils lançaient de petits cailloux sur nos vitres, nous venions en cachette et ils nous donnaient de tout pour elle. Quand ils égorgeaient des agneaux pour leurs fêtes, ils nous donnaient des poules et des coqs vivants. Voilà votre part, nous disaient-ils. A cette époque, le sucre était introuvable, on manquait de tout. Mais grâce aux esclaves qui partageaient avec nous, nous ne manquions de rien. Ma mère nous envoyait chercher les pauvres l'un après l'autre et partageait aussi avec eux. Toutes les personnes du palais nous considéraient, mes sœurs et moi, comme faisant partie de leur famille. Je garde un merveilleux souvenir de cette époque.
Mon père est mort alors que j'étais toute petite. Quand je suis devenue adolescente - suivant la coutume de l'époque - mon oncle m'a cherché un mari. Il a invité chez lui un jeune homme de Casablanca. Celui-ci est venu quelques jours avant Pâque, pour me voir. Je lui ai plu. Il est retourné passer la fête chez lui, mais le soir de la Mimouna, il est venu demander ma main à mon oncle, puis il est reparti.
Nous nous sommes mariés quarante-cinq jours plus tard, après le 'Omer. En ce temps-là, les filles ne pouvaient qu'obéir et leur mariage était arrangé par leur parents. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. J'ai eu la chance d'être très heureuse avec lui et de l'aimer aussi. Il me disait : je vais t'apprendre à danser, je vais te faire voyager. Tu auras tout ce que tu désires. Il n'a jamais voulu que je travaille, m'a choyée jusqu'à son dernier jour. Je l'ai malheureusement perdu trop tôt.
Il voulait que nous nous installions chez lui après notre mariage, mais ma mère a demandé que nous restions quelques mois chez elle pour que j'apprenne à tenir un ménage. J'étais la plus jeune, je ne savais rien faire. Les femmes du Caïd m'ont fait de merveilleux cadeaux pour mon trousseau, des draps brodés, un tas de choses. Elles avaient fait tisser ma couverture de lit à la main, avec des pelotes de pure laine. Elles se préoccupaient de savoir si mon mari me rendait heureuse. Lui est devenu jaloux. Il ne voulait pas que j'aille dans la grande maison, car il ne pouvait pas y aller avec moi. Je montais sur notre terrasse pour qu'elles me voient - cachées derrière les rideaux - et se rassurent à mon sujet.
Nous sommes restés chez ma mère pendant trois ans, jusqu'à la naissance de mon fils aîné. Quand les femmes du Caïd ont su que j'allais partir à Casablanca, elles se sont mises à pleurer. Lui m'a appelée et m'a posé un tas de questions pour savoir si mon mari me traitait bien, s'il me rendait heureuse et si je voulais partir loin de ma famille et loin d'eux qui étaient aussi comme ma famille.
" Arrêtez de pleurer, elle est heureuse. Elle doit partir avec son mari, " leur a-t-il dit.
Ils n'ont jamais cessé de demander de mes nouvelles. Avec le temps, ils ont perdu tous leurs biens et sont tous morts l'un après l'autre. Seules deux filles vivent encore avec un petit-fils qui est un adulte, aujourd’hui. On va lui rendre visite quand on va en voyage au Maroc. Il nous dit que sa maison est la nôtre et que nous serons toujours les bienvenus.
Cela se passait dans les années quarante. Nous vivions en sécurité, entourés d'Arabes. Ils passaient devant notre maison pour aller à l'école ou à la mosquée. Notre porte était toujours ouverte. Nous avons toujours été très bien traités. Je garde un excellent souvenir de ces belles années au Maroc.
