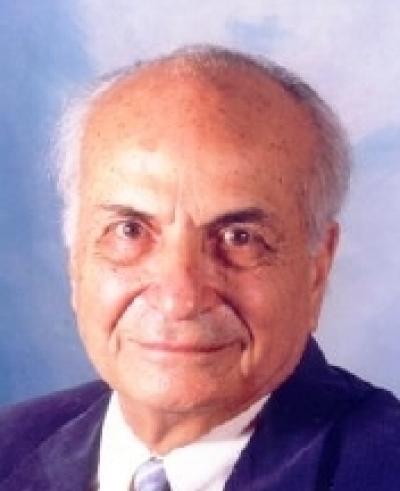
La Bible de AndrƩ Chouraqui
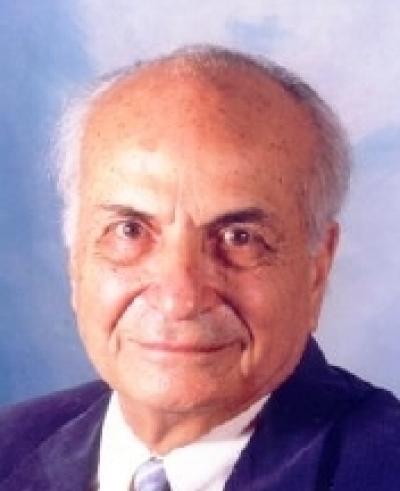
La Bible en son sens - entretien avec André Chouraqui par Guitta Pessis Pasternak
Une nouvelle traduction de la Bible est parue entre 1974 et 1977 et qui était le fruit d’un travail méthodique poursuivi par André Chouraqui (1917-2007) depuis 40 ans. Elle bénéficie de l’expérience accumulée par les traductions traditionnelles, enrichie de la somme des connaissances actuelles en matière de linguistique, de philologie, d’histoire et d’archéologie. Elle tient compte des découvertes les plus récentes de la critique biblique et fait entendre, dans son irremplaçable originalité, l’appel profond du Livre des Livres.
« Bereshit » dit la Bible… « En tête » traduit André Chouraqui au lieu de « Au commencement ». Il forge le mot juste, plonge aux racines des significations exactes, pour retrouver — au-delà des traductions gréco-latines — la voix même des prophètes qu’il traduit. Comme par transparence, il restitue le rythme de leurs phrases, de leurs images, la structure de leurs pensées.
La véritable originalité de cette traduction réside dans le fait que c’est la première, à longueur d’histoire, à naître en milieu hébréophone. Depuis qu’il vit à Jérusalem, André Chouraqui parle quotidiennement la langue de la Bible, redevenue la langue vivante de l’Etat d’Israël.
C’est cette résurrection qui lui permet aujourd’hui de donner à chaque mot son sens, son poids, sa valeur. D’où la surprenante concision du texte français : ce n’est plus une glose sur la Bible, c’est la Bible elle-même, dont l’âpre beauté du texte nous est restituée dans son intégrité.
Les échos suscités par cette nouvelle lecture de la Bible sont étonnants :
Jacques Ellul : « La traduction d’André Chouraqui est probablement un événement aussi important que la traduction de Luther. Elle provoque une conversion de l’intelligence et du cœur. »
André Neher : « Emanant de Jérusalem, un signe théologique avec toutes ses indications actuelles. »
André Mandel : « La Bible de Chouraqui est celle de l’immédiate et effective contestation de l’euphémisme timoré ou hypocrite. »
Jacques Madaule : « La traduction d’André Chouraqui est un événement spirituel… enfin un instrument comparable à ce que furent la Bible de Luther et du Roi Jacques. »
Jean Potin : « Ce travail de décapage donne au texte biblique un visage nouveau. »
Presse Montréal : « Si vous ne deviez lire qu’une Bible dans votre vie, que ce soit celle-ci. »
*** ***
G.P.P. Vous êtes à la fois d’Orient et d’Occident ; votre nom-même, Nathan André Chouraqui, n’est-il pas un appel et une destinée ?
A.C. En effet, mon nom reflète curieusement les lieux et les cultures qui polarisent mon existence, les trois langues de mes racines, l’Hébreu, le Grec et l’Arabe, qui font de mon identité une phrase pleine de signification : « Nathanael » en Hébreu signifie « Dieu a donné » ; « André », en Grec « C’est l’homme » ; « Chouraqui », en Arabe désigne « l’Orient » : « Dieu a donné un homme venu de l’Orient ».
Dans les civilisations du verbe, la personne ou l’objet s’identifient aux noms qui les désignent, et changer de nom équivaut, dans la Bible, à changer de personnalité. Il me semble que les articulations de ma vie réalisent l’ordre de mon nom, en me restituant à cet Orient de mes ancêtres, dont ils ne cessèrent de rêver deux millénaires durant, jusqu’à ce qu’il me soit redonné. Toute ma vie et mon œuvre ont pris pour base ces données de départ ; la culture française dont je suis un fils adoptif, la culture hébraïque qui me nourrit tout entier et enfin la connaissance du monde arabe où je suis né.
L’élan extraordinaire qu’exige la traduction de la Bible hébraïque en Français, ne provient-il pas de votre retour à Jérusalem, de la redécouverte du Dieu biblique dans le dépouillement du désert ?
Certes, il y a eu le dépouillement du désert qui est ma réserve de puissance, et cette redécouverte du Dieu de la Bible, au vertige duquel je ne cesse de vivre. Mais il y a eu surtout un événement capital à mon sens, la renaissance d’Israël, et, au sein d’Israël, la renaissance de la culture biblique. Ma traduction, qui est la première faite en Israël depuis Saint-Jérôme (la Vulgate), et la première traduction dans l’Histoire faite par un Juif de Jérusalem, n’était possible que grâce à la résurrection de l’Hébreu.
Mon projet de traduire la Bible ne pouvait se réaliser que maintenant, car j’avais ma terre sous mes pieds ; j’étais devant les paysages où vécurent les prophètes et les Apôtres, où je pouvais dialoguer avec la Bible dans la langue où elle est écrite.
Depuis que l’Hébreu parlé par le Roi David et le prophète Isaïe était redevenue ma langue maternelle, je voyais avec plus de clarté les défauts de mes traductions antérieures (Cantique des Cantiques, etc.) : elles étaient écrasées sous une chape d’habitudes millénaires, où le relief, l’ardeur et les significations du texte original se reconnaissaient à peine. Ma vocation de traducteur se serait probablement arrêtée là si je n’étais venu m’établir à Jérusalem. A mesure que mon enracinement israélien s’approfondissait, j’ai pris conscience qu’il me fallait reprendre à la racine toute la problématique et la méthodologie des traductions de la Bible. Une révolution était nécessaire, si l’on entend par ce terme un retour aux sources. Oui, si l’on voulait libérer l’homme, il fallait commencer par libérer le verbe.
Vous avez offert votre traduction du Nouveau Testament, la première traduction faite par un Juif de Jérusalem, au Pape Paul VI. Quel a été votre dialogue lors de cette rencontre solennelle ?
Effectivement, le 19 octobre 1977, j’ai eu le privilège d’être reçu en audience officielle par le Pape Paul VI. La partie publique fut intégralement diffusée à plusieurs reprises par la télévision italienne. Lors de cette rencontre solennelle, je lui ai offert les vingt-six volumes de ma traduction…
Cela devait peser lourd ?
Je ne lui ai remis que le volume de l’Evangile et mon éditeur portait les vingt-cinq autres volumes dans une grande valise. Le Pape Paul VI m’a reçu avec simplicité et chaleur, visiblement ému de recevoir des mains du pèlerin de Jérusalem cette première traduction faite par un Juif. Il m’a dit, dans une formule rendue publique : « Il fallait beaucoup d’amour pour réaliser une telle œuvre ! » Effectivement, si j’ai commis un péché en accomplissant cette œuvre, c’est un péché d’amour, car, toute ma vie, j’ai été et continue d’être amoureux de la Bible. D’autre part, nous avons parlé du besoin d’œuvrer pour la paix au Moyen-Orient et nous étions en profonde communion. Il se demandait seulement si les rêves de paix exprimés dans mes livres « Lettre à un Ami Arabe », « Lettre à un Ami Chrétien » et « Vivre à Jérusalem », n’étaient pas prématurés. « Croyez-vous que le temps en soit arrivé ? », se demanda-t-il. Reprenant un antique adage hébraïque, je lui répondis sans hésiter : « Sinon maintenant, quand ? » Le 19 novembre 1977, un mois jour pour jour après notre entretien, Sadate était à Jérusalem. Ainsi mon utopie était en voie de réalisation.
Comment les théologiens chrétiens ont-ils accueilli votre travail sur le Nouveau Testament, cette re-lecture qui lui rend son contexte sémitique en le purifiant des influences hellénistiques ?
A ma grande joie, les centaines de comptes rendus faits aussi bien par les revues scientifiques, par les Eglises et les Synagogues, que par la critique biblique proprement dite, étaient positifs. L’esprit supraconfessionnel et scientifique avec lequel j’ai abordé cette traduction, l’introduction du substrat sémitique et du contexte historique, ont suscité un très grand et durable intérêt.
Ma traduction de la littérature des Hébreux eut été incomplète si elle n’avait compris le Nouveau Testament, ce chant du cygne d’Israël biblique, qui est devenu, par prédilection, le Livre du peuple chrétien.
Le Nouveau Testament pose à ses traducteurs modernes des problèmes théoriques et pratiques plus complexes que la Bible hébraïque. Pour ce qui est des Evangiles, quatre auteurs nous décrivent, de quatre points de vue différents, un même événement dans une langue autre que celle du milieu où les événements décrits ont été vécus. Le Nouveau Testament est une synthèse unique de deux univers, celui des Hébreux et celui des Grecs.
La traduction que je publie, nourrie par l’apport des versions traditionnelles, a pour vocation de rechercher, sous le texte grec, son contexte historique et son substrat sémitique.
Il est étonnant qu’on n’ait pas cherché plus tôt à réintroduire dans le Nouveau Testament ces deux éléments essentiels…
Cette démarche n’est devenue possible qu’aujourd’hui, grâce aux progrès réalisés par les différentes disciplines néotestamentaires, cherchant à ressusciter les réalités historiques du milieu où le Nouveau Testament a été vécu et rédigé.
Par surcroît, le schisme judéo-chrétien a été l’une des causes de l’effacement du substrat sémitique du Nouveau Testament ; les chrétiens avaient même perdu conscience que Jésus était un Juif. Depuis la réconciliation, des chrétiens se sont mis à la recherche des racines hébraïques qui les portent. Le Concile Vatican II, différentes déclarations du Conseil Œcuménique des Eglises, ont accéléré le processus de la réintégration, par la Chrétienté de ses sources historiques et spirituelles, dont son enracinement occidental et parfois des traditions antijudaïques avaient pu l’éloigner. A ce mouvement correspond un événement non moins révolutionnaire : la réintégration par Israël, au sein de sa propre histoire, de l’histoire de Jésus, confirmant ce qu’Einstein disait de Jésus : « Ce Juif central. »
Si je n’étais pas Israélien, j’aurais sans doute, comme les Juifs de la Diaspora l’ont fait pendant 2000 ans, continué à ignorer le Nouveau Testament. C’est le fait de vivre dans les lieux mêmes où Jésus a vécu, de connaître Bethléem, Nazareth, Jérusalem, qui m’a fait reprendre ces textes et leur donner l’interprétation que je leur ai donnée et qui a suscité cet écho mondial.
Quelles sont les convergences ou les divergences de conception et de style entre les deux grands classiques de la traduction biblique : les Septante et la Vulgate ? Comment ont-elles influencé les 1431 traductions de la Bible faites depuis lors ?
Les Septante ont été, non seulement les premiers traducteurs de la Bible, mais aussi les premiers traducteurs de l’Histoire : c’est la première fois qu’on a entrepris la traduction d’un grand texte d’une langue dans une autre langue, c’est-à-dire passer d’un contexte culturel déterminé dans un autre. Les Septante ont fait œuvre de pionniers : ce fut l’un des plus grandioses monuments de l’aventure spirituelle de l’humanité. A cette fin, les Septante optèrent pour une technique de traduction résolument syncrétiste et apologétique.
En apologistes, ils entendaient prouver que les Hébreux avaient au moins autant de philosophie et de lettres que les Grecs ; et, syncrétistes, ils introduisirent dans la Bible tout l’arsenal conceptuel de l’hellénisme, avec la conscience d’autant plus tranquille qu’ils étaient persuadés que Platon et Aristote étaient des disciples de Moïse. Il n’était donc pas étonnant de retrouver des concepts hellénistiques dans la traduction que les 70 rabbins d’Alexandrie donnèrent des prophètes. Et sans doute, n’avaient-ils pas d’autre choix que d’helléniser la Bible pour en ouvrir l’accès accès au monde grec et rendre ainsi à un peuple qui succombe sous les dominations étrangères, la conscience et la connaissance de ses traditions ravagées.
Saint Jérôme, en écrivant la Vulgate, a essayé de faire une traduction révisée, avec ce qu’il appelle la « veritas hebraicas », un retour aux sources aussi radical que possible. Au fond, il a tenté de faire au IVe siècle ce que j’ai tenté de faire au XXe siècle. En l’appelant « vulgate » c’est-à-dire pour le vulgum, pour le peuple, il a offert la première Bible de « poche » en Latin. Les Septante et la Vulgate sont deux grands monuments de la culture universelle et ces deux grandes traductions ont inspiré toutes les autres.
L’importance de ma traduction, d’après les critiques, est justement ce retour radical aux vraies sources bibliques d’avant les Septante.
Est-ce donc la troisième traduction capitale de la Bible ?
Je n’oserai pas l’affirmer, mais elle a été accueillie avec un très grand intérêt, et je dois répéter que si le peuple d’Israël n’était pas revenu en Israël, s’il n’y avait pas eu ce grand mouvement de renaissance des études bibliques, chez les Chrétiens et chez les Juifs, je n’aurais pas pu faire ma traduction, qui est l’aboutissement d’une longue œuvre collective.
Les Septante ont opéré un profond déplacement des significations de la Bible hébraïque : par exemple, l’austère Dieu du Sinaï, YHWH ELOHIM, fut traduit par « Theos », terme qui désignait avant tout les idoles. Comment peut-on éviter de telles transpositions déformantes ?
Je pense que les Septante, pour se faire entendre des Grecs et des Juifs hellénisés, devaient employer leur langage. L’audace géniale consista à appeler le Dieu du Sinaï (YHWH ELOHIM) d’un nom qui désignait les idoles de l’Olympe : « Theos », le « Deus » des Latins, le « Dieu » des Occidentaux. Ainsi « Dieu » est né à Alexandrie du métissage des divinités païennes, étonnées d’accueillir en leur sein l’austère et redoutable Elohim du Sinaï. Lui-même devait se sentir comme une personne déplacée, arraché à son Asie natale et sa solitude de Dieu transcendant pour devenir sous les cieux d’Europe l’un des dieux des nations. Mais si les Septante avaient utilisé le mot « Elohim », les Grecs l’auraient considéré comme barbare.
Croyez-vous qu’il leur était impossible d’accepter une conception monothéiste ?
Par la suite, grâce au Christianisme, le concept de Theos, Dieu », se remplit des significations monothéistes bibliques d’Elohim, dont la Bible est pleine. D’autre part, même les Grecs finissaient par comprendre que leur Theos de l’Olympe ne correspondait pas réellement à Elohim de la Bible, tandis que les Juifs finissaient par oublier que le Theos Grec n’était pas Elohim.
Pourriez-vous donner d’autres exemples flagrants de déplacement des significations?
« Olam » veut dire en Hébreu « la totalité du réel, de l’espace et du temps conçu dans son aspect mystérieux ». Ils l’ont traduit par « éternité » puisque le concept se trouve dans Platon et ont ainsi introduit l’opposition entre le temps et l’éternité, dualité inconnue en Hébreu. J’ai traduit « olam » par « pérennité », puisque le concept « olam », signifiant à la fois le temps et l’espace, n’a pas d’équivalence dans une langue occidentale. Autre exemple : « Nefesh » qui veut dire en Hébreu « la totalité de l’être, corps et âme », ils l’ont traduit par « âme », faisant ainsi opposition entre corps et âme, dualisme inexistant en Hébreu. Il se créa ainsi une nouvelle langue, une sorte d’hébreu-grec, où le ciel biblique se reflétait dans son miroir hellénique.
Le problème essentiel de la traduction ne provient-il pas des différentes réalités socio-culturelles vécues par les divers peuples, qui sont, de ce fait, reflétées dans leur vocabulaire ?
Je crois, en effet, que c’est un problème qui dépasse de loin la traduction. Après Babel, le mythe de la langue universelle disparaît et la transparence dans la traduction est pratiquement devenue impossible. Néanmoins, chaque époque, chaque société, ont leur style de traduction, leur langage, leur vocabulaire : chaque homme traduit en permanence, et la première traduction s’opère entre ce que je pense et ce que je dis, entre l’objet et son expression, entre le mot et la chose. Toute traduction opère donc un déplacement de signification quand elle passe d’un contexte culturel à un autre. D’autant plus que l’écart était infranchissable entre le monde sémitique et le dieu sinaïtique d’une part, et le monde hellénistique et les Dieux de l’Olympe d’autre part.
La Bible étant vénérée comme un livre sacré, unique, ses traductions elles-mêmes ont été trop longtemps considérées comme sacrées, donc figées ; une traduction de la Bible devrait ressembler à l’interprétation d’un morceau de musique ; il faudrait multiplier les traductions afin de dégager les multiples richesses du texte.
Tandis que les Septante ont considéré eux-mêmes leur livre comme intouchable ; Jérôme a été déclaré Saint et sa Vulgate, la version autorisée. Ainsi, pendant des millénaires, les traductions de la Bible ont été figées jusque dans leur vocabulaire. La traduction des Septante et la Vulgate reflétaient une certaine lecture de la Bible qui confirmait l’interprétation dont elle était le fruit et faisait écran avec le texte original.
Est-ce que certaines versions ne reflétaient pas, d’une certaine façon, des intentions politiques ?
Certainement. Prenons les Rabbins d’Alexandrie, leur traduction de la Bible était visiblement faite pour rehausser le prestige des commerçants juifs. Ils ne présentaient donc pas la Bible objectivement, mais l’adaptaient au monde intellectuel grec, de la même manière qu’eux-mêmes, groupe minoritaire, tentaient de s’assimiler au monde social majoritaire grec. Ils n’ont pas essayé de montrer en quoi les Hébreux étaient différents des Grecs, mais en quoi les Hébreux étaient aussi grecs que les Grecs. C’est une œuvre de colonisé, conçue dans une culture dominante. Je pense d’ailleurs que c’est à peu près inévitable.
Votre traduction n’était donc possible que dans un Etat d’Israël indépendant, dans une liberté culturelle réelle ?
En effet, j’ai perdu en Israël mon complexe de minoritaire vis-à-vis du monde chrétien, face auquel j’ai cessé d’avoir besoin de m’affirmer, du fait que j’ai un pays sous mes pieds. Le Talmud dit « Un homme qui n’a pas de terre sous ses pieds n’est pas un homme. » Je suis désormais libéré intérieurement et je peux jeter un regard objectif et amical sur le Nouveau Testament ; je n’ai plus besoin de l’ignorer, comme l’ont fait trop souvent les Juifs minoritaires. Bien au contraire, je le considère comme une page importante de la culture hébraïque et l’une des plus importantes de la culture universelle.
Votre méthode de traduction biblique utilise les connaissances sémantiques, archéologiques et socio-historiques de notre temps. En quoi diffère-t-elle d’une méthode de traduction classique ?
Il fallait reprendre le travail de traduction à la base, remettre en question le sens de chaque mot, de chaque expression pour retrouver l’authenticité de leurs significations. Ce décapage était rendu possible par le progrès des études exégétiques, ainsi que par les recherches archéologiques, historiques et surtout sémantiques qui ont suivi la renaissance de l’Hébreu. Ayant été moi-même traducteur de la Bible à Paris (« Devoirs des Cœurs », « Psaumes », « Cantique des Cantiques ») je connais la méthodologie utilisée par les traducteurs bibliques en exil, qu’ils soient juifs, catholiques ou protestants. Ils ne pouvaient éviter de recourir aux dictionnaires pour déchiffrer les textes puisque l’Hébreu, avant sa renaissance en Israël, n’était plus parlé quotidiennement et nul ne pouvait avoir recours à la langue vivante pour vérifier les affirmations des linguistes. De ce fait, aussi, les dictionnaires étaient nécessairement compilés à partir des traductions et commentaires de la Bible ; on faisait les dictionnaires à coups de traduction et vice-versa. Ce cercle fermé entretenait l’immobilisme des traductions tandis qu’aujourd’hui, il y a un terme de référence vivant.
Les découvertes archéologiques avaient aussi des conséquences terminologiques…
Grâce aux découvertes archéologiques, on connaît maintenant la signification de chaque objet ainsi que le vocabulaire technique de la Bible. Avant, on traduisait les noms de la flore et de la faune selon ceux qu’on connaissait en Europe : « Shoshana » était traduit par « narcisse », « lys » ou « rose », quand, en réalité, cela signifie « lotus ». Ainsi naissait un déplacement de signification : le lotus était la fleur des pharaons, un symbole d’éternité, de splendeur, de perception et de création et il était significatif que la femme soit comparée à un lotus.
En ce qui concerne l’archéologie, je prépare une grande édition illustrée et commentée, où j’expliquerai, verset par verset, avec des articles de synthèse, les significations et la clef des options de ma traduction. Cette édition aura 4000 illustrations en couleurs et s’appellera « L’Univers de la Bible » [paru en 10 tomes, Brépols-Lidis, 1982-1989]. Chaque objet, chaque plante, chaque paysage de la Bible y sera illustré d’après les découvertes archéologiques, non seulement hébraïques, mais aussi celles de la Mésopotamie, de la Syrie et de l’Egypte. Cette œuvre gigantesque sera publiée en 1981 et diffusée par Brepols et Lidis.
Pourriez-vous illustrer la façon dont vous avez réussi à « décaper » certaines expressions bibliques profondément ancrées dans les esprits, afin de leur redonner l’authenticité de leur signification originelle ?
J’ai tenu, dans la mesure du possible, à respecter le sens des mots, en tenant compte de la période où ils ont été écrits, de leur contexte historique. Prenons le mot « Asherai » ; « asher » en Hébreu signifie « le pas de l’homme ». « Asherai » signifie ainsi « une marche sur une route sans obstacle qui conduit vers Dieu ». Les Septante, en le traduisant par « Macarios » c’est-à-dire « bienheureux », y ont introduit tout l’hellénisme grec, pour lequel le bonheur est l’idéal suprême. Cette fausse traduction a donc opéré une véritable déviation de signification, car, dans la Bible qui n’est pas un livre hédoniste, ce n’est pas le bonheur qui est un idéal, mais Dieu et la justice. Personnellement, je traduis « asherai » par « en marche », « debout », « en avant », tandis que les traductions classiques disent « bienheureux, béatitude », ce qui est un contresens. Quand, dans le Sermon sur la Montagne, Jésus dit à ses disciples « asherai », il parle à des maquisards malheureux, persécutés par les Romains ; il est donc inconcevable qu’il leur dise « bienheureux », mais plutôt « debout », « en marche », « en avant »… C’est un cri de réveil et non pas d’assoupissement dans le bonheur grec.
Est-ce que les lecteurs n’étaient pas déconcertés par cette toute nouvelle lecture de la Bible ?
Surpris certes, parce que je déclasse des siècles d’habitudes. C’est une Bible où le mot « Dieu » ne figure pas, remplacé par « Adonai » ; où « âme » ne figure pas pour « nefesh » mais « être »; où le mot « éternité » ne figure pas pour « olam » mais « pérennité » ; « faute » remplace « péché », devenu un concept ecclésiastique.
La révolution était complète et correspondait peut-être à l’attente où l’on était d’une lecture nouvelle de ces textes dont l’actualité ne cesse de nous questionner et de nous émouvoir.
Pourriez-vous décrire d’autres cheminements originaux de votre transcription des noms de personnes et de lieux, comme, par exemple, « la sortie de Mitsraïm » au lieu de « la sortie d’Egypte » ?
Compte tenu de la profonde évolution de l’Hébreu au cours des siècles qui voient naître les différents textes de la Bible, ma traduction tente d’éviter l’anachronisme. Ainsi, elle ne parle pas de la sortie d’Egypte mais de la sortie de Mitsraïm : « Egypte » ne désignait l’Empire des Pharaons (Massara) qu’à l’époque grecque, et seulement en milieu gréco-latin, soit un millénaire après l’Exode. Admettrait-on que l’on parlât de la France et non de la Gaule à l’époque de Vercingétorix ?
Les noms des personnes et des lieux ont été transcrits selon une grille qui entend demeurer proche du contexte historique et qui révèle, sous la déformation subie par les noms au cours des siècles, le relief réel du texte.
Ainsi, Moïse est en réalité « Moshe » : c’est en l’adaptant à l’alphabet grec qui n’a pas de « sh » qu’il est devenu « Moses ». Le sort de « Yehoshoua » est encore plus malheureux ; le grec n’ayant ni « sh » ni « ain » il est devenu « Jésus ». Ainsi le même nom hébraïque « Yehoshua » est traduit dans l’Ancien Testament par « Josué » et dans le Nouveau Testament par « Jésus ». L’exemple le plus curieux est celui de « Jaacov » devenu « Jacob » et par déformation « Jacques », et « James » en Anglais.
Je pense que — le monde entier étant à la recherche de l’authenticité de ses racines — il est nécessaire de faire ce que Malraux a fait pour Paris : enlever les plâtres, les fausses apparences, et revenir aux sources. Appeler un chat, un chat, et James, Jaacov.
Étiez-vous amené à forger beaucoup de néologismes ? Et comment procédez-vous à leur création ?
De même que les Septante et la Vulgate ont créé leurs langues, tout traducteur authentique de la Bible est amené à forger sa propre langue. J’ai donc accepté le risque de créer des mots nouveaux chaque fois qu’il était nécessaire d’épouser plus étroitement le relief du texte, pour, dans la mesure du possible, ne rien effacer. Prenons l’exemple de « rahamim » que les traducteurs donnent pour « miséricorde » ; or l’Hébreu est beaucoup plus concret : « rehem » signifie « matrice », origine de toute vie. « Adonaï maleh rahamim » signifie alors « Dieu qui est matrice de l’univers ». De même que la matrice nourrit, garde et développe un germe de vie, Dieu des Hébreux fait pareil vis-à-vis de chaque créature, de l’univers tout entier. J’ai donc lancé le néologisme « matricier-matriciel ».
Parfois, pourtant, la traduction est impossible et on est obligé de se satisfaire d’une approximation. Par exemple : « Le-varech » est traduit par « bénir », « benedicire » « dire du bien ». Or, en Hébreu, « le-varech » signifie « se mettre dans une attitude physique et spirituelle telle qu’agenouillé devant Dieu (Berech : genou), on se met en position d’en induire les bienfaits ».
Depuis de longues années, j’ai interrogé les meilleurs linguistes et philologues afin de trouver une équivalence pertinente, mais en vain.
Chaque fois qu’on relit un verset de la Bible, on y décèle un sens nouveau. Croyez-vous qu’en relisant votre propre traduction dans quelques années, vous-même la remettriez en cause ?
Les versets de la Bible, mille fois lus et relus, restent toujours vierges, et, à la millième lecture, il me semble découvrir un texte pour la première fois. En hébreu, la structure de la langue favorise la multiplication des résonances infinies de chaque verset. Si bien que la lecture n’a jamais de fin : un livre achevé est aussitôt mûr pour une nouvelle lecture qui en renouvellera le sens.
Depuis cette première traduction de la Bible en 26 volumes, chemin faisant, j’ai beaucoup appris, beaucoup approfondi, et la nouvelle édition (10 volumes de 500 pages, illustrés et commentés) ne sera pas une traduction corrigée mais, pratiquement, une nouvelle traduction qui met en œuvre tout ce que j’ai acquis de nouveau sur la Bible. Toute traduction est perpétuellement à refaire et celle de la Bible tout particulièrement.
Quelle est l’acceptation pratique de « votre » Bible ?
L’autre jour, je rentre par hasard dans une église de Paris et, en chaire, on prêche d’après ma traduction. Des évêques, des cardinaux, des curés de campagne, lisent en chaire ma traduction. Le plus étonnant est une troupe théâtrale, le UY’RAMET de Belgique, qui a créé un spectacle de trois heures, basé sur ma traduction, avec une mise en scène prodigieusement élaborée qui se donne devant un public enthousiaste.
L’Académie française m’a accordé une distinction très rare, pour cette traduction de la Bible, la Médaille d’Or de la Langue française.
Espérez-vous ainsi, en aplanissant les « contresens » des traductions anciennes, et en réinsérant les Ecritures dans leur vrai contexte historique, que juifs et Chrétiens se comprendront mieux ? Car, vous expliquez que la polémique entre Juifs et Chrétiens, concernant la divinité du Christ, provient de la profonde différence de signification que les univers sémitiques et helléniques donnent au mot « Fils de Dieu ».
C’est l’un des cas les plus frappants où une traduction exacte par le simple transfert d’une langue à l’autre opère une profonde mutation de la signification des mots. L’expression « Fils de Dieu » se dit en hébreu « Ben-Elohim » et en grec « Huios-Theou ». Ces mots sont parfaitement traduits mais ils n’ont pas le même sens en hébreu et en grec. En hébreu, le mot « Ben » désigne le fils ou un jeune homme sans aucune référence de filiation. Le mot « Ben » est ainsi un simple relatif qui doit s’entendre comme tel dans un univers dont Dieu est le créateur, le Père. Dire qu’un homme est le fils de Dieu, c’est affirmer une évidence admise par tous et enseignée par Moïse : « vous êtes des fils pour YHWH, votre Elohim ». Traduisez cette expression aussi exactement que possible en grec et en latin et elle prend un sens profondément différent. Les mots « Theou » en grec ou « Filius Dei » en latin, entendus dans l’empire de Tibère où les dieux ne sont pas des créateurs mais des procréateurs, ont un sens précis et exclusif. Juifs et chrétiens se heurtent depuis deux millénaires sur le sens de la filiation divine de Jésus. Mais c’est là un faux conflit : jamais les mots « Huios-Theou » n’auront le même sens que « Ben-Elohim », à moins de détruire l’univers conceptuel des Grecs et de le remplacer par celui des Hébreux ou inversement.
La polémique judéo-chrétienne sur la divinité du Christ me paraît ainsi dénuée de sens, si l’on admet le principe de la coexistence de cultures différentes et non celui de la prédominance de l’une sur l’autre. Dans cette optique, une recherche commune des Juifs et des Chrétiens vers la vérité historique de leurs sources m’apparaît essentielle à la rénovation de leur pensée. Ils verront que ces textes devraient les unir au lieu de les séparer, donnant tout son sens au cri de Pie XI : « Nous sommes spirituellement des sémites. » J’ai tenté de m’y engager avec mes travaux de traducteur. Etant à la découverte renouvelée des significations de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament, j’avais conscience de ce que la délivrance de l’homme impliquait la libération du verbe.
La Bible réalise le miracle de parler directement à tous les hommes de tous pays et de toutes les époques, en évoquant les réalités les plus essentielles. Son extraordinaire impact ne proviendrait-il pas aussi de son imagerie en mouvement ?
Vous venez de le dire, la Bible parle des choses les plus profondes, les plus universelles, c’est un livre unique. Tout écrivain, tout éditeur, sait qu’un livre s’adresse à un public, à une époque et que, la plupart du temps, son éphémère durée ne dépasse pas quelques années et s’il tire à 30000 exemplaires, on crie au miracle, c’est un « best-seller ». Tandis que la Bible, depuis 2000 ans, se traduit en 1431 langues et tire à des millions d’exemplaires dans chacune d’elle. Car elle s’adresse aussi bien au savant qu’au paysan, au contemporain d’Isaïe qu’à l’homme des cités industrielles, sans perdre de sa puissance de communication et d’inspiration : ceci provient de son génie propre.
Quand on me demande si je considère que la Bible est un livre inspiré par Dieu, je réponds que si c’était le cas, alors rien d’étonnant qu’il soit si grand, si beau, si superbe… Mais, admettre que la Bible a été inspirée par Dieu serait simplifier l’explication du mystère de sa nature et de l’universalité de son influence. Si Dieu se mêle d’écrire des livres, les pauvres écrivains que nous sommes n’ont plus qu’à lever les bras au ciel et à se rendre : il n’y aurait plus rien d’étonnant à constater que la Bible est ce qu’elle est. Le mystère à mes yeux commencerait si j’étais convaincu que les prophètes ont écrit seuls, sans le secours de ce souffle tout puissant, sensible encore des millénaires après sa rédaction : comment ces simples hommes, perdus dans les déserts asiatiques, parlant une langue sémitique hermétique, ont-ils eu le génie d’interpeller les cieux et la terre, de tutoyer Dieu et de dicter à l’humanité sa loi, son langage, ses valeurs et ses buts. Décidément, ici le naturel parait surnaturel et le surnaturel naturel : quel que soit le parti que l’on prenne, la Bible garde son mystère.
Un mystère conté en images cinématographiques?
Cette gageure unique a été gagnée grâce à une technique d’expression qui a permis un vrai miracle de la communication universelle. J’aime à penser que mes ancêtres, les Hébreux, ont été les vrais inventeurs du cinématographe ; la Bible est essentiellement une imagerie en mouvement. Du premier verset de la Genèse au dernier de l’Apocalypse, le texte décrit des images ou rapporte des dialogues avec la concision d’un synopsis de film. Ouvrez votre Bible, lisez-la : vous êtes le spectateur installé au cinématographe d’une parole vivante, la pensée s’exprime par des images concrètes qui se succèdent avec une telle rapidité que votre esprit est soudain entraîné par le rythme : le film peut être vu par quiconque s’installe devant l’écran, les images sont comprises directement par tous les regards. Ainsi en est-il de la Bible : tout le monde est invité à participer à ce spectacle que les vitraux, la statuaire et la peinture du Moyen Age illustraient déjà.
La Bible, porteuse d’un nouvel espoir de justice ? Votre lecture évoque d’autres recherches actuelles : Bernard-Henri Levy (Le Testament de Dieu, Grasset) et René Girard (les Choses cachées depuis le début du Monde, Grasset), etc. Comment expliquer cette étonnante convergence aux mêmes sources bibliques ?
On assiste actuellement à un grand besoin de ressourcement dans le monde. Ce phénomène s’exprime effectivement chez une pléiade d’auteurs. Cela provient, d’une part, de l’effondrement des cultures occidentales traditionnelles, et, d’autre part, de l’émergence d’un nouveau monde technologique totalement différent. On cherche le langage de cet univers neuf. On a besoin de réponses aux problèmes que l’effondrement de la culture gréco-latine laisse sans réponse.
Je crois que, dans cette grande crise intellectuelle que nous traversons tous, la Bible apporte sa réponse et que les auteurs dont vous parlez y puisent leur solution à cette impasse. La Bible est redevenue un livre extraordinairement actuel.
Les prophètes savaient que le réel possède une unité organique, que le salut serait global ou ne serait pas. Ainsi annoncent-ils la mutation — non le progrès — du réel. Ils prévoient l’apparition d’un homme nouveau, d’une nouvelle terre, qui seront dignes de la justice qui les mènera vers la fin des conflits entre riches et pauvres, entre maîtres et esclaves érigeant sur terre le règne de la paix, de la fraternité, de l’amour. Une espérance est ainsi greffée au cœur de l’homme.
Croyez-vous donc que l’attrait actuel de la Bible réside aussi dans un message contestataire ?
La Bible est une vision futuriste de l’univers : elle a conçu le monde sous l’espèce de l’unité, en assignant à l’humanité des buts que nous sommes loin d’avoir atteints ; les prophètes, parce qu’ils adorent un dieu de vie, savent que la mort est le suprême ennemi de l’homme et que tant qu’elle existera, le règne de YHWH ne sera pas total ; elle est donc destinée à être vaincue. Avec cette folle vision, les prophètes ont redressé l’humanité. C’est notamment ce qui fait la grandeur de la Bible et la raison pour laquelle elle correspond si profondément aux angoisses de notre temps. Car, cette fois-ci, la mort sera l’anéantissement atomique, l’apocalypse. L’intérêt de la Bible provient justement de ce qu’elle avait situé dès le départ son optique sur ce problème essentiel : « J’ai placé devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction — Choisis la vie afin que tu vives. »
Elle est plus que jamais un livre révolutionnaire, en ce sens qu’elle représente une image de l’homme parfait, accompli, qui réalise ses idéaux. Depuis 3000 ans qu’elle rêve d’un monde pacifique, d’un monde juste, d’un monde où l’homme est un frère pour l’homme, d’un monde où la haine, l’injustice et la guerre seront abolies, la Bible rêve même d’un monde où la mort sera vaincue, où la vie sera la seule valeur suprême. Dans ce sens, la Bible reste aujourd’hui encore un livre futuriste, révolutionnaire, puissamment contestataire. Oui, toute pensée révolutionnaire apparaît naine auprès de celle-ci, neuve au bout de vingt-sept siècles et de loin en avance aujourd’hui non seulement sur ce que font les hommes, mais sur ce à quoi ils aspirent.
La renaissance de la langue hébraïque est étonnante ; comment expliquer qu’une langue qui date de l’âge du bronze peut aussi bien désigner les réalités du XXe siècle ?
La vertu de la langue hébraïque provient du fait qu’elle est la seule langue moderne qui soit en même temps une langue originelle, primitive. Née à l’âge du bronze, assassinée à l’âge du fer par les Empires qui écrasent les Hébreux, elle est redevenue au seuil de l’ère atomique la langue vivante du Nouvel Israël. C’est là un fait sans précédent dans l’histoire des civilisations. Restée endormie pendant deux millénaires, elle est un instrument linguistique qui appartient à une époque révolue. En parlant Hébreu, nous sommes les contemporains des hommes des cavernes. A cette époque-là, le langage était forcément concret ; il avait l’impact de l’immédiateté, du contact avec les choses. C’est à partir de ce premier matin des mondes, que notre langue renaît aujourd’hui ; d’où sa puissance d’évocation, sa force et sa jeunesse.
Cela rejoint la réflexion de Michel Foucault, selon laquelle, en Hébreu, il existe un lien réel, non arbitraire, entre les mots et les choses qu’ils désignent ?
Pour comprendre l’Hébreu, il convient d’être familiarisé avec un climat mental singulier, où les rapports sujet-objet sont différents de ceux du monde occidental. En Hébreu, il n’y a pas de distinction entre « davar » qui signifie « objet » et « davar » qui signifie « parole ». Le même mot désigne indifféremment « chose » ou « parole », « affaire » ou « ordre ». C’est pourquoi la chose n’a de réalité que si elle porte un nom. L’homme n’est pas seulement désigné par son nom propre : il est ce nom. Ainsi « Abram » sait qu’il n’aura pas d’enfant. Mais Dieu lui dit « ton nom sera désormais Abraham, car je te fais le père d’une multitude de nations ». L’homme hébraïque vit dans un monde verbal où la notion de temps prime celle de l’espace, où la dualité entre le temps et l’éternité, l’âme et le corps n’existe pas. Il vit dans un présent, dans une totalité où le passé, le présent et le futur du monde conscient, l’objet et la parole, ne font qu’un.

Commentaires
Publier un nouveau commentaire